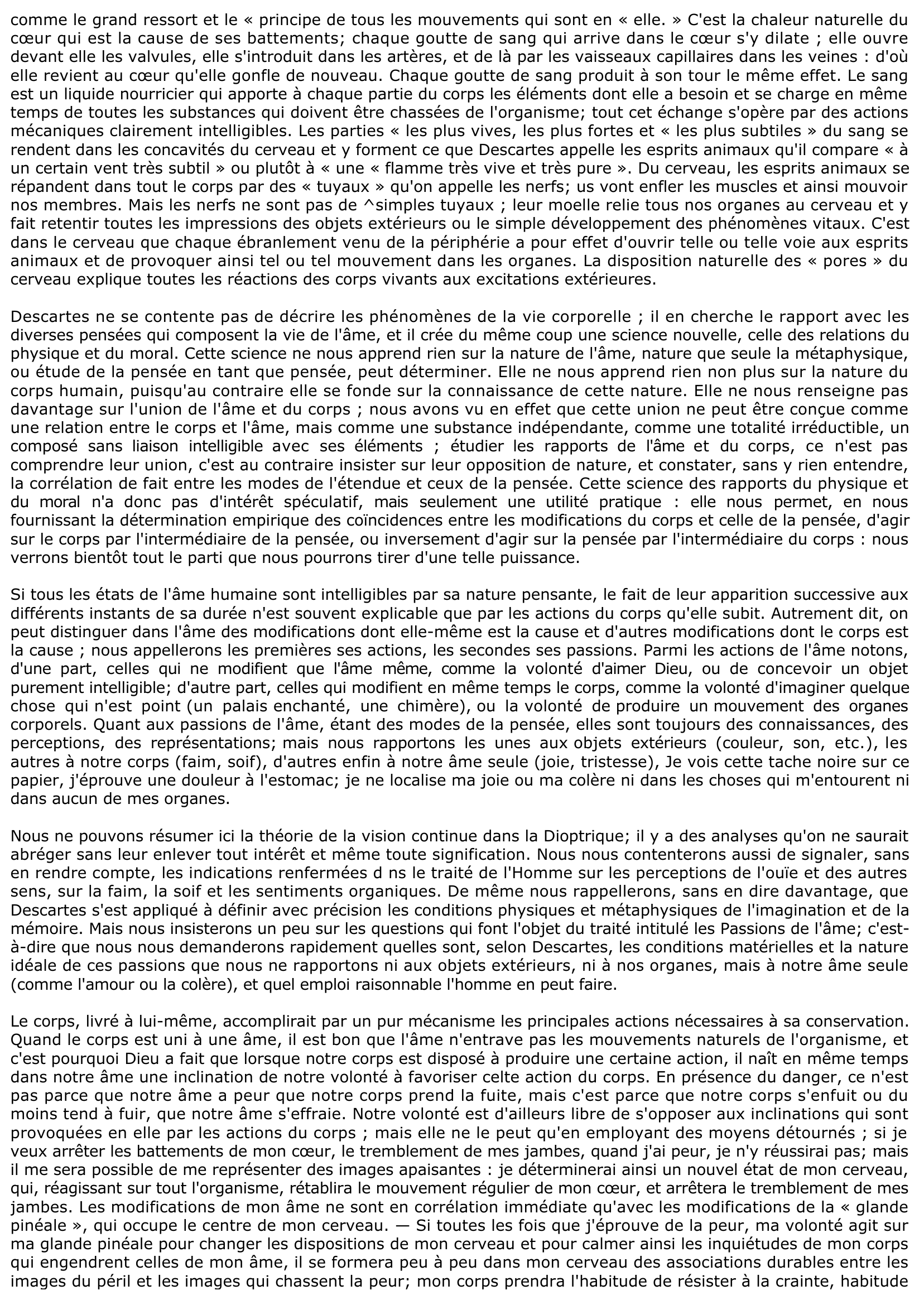LES PASSIONS DE L'AME de DESCARTES (analyse)
Publié le 15/03/2011
Extrait du document
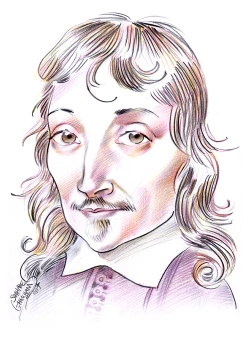
En écrivant les Principes de la Philosophie, Descartes n'avait pas achevé de remplir le programme scientifique qu'il s'était imposé. Il lui restait à étudier les êtres vivants, et en particulier l'homme ; il lui restait aussi à tirer de sa science toutes les conséquences pratiques qu'elle comportait, et à fonder ainsi trois arts : celui des inventions mécaniques, celui de la médecine et celui de la morale.
Tout le reste de sa vie, Descartes travailla sans relâche à parfaire son œuvre. Jusqu'à quel point y réussit-il? C'est ce que nous examinerons dans ce dernier chapitre. Toujours pressé d'en venir aux applications les plus utiles de la science, convaincu d'ailleurs de son impuissance à résoudre à lui seul tous les problèmes de la nature, Descartes néglige de parti pris l'étude des plantes et des animaux pour se consacrer plus spécialement à celle de l'homme. Mais ce n'est pas l'homme tout entier qu'il se propose de considérer désormais.
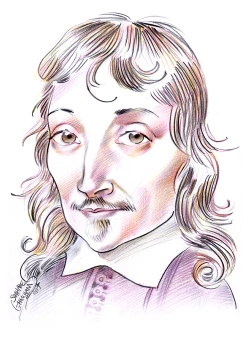
«
comme le grand ressort et le « principe de tous les mouvements qui sont en « elle.
» C'est la chaleur naturelle ducœur qui est la cause de ses battements; chaque goutte de sang qui arrive dans le cœur s'y dilate ; elle ouvredevant elle les valvules, elle s'introduit dans les artères, et de là par les vaisseaux capillaires dans les veines : d'oùelle revient au cœur qu'elle gonfle de nouveau.
Chaque goutte de sang produit à son tour le même effet.
Le sangest un liquide nourricier qui apporte à chaque partie du corps les éléments dont elle a besoin et se charge en mêmetemps de toutes les substances qui doivent être chassées de l'organisme; tout cet échange s'opère par des actionsmécaniques clairement intelligibles.
Les parties « les plus vives, les plus fortes et « les plus subtiles » du sang serendent dans les concavités du cerveau et y forment ce que Descartes appelle les esprits animaux qu'il compare « àun certain vent très subtil » ou plutôt à « une « flamme très vive et très pure ».
Du cerveau, les esprits animaux serépandent dans tout le corps par des « tuyaux » qu'on appelle les nerfs; us vont enfler les muscles et ainsi mouvoirnos membres.
Mais les nerfs ne sont pas de ^simples tuyaux ; leur moelle relie tous nos organes au cerveau et yfait retentir toutes les impressions des objets extérieurs ou le simple développement des phénomènes vitaux.
C'estdans le cerveau que chaque ébranlement venu de la périphérie a pour effet d'ouvrir telle ou telle voie aux espritsanimaux et de provoquer ainsi tel ou tel mouvement dans les organes.
La disposition naturelle des « pores » ducerveau explique toutes les réactions des corps vivants aux excitations extérieures.
Descartes ne se contente pas de décrire les phénomènes de la vie corporelle ; il en cherche le rapport avec lesdiverses pensées qui composent la vie de l'âme, et il crée du même coup une science nouvelle, celle des relations duphysique et du moral.
Cette science ne nous apprend rien sur la nature de l'âme, nature que seule la métaphysique,ou étude de la pensée en tant que pensée, peut déterminer.
Elle ne nous apprend rien non plus sur la nature ducorps humain, puisqu'au contraire elle se fonde sur la connaissance de cette nature.
Elle ne nous renseigne pasdavantage sur l'union de l'âme et du corps ; nous avons vu en effet que cette union ne peut être conçue commeune relation entre le corps et l'âme, mais comme une substance indépendante, comme une totalité irréductible, uncomposé sans liaison intelligible avec ses éléments ; étudier les rapports de l'âme et du corps, ce n'est pascomprendre leur union, c'est au contraire insister sur leur opposition de nature, et constater, sans y rien entendre,la corrélation de fait entre les modes de l'étendue et ceux de la pensée.
Cette science des rapports du physique etdu moral n'a donc pas d'intérêt spéculatif, mais seulement une utilité pratique : elle nous permet, en nousfournissant la détermination empirique des coïncidences entre les modifications du corps et celle de la pensée, d'agirsur le corps par l'intermédiaire de la pensée, ou inversement d'agir sur la pensée par l'intermédiaire du corps : nousverrons bientôt tout le parti que nous pourrons tirer d'une telle puissance.
Si tous les états de l'âme humaine sont intelligibles par sa nature pensante, le fait de leur apparition successive auxdifférents instants de sa durée n'est souvent explicable que par les actions du corps qu'elle subit.
Autrement dit, onpeut distinguer dans l'âme des modifications dont elle-même est la cause et d'autres modifications dont le corps estla cause ; nous appellerons les premières ses actions, les secondes ses passions.
Parmi les actions de l'âme notons,d'une part, celles qui ne modifient que l'âme même, comme la volonté d'aimer Dieu, ou de concevoir un objetpurement intelligible; d'autre part, celles qui modifient en même temps le corps, comme la volonté d'imaginer quelquechose qui n'est point (un palais enchanté, une chimère), ou la volonté de produire un mouvement des organescorporels.
Quant aux passions de l'âme, étant des modes de la pensée, elles sont toujours des connaissances, desperceptions, des représentations; mais nous rapportons les unes aux objets extérieurs (couleur, son, etc.), lesautres à notre corps (faim, soif), d'autres enfin à notre âme seule (joie, tristesse), Je vois cette tache noire sur cepapier, j'éprouve une douleur à l'estomac; je ne localise ma joie ou ma colère ni dans les choses qui m'entourent nidans aucun de mes organes.
Nous ne pouvons résumer ici la théorie de la vision continue dans la Dioptrique; il y a des analyses qu'on ne sauraitabréger sans leur enlever tout intérêt et même toute signification.
Nous nous contenterons aussi de signaler, sansen rendre compte, les indications renfermées d ns le traité de l'Homme sur les perceptions de l'ouïe et des autressens, sur la faim, la soif et les sentiments organiques.
De même nous rappellerons, sans en dire davantage, queDescartes s'est appliqué à définir avec précision les conditions physiques et métaphysiques de l'imagination et de lamémoire.
Mais nous insisterons un peu sur les questions qui font l'objet du traité intitulé les Passions de l'âme; c'est-à-dire que nous nous demanderons rapidement quelles sont, selon Descartes, les conditions matérielles et la natureidéale de ces passions que nous ne rapportons ni aux objets extérieurs, ni à nos organes, mais à notre âme seule(comme l'amour ou la colère), et quel emploi raisonnable l'homme en peut faire.
Le corps, livré à lui-même, accomplirait par un pur mécanisme les principales actions nécessaires à sa conservation.Quand le corps est uni à une âme, il est bon que l'âme n'entrave pas les mouvements naturels de l'organisme, etc'est pourquoi Dieu a fait que lorsque notre corps est disposé à produire une certaine action, il naît en même tempsdans notre âme une inclination de notre volonté à favoriser celte action du corps.
En présence du danger, ce n'estpas parce que notre âme a peur que notre corps prend la fuite, mais c'est parce que notre corps s'enfuit ou dumoins tend à fuir, que notre âme s'effraie.
Notre volonté est d'ailleurs libre de s'opposer aux inclinations qui sontprovoquées en elle par les actions du corps ; mais elle ne le peut qu'en employant des moyens détournés ; si jeveux arrêter les battements de mon cœur, le tremblement de mes jambes, quand j'ai peur, je n'y réussirai pas; maisil me sera possible de me représenter des images apaisantes : je déterminerai ainsi un nouvel état de mon cerveau,qui, réagissant sur tout l'organisme, rétablira le mouvement régulier de mon cœur, et arrêtera le tremblement de mesjambes.
Les modifications de mon âme ne sont en corrélation immédiate qu'avec les modifications de la « glandepinéale », qui occupe le centre de mon cerveau.
— Si toutes les fois que j'éprouve de la peur, ma volonté agit surma glande pinéale pour changer les dispositions de mon cerveau et pour calmer ainsi les inquiétudes de mon corpsqui engendrent celles de mon âme, il se formera peu à peu dans mon cerveau des associations durables entre lesimages du péril et les images qui chassent la peur; mon corps prendra l'habitude de résister à la crainte, habitude.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- RENE DESCARTES : LES PASSIONS DE L'AME (Résumé & Analyse)
- PASSIONS DE L’AME (Les) de René Descartes
- TEXTE: LES PASSIONS DE L'AME, LETTRE Ire A MONSIEUR DESCARTES. DESCARTES
- TEXTE: LES PASSIONS DE L'AME, LETTRE Ire A MONSIEUR DESCARTES. DESCARTES
- TEXTE: LES PASSIONS DE L'AME, PREMIERE PARTIE, ARTICLE 47. DESCARTES