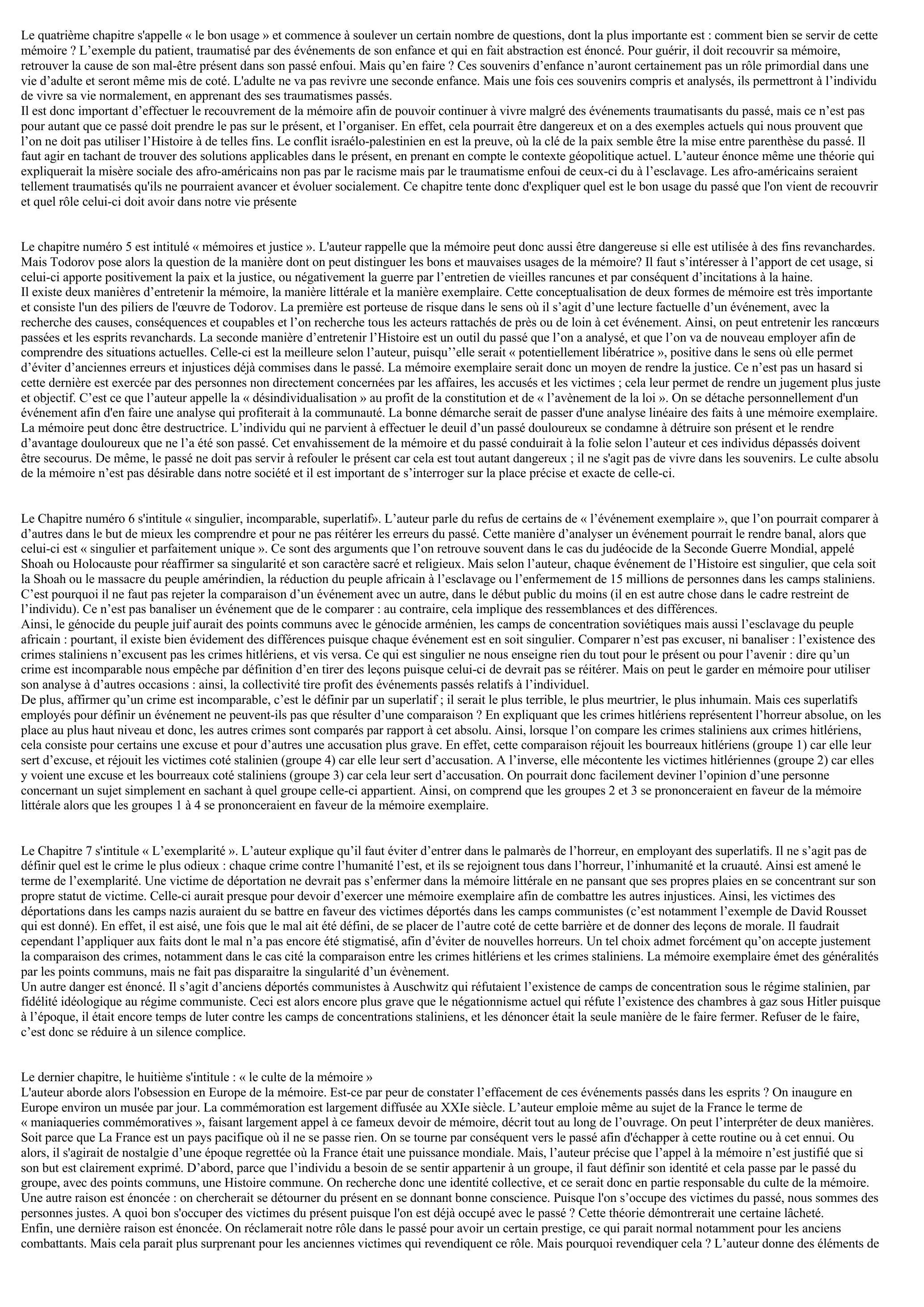Les abus de la mémoire de Tzvetan Todorov
Publié le 05/09/2012
Extrait du document
Nous pouvons cependant retenir que la réflexion de Todorov menée tout au long de cet ouvrage est passionnante. L’auteur la mène pourtant de manière relativement simple et ce livre n’est pas adressé qu’aux universitaires, philosophes ou historien : il est en effet accessible à tous, et destinés à tous. Les notions de mémoires exemplaires et linéaires sont très bien définies et apparaissent finalement comme très importantes à assimiler. Il ne s’agit pas d’un concept très simple, et pourtant, on le comprend de manière aisée puisque l’explication est très bien menée. Ainsi, la simplicité de ses propos ne signifie pas simplicité d’idée. Bien au contraire, tout l’ouvrage semble cohérent, et pourtant, on note le mérite d’avoir réussi à conceptualiser cette idée de bon usage de la mémoire sans pour autant susciter de polémiques ou de maladresses. On peut cependant regretter le trop petit nombre de pages de cet ouvrage. Le sujet intéresse au point que l’on regrette qu’il soit si court. Mais, on peut se dire que ce genre d’ouvrages brefs lançant des idées précises et fortes marque d’avantage les esprits. On peut à cet égard citer l’exemple du très médiatisé Indignez Vous ! de Stéphane Hessel. Mais on peut de même regretter le manque « d’engagement « de la part de l’auteur qui ne dénonce finalement pas de faits très concrets afin d’éviter la polémique. La même critique qu’il émet au sujet de ceux qui se concentrent uniquement sur le passé et non sur le présent pourrait lui être à son tour adressée. En effet, il dénonce énormément des événements du passé, mais il semble délaisser un peu les débats et les événements présents. C’est certainement sa carrière d’historien qui prend alors le dessus sur son analyse et non une certaine « lâcheté «. Mais toutefois, des références plus concrètes à l’actualité pourraient manquer à cet ouvrage.
«
Le quatrième chapitre s'appelle « le bon usage » et commence à soulever un certain nombre de questions, dont la plus importante est : comment bien se servir de cettemémoire ? L’exemple du patient, traumatisé par des événements de son enfance et qui en fait abstraction est énoncé.
Pour guérir, il doit recouvrir sa mémoire,retrouver la cause de son mal-être présent dans son passé enfoui.
Mais qu’en faire ? Ces souvenirs d’enfance n’auront certainement pas un rôle primordial dans unevie d’adulte et seront même mis de coté.
L'adulte ne va pas revivre une seconde enfance.
Mais une fois ces souvenirs compris et analysés, ils permettront à l’individude vivre sa vie normalement, en apprenant des ses traumatismes passés.Il est donc important d’effectuer le recouvrement de la mémoire afin de pouvoir continuer à vivre malgré des événements traumatisants du passé, mais ce n’est paspour autant que ce passé doit prendre le pas sur le présent, et l’organiser.
En effet, cela pourrait être dangereux et on a des exemples actuels qui nous prouvent quel’on ne doit pas utiliser l’Histoire à de telles fins.
Le conflit israélo-palestinien en est la preuve, où la clé de la paix semble être la mise entre parenthèse du passé.
Ilfaut agir en tachant de trouver des solutions applicables dans le présent, en prenant en compte le contexte géopolitique actuel.
L’auteur énonce même une théorie quiexpliquerait la misère sociale des afro-américains non pas par le racisme mais par le traumatisme enfoui de ceux-ci du à l’esclavage.
Les afro-américains seraienttellement traumatisés qu'ils ne pourraient avancer et évoluer socialement.
Ce chapitre tente donc d'expliquer quel est le bon usage du passé que l'on vient de recouvriret quel rôle celui-ci doit avoir dans notre vie présente
Le chapitre numéro 5 est intitulé « mémoires et justice ».
L'auteur rappelle que la mémoire peut donc aussi être dangereuse si elle est utilisée à des fins revanchardes.Mais Todorov pose alors la question de la manière dont on peut distinguer les bons et mauvaises usages de la mémoire? Il faut s’intéresser à l’apport de cet usage, sicelui-ci apporte positivement la paix et la justice, ou négativement la guerre par l’entretien de vieilles rancunes et par conséquent d’incitations à la haine.Il existe deux manières d’entretenir la mémoire, la manière littérale et la manière exemplaire.
Cette conceptualisation de deux formes de mémoire est très importanteet consiste l'un des piliers de l'œuvre de Todorov.
La première est porteuse de risque dans le sens où il s’agit d’une lecture factuelle d’un événement, avec larecherche des causes, conséquences et coupables et l’on recherche tous les acteurs rattachés de près ou de loin à cet événement.
Ainsi, on peut entretenir les rancœurspassées et les esprits revanchards.
La seconde manière d’entretenir l’Histoire est un outil du passé que l’on a analysé, et que l’on va de nouveau employer afin decomprendre des situations actuelles.
Celle-ci est la meilleure selon l’auteur, puisqu’’elle serait « potentiellement libératrice », positive dans le sens où elle permetd’éviter d’anciennes erreurs et injustices déjà commises dans le passé.
La mémoire exemplaire serait donc un moyen de rendre la justice.
Ce n’est pas un hasard sicette dernière est exercée par des personnes non directement concernées par les affaires, les accusés et les victimes ; cela leur permet de rendre un jugement plus justeet objectif.
C’est ce que l’auteur appelle la « désindividualisation » au profit de la constitution et de « l’avènement de la loi ».
On se détache personnellement d'unévénement afin d'en faire une analyse qui profiterait à la communauté.
La bonne démarche serait de passer d'une analyse linéaire des faits à une mémoire exemplaire.La mémoire peut donc être destructrice.
L’individu qui ne parvient à effectuer le deuil d’un passé douloureux se condamne à détruire son présent et le rendred’avantage douloureux que ne l’a été son passé.
Cet envahissement de la mémoire et du passé conduirait à la folie selon l’auteur et ces individus dépassés doiventêtre secourus.
De même, le passé ne doit pas servir à refouler le présent car cela est tout autant dangereux ; il ne s'agit pas de vivre dans les souvenirs.
Le culte absolude la mémoire n’est pas désirable dans notre société et il est important de s’interroger sur la place précise et exacte de celle-ci.
Le Chapitre numéro 6 s'intitule « singulier, incomparable, superlatif».
L’auteur parle du refus de certains de « l’événement exemplaire », que l’on pourrait comparer àd’autres dans le but de mieux les comprendre et pour ne pas réitérer les erreurs du passé.
Cette manière d’analyser un événement pourrait le rendre banal, alors quecelui-ci est « singulier et parfaitement unique ».
Ce sont des arguments que l’on retrouve souvent dans le cas du judéocide de la Seconde Guerre Mondial, appeléShoah ou Holocauste pour réaffirmer sa singularité et son caractère sacré et religieux.
Mais selon l’auteur, chaque événement de l’Histoire est singulier, que cela soitla Shoah ou le massacre du peuple amérindien, la réduction du peuple africain à l’esclavage ou l’enfermement de 15 millions de personnes dans les camps staliniens.C’est pourquoi il ne faut pas rejeter la comparaison d’un événement avec un autre, dans le début public du moins (il en est autre chose dans le cadre restreint del’individu).
Ce n’est pas banaliser un événement que de le comparer : au contraire, cela implique des ressemblances et des différences.Ainsi, le génocide du peuple juif aurait des points communs avec le génocide arménien, les camps de concentration soviétiques mais aussi l’esclavage du peupleafricain : pourtant, il existe bien évidement des différences puisque chaque événement est en soit singulier.
Comparer n’est pas excuser, ni banaliser : l’existence descrimes staliniens n’excusent pas les crimes hitlériens, et vis versa.
Ce qui est singulier ne nous enseigne rien du tout pour le présent ou pour l’avenir : dire qu’uncrime est incomparable nous empêche par définition d’en tirer des leçons puisque celui-ci de devrait pas se réitérer.
Mais on peut le garder en mémoire pour utiliserson analyse à d’autres occasions : ainsi, la collectivité tire profit des événements passés relatifs à l’individuel.De plus, affirmer qu’un crime est incomparable, c’est le définir par un superlatif ; il serait le plus terrible, le plus meurtrier, le plus inhumain.
Mais ces superlatifsemployés pour définir un événement ne peuvent-ils pas que résulter d’une comparaison ? En expliquant que les crimes hitlériens représentent l’horreur absolue, on lesplace au plus haut niveau et donc, les autres crimes sont comparés par rapport à cet absolu.
Ainsi, lorsque l’on compare les crimes staliniens aux crimes hitlériens,cela consiste pour certains une excuse et pour d’autres une accusation plus grave.
En effet, cette comparaison réjouit les bourreaux hitlériens (groupe 1) car elle leursert d’excuse, et réjouit les victimes coté stalinien (groupe 4) car elle leur sert d’accusation.
A l’inverse, elle mécontente les victimes hitlériennes (groupe 2) car ellesy voient une excuse et les bourreaux coté staliniens (groupe 3) car cela leur sert d’accusation.
On pourrait donc facilement deviner l’opinion d’une personneconcernant un sujet simplement en sachant à quel groupe celle-ci appartient.
Ainsi, on comprend que les groupes 2 et 3 se prononceraient en faveur de la mémoirelittérale alors que les groupes 1 à 4 se prononceraient en faveur de la mémoire exemplaire.
Le Chapitre 7 s'intitule « L’exemplarité ».
L’auteur explique qu’il faut éviter d’entrer dans le palmarès de l’horreur, en employant des superlatifs.
Il ne s’agit pas dedéfinir quel est le crime le plus odieux : chaque crime contre l’humanité l’est, et ils se rejoignent tous dans l’horreur, l’inhumanité et la cruauté.
Ainsi est amené leterme de l’exemplarité.
Une victime de déportation ne devrait pas s’enfermer dans la mémoire littérale en ne pansant que ses propres plaies en se concentrant sur sonpropre statut de victime.
Celle-ci aurait presque pour devoir d’exercer une mémoire exemplaire afin de combattre les autres injustices.
Ainsi, les victimes desdéportations dans les camps nazis auraient du se battre en faveur des victimes déportés dans les camps communistes (c’est notamment l’exemple de David Roussetqui est donné).
En effet, il est aisé, une fois que le mal ait été défini, de se placer de l’autre coté de cette barrière et de donner des leçons de morale.
Il faudraitcependant l’appliquer aux faits dont le mal n’a pas encore été stigmatisé, afin d’éviter de nouvelles horreurs.
Un tel choix admet forcément qu’on accepte justementla comparaison des crimes, notamment dans le cas cité la comparaison entre les crimes hitlériens et les crimes staliniens.
La mémoire exemplaire émet des généralitéspar les points communs, mais ne fait pas disparaitre la singularité d’un évènement.Un autre danger est énoncé.
Il s’agit d’anciens déportés communistes à Auschwitz qui réfutaient l’existence de camps de concentration sous le régime stalinien, parfidélité idéologique au régime communiste.
Ceci est alors encore plus grave que le négationnisme actuel qui réfute l’existence des chambres à gaz sous Hitler puisqueà l’époque, il était encore temps de luter contre les camps de concentrations staliniens, et les dénoncer était la seule manière de le faire fermer.
Refuser de le faire,c’est donc se réduire à un silence complice.
Le dernier chapitre, le huitième s'intitule : « le culte de la mémoire »L'auteur aborde alors l'obsession en Europe de la mémoire.
Est-ce par peur de constater l’effacement de ces événements passés dans les esprits ? On inaugure enEurope environ un musée par jour.
La commémoration est largement diffusée au XXIe siècle.
L’auteur emploie même au sujet de la France le terme de« maniaqueries commémoratives », faisant largement appel à ce fameux devoir de mémoire, décrit tout au long de l’ouvrage.
On peut l’interpréter de deux manières.Soit parce que La France est un pays pacifique où il ne se passe rien.
On se tourne par conséquent vers le passé afin d'échapper à cette routine ou à cet ennui.
Oualors, il s'agirait de nostalgie d’une époque regrettée où la France était une puissance mondiale.
Mais, l’auteur précise que l’appel à la mémoire n’est justifié que sison but est clairement exprimé.
D’abord, parce que l’individu a besoin de se sentir appartenir à un groupe, il faut définir son identité et cela passe par le passé dugroupe, avec des points communs, une Histoire commune.
On recherche donc une identité collective, et ce serait donc en partie responsable du culte de la mémoire.Une autre raison est énoncée : on chercherait se détourner du présent en se donnant bonne conscience.
Puisque l'on s’occupe des victimes du passé, nous sommes despersonnes justes.
A quoi bon s'occuper des victimes du présent puisque l'on est déjà occupé avec le passé ? Cette théorie démontrerait une certaine lâcheté.Enfin, une dernière raison est énoncée.
On réclamerait notre rôle dans le passé pour avoir un certain prestige, ce qui parait normal notamment pour les ancienscombattants.
Mais cela parait plus surprenant pour les anciennes victimes qui revendiquent ce rôle.
Mais pourquoi revendiquer cela ? L’auteur donne des éléments de.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Todorov Tzvetan, né en 1939, à Sofia, critique littéraire français d'origine bulgare.
- Tzvetan Todorov
- Todorov, Tzvetan - littérature.
- TODOROV (Tzvetan)
- « Une Thèse Nous Traverse, Une Histoire Nous Habite » (Tzvetan Todorov)