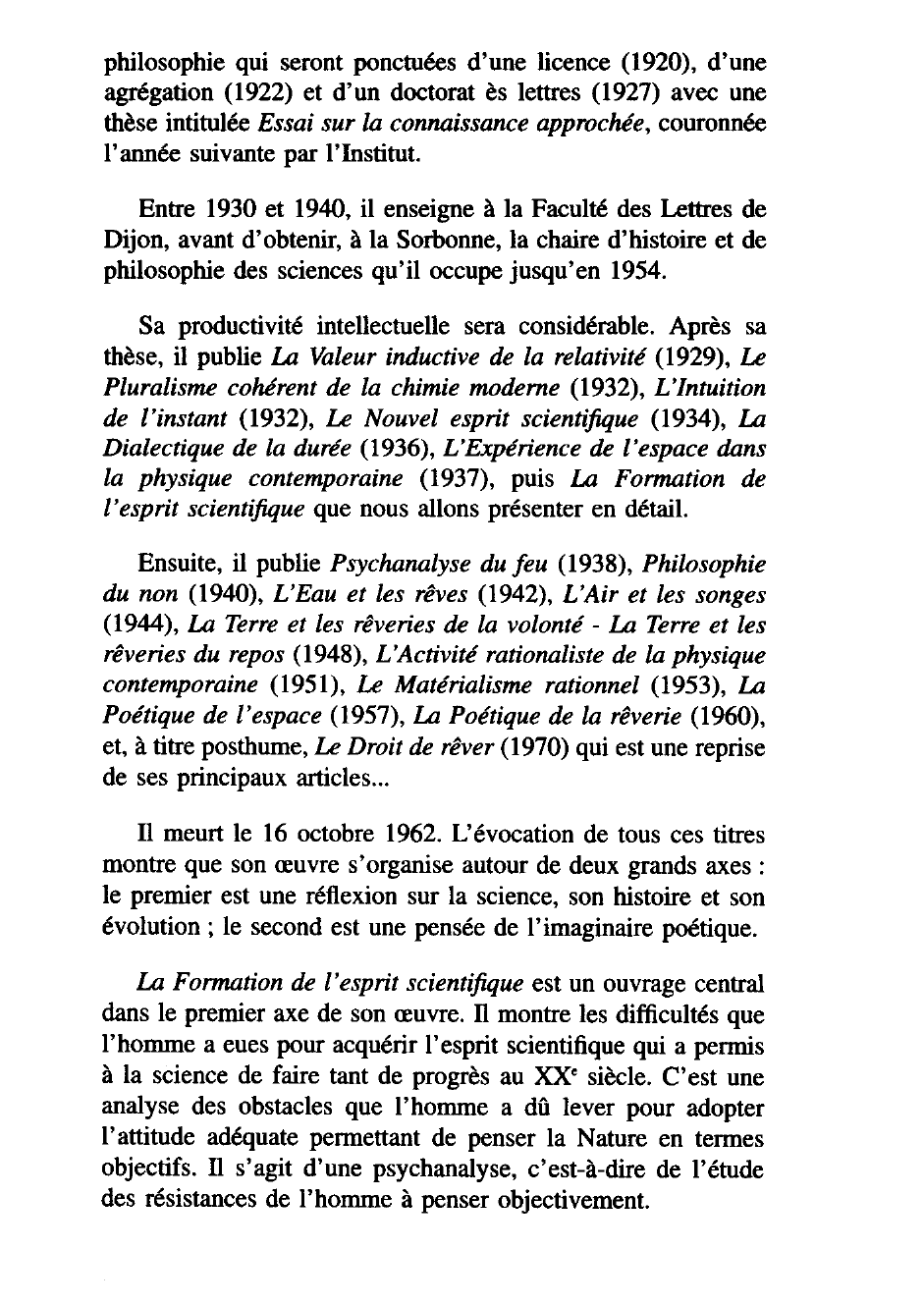Gaston BACHELARD 1884-1962 La Formation de l'esprit scientifique : contribution à une psychanalyse de la connaissance objective
Publié le 01/04/2015

Extrait du document
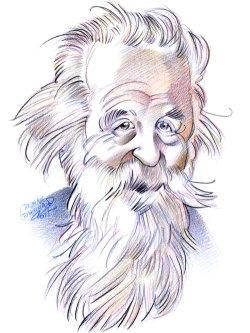
Bachelard met en garde contre deux autres obstacles de la connaissance scientifique : les systèmes explicatifs philosophiques, vision générale du monde, comme la Nature au XVIII` siècle, ou la présupposition d'une structure générale qui serait transposable d'un domaine à un autre domaine, par exemple les analogies que certains auteurs ont pu établir entre la cosmologie et la structure des métaux.
Il faut être attentif à ces surdéterminations qui sont très nombreuses dans l'histoire de la formation de l'esprit scientifique.
Parmi ces surdéterminations : le naturel, l'utilité, le postulat d'une unité explicative (l'électricité vers 1780)...
L'obstacle substantialiste (ou réaliste) est l'un des plus archaïques et donc l'un des plus complexes qui empêche d'accéder à la connaissance scientifique.
constant à la substance, c'est-à-dire au «mythe de l'intérieur« ou au «mythe plus profond de l'intime«.
« Bachelard donne l'exemple du sel : au XVII siècle on le voit partout : «Si le sel était extrait des poutres, solives et chevrons, le tout tomberait en poudre.
II soumet cette attitude à une psychanalyse du «sentiment de l'avoir« ou «complexe d'Harpagon«.
L'obstacle animiste, auquel le livre consacre tout le chapitre 8, en est le fondement naturel.
Il consiste à imposer inconsciemment le modèle privilégié du corps humain à l'ensemble des phénomènes naturels.
Bachelard montre, par exemple, comment la digestion commande l'histoire des explications chimiques et biologiques (chapitre 9).
Mais le mythe de la génération est plus irréductible encore.
L'acide, par exemple, actif, joue le rôle masculin.
La base, passive, joue le rôle féminin.
Que le produit soit un sel neutre n'est pas sans inquiéter le bon sens immédiat qui ne connaît qu'un seul partage : Boerhaave ne parlait-il pas encore au XVIII siècle de «sels hermaphrodites«?
Cette projection de la libido sur les faits objectifs est constante dans l'histoire de la science, qui a cru voir une sexualité des minéraux, par exemple.
Cela vient du fait que l'homme se projette dans la nature.
Il voit le monde à travers «sa lourde charge d'ancestralité et d'inconscience«.
Ils ne font rien pour guérir l'anxiété qui saisit tout esprit devant la nécessité de corriger sa propre pensée et de sortir de soi pour trouver la vérité objective.
Dans le domaine des connaissances quantitatives, nombreux sont les pièges, les obstacles à la formation de l'esprit scientifique.
On se tromperait d'ailleurs si l'on pensait qu'une connaissance quantitative échappe en principe aux dangers de la connaissance qualitative.
La grandeur n'est pas automatiquement objective et il suffit de quitter les objets usuels pour qu'on accueille les déterminations géométriques les plus fantaisistes.
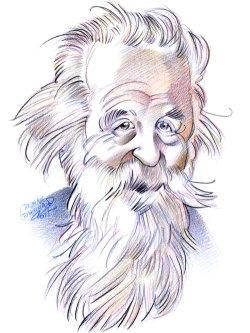
«
330 • Gaston Bachelard
philosophie qui seront ponctuées d'une licence (1920), d'une
agrégation (1922) et
d'un doctorat ès lettres (1927) avec une
thèse intitulée Essai sur la connaissance approchée, couronnée
l'année suivante par l'Institut.
Entre
1930 et 1940, il enseigne à la Faculté des Lettres de
Dijon, avant d'obtenir, à la Sorbonne, la chaire d'histoire et de
philosophie des sciences qu'il occupe jusqu'en 1954.
Sa productivité intellectuelle sera considérable.
Après sa
thèse,
il publie La Valeur inductive de la relativité (1929), Le
Pluralisme cohérent de la chimie moderne (1932), L'intuition
de l'instant (1932),
Le Nouvel esprit scientifique (1934), La
Dialectique de la durée (1936), L'Expérience de l'espace dans
la physique contemporaine (1937), puis
La Formation de
l'esprit scientifique que nous allons présenter en détail.
Ensuite, il publie Psychanalyse
du feu (1938), Philosophie
du non
(1940), L'Eau et les rêves (1942), L'Air et les songes
(1944),
La Terre et les rêveries de la volonté - La Terre et les
rêveries du repos (1948), L'Activité rationaliste de la physique
contemporaine (1951),
Le Matérialisme rationnel (1953), La
Poétique de l'espace (1957), La Poétique de la rêverie (1960),
et, à titre posthume, Le Droit de rêver (1970) qui est une reprise
de ses principaux articles
...
Il meurt le 16 octobre 1962.
L'évocation de tous ces titres
montre que son œuvre s'organise autour de deux grands
axes:
le premier est une réflexion sur la science, son histoire et son
évolution; le second est une pensée de l'imaginaire poétique.
La Formation de l'esprit scientifique est un ouvrage central
dans le premier axe de son œuvre.
Il montre les difficultés que
l'homme a eues pour acquérir l'esprit scientifique qui a permis
à la science de faire tant de progrès au
XX' siècle.
C'est une
analyse des obstacles que l'homme a dû lever pour adopter
l'attitude adéquate permettant de penser la Nature en termes
objectifs.
Il s'agit d'une psychanalyse, c'est-à-dire de l'étude
des résistances de l'homme à penser objectivement..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- BACHELARD, Gaston (1884-1962) Philosophe, il analyse les conditions de la connaissance scientifique : le Nouvel Esprit scientifique (1934), L'Eau et les Rêves (1941).
- FORMATION DE L’ESPRIT SCIENTIFIQUE (LA). Gaston Bachelard
- Analyse de texte Gaston Bachelard "Formation de l'esprit scientifique"
- Gaston Bachelard, la Formation de l’esprit scientifique
- Explication de texte: Gaston Bachelard – La Formation de l'esprit scientifique: « Une expérience scientifique est alors une expérience qui contredit l'expérience commune. »