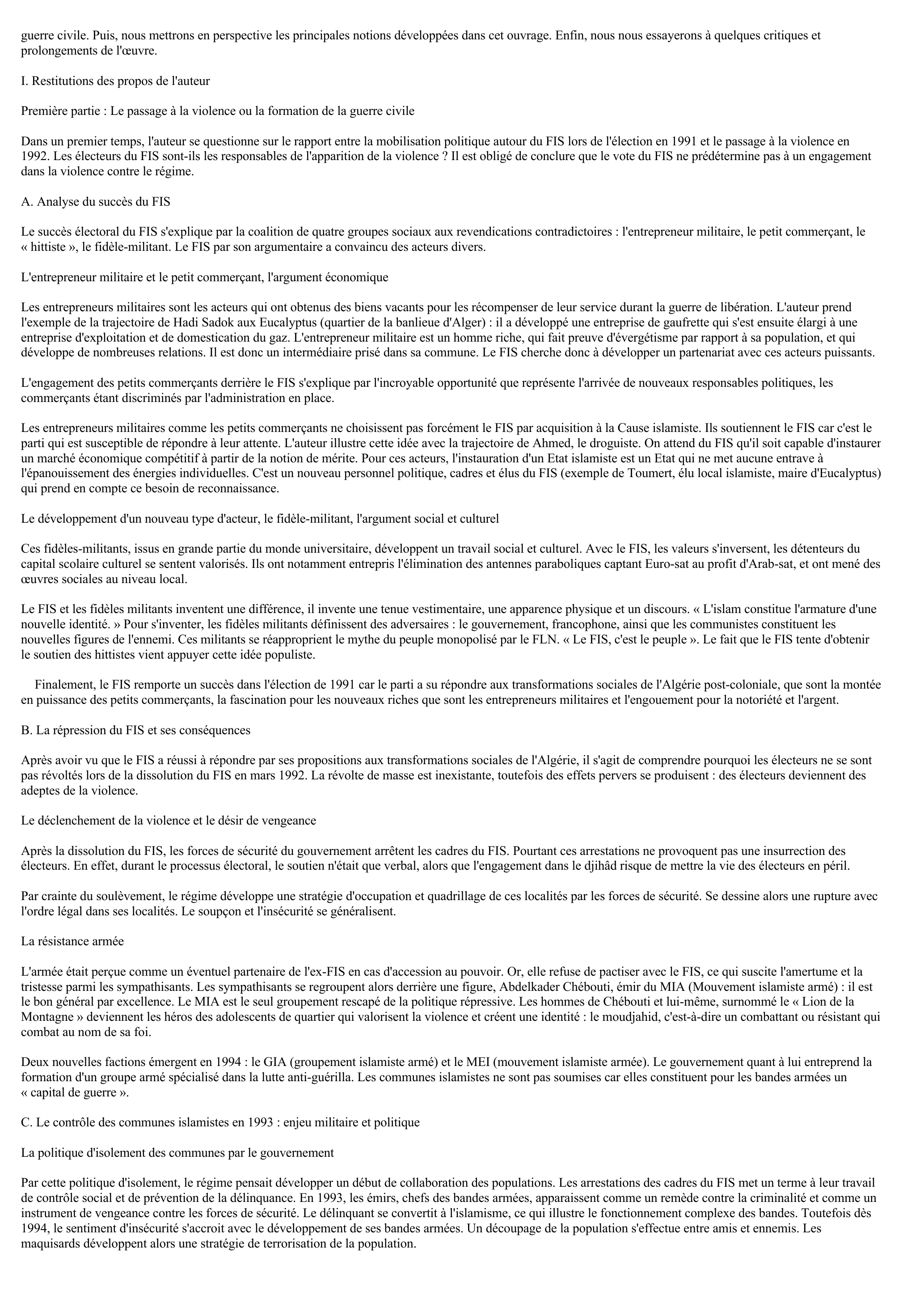FICHE DE LECTURE Luis Martinez, La guerre civile en Algérie
Publié le 01/09/2012
Extrait du document
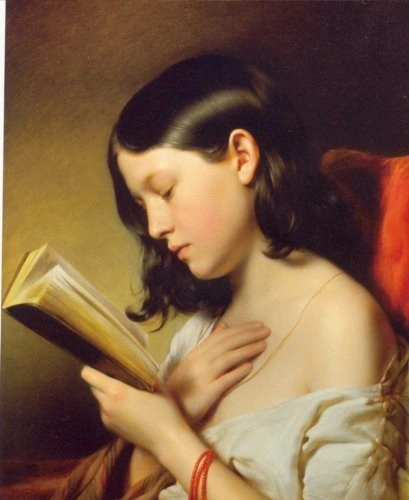
Le beylicat était une oligarchie militaire où les provinces s’organisaient chacune de leur côté. Il s’agit de comprendre la situation actuelle de l’Algérie, en puisant dans son passé. Il s’agit de voir que les « différentes formes d’opposition constituent des pratiques de négociation avec le pouvoir. « L’exploitation de la guerre civile par les protagonistes L’exploitation par le pouvoir se fait sur trois terrains différents : - Le FMI qui finance l’appareil de guerre et la politique économique de guerre. - La France qui paye par peur de l’instauration d’une dictature islamiste. - Les sociétés internationales privées qui investissent dans le secteur des hydrocarbures. Pour les élites guerrières, maquisards et militaires, cette guerre leur permet de développer des opportunités d’accumulation de richesses et de prestige. La guerre est pour eux une sorte d’école du pouvoir, un instrument d’ascension sociale. La fusion des élites ? Pour les élites islamistes, la situation est différente. Paradoxalement, elles aspirent à la restauration de l’Etat, car il leur permet une existence. L’auteur avance l’hypothèse de la fusion des élites islamistes et maquisards, en s’appuyant sur le passé de l’Algérie qui a eu tendance à insérer les dissidents islamistes au sein du régime. L’hypothèse des émirs et des élites islamistes intégrés au sein du régime constitue un avantage pour ce dernier, car les émirs sont les agents du contrôle social, et cela permettrait d’intégrer de nouvelles formes de clientélisme au pouvoir. La notion d’ennemi complémentaire Maquisards et militaires se retrouvent très proche après cinq ans de guerre civile. Ils partagent la même perception du pouvoir et des moyens de l’accaparer. Ils sont ennemis complémentaires car les actions des uns avantagent celles des autres bien souvent.
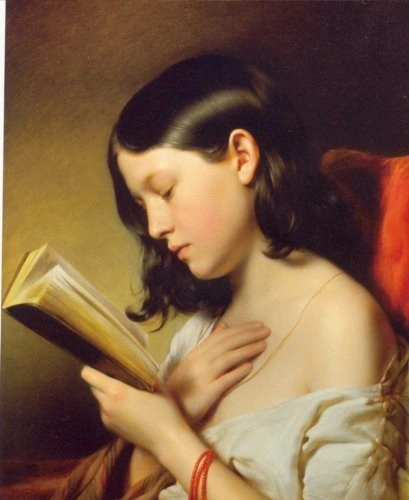
«
guerre civile.
Puis, nous mettrons en perspective les principales notions développées dans cet ouvrage.
Enfin, nous nous essayerons à quelques critiques etprolongements de l'œuvre.
I.
Restitutions des propos de l'auteur
Première partie : Le passage à la violence ou la formation de la guerre civile
Dans un premier temps, l'auteur se questionne sur le rapport entre la mobilisation politique autour du FIS lors de l'élection en 1991 et le passage à la violence en1992.
Les électeurs du FIS sont-ils les responsables de l'apparition de la violence ? Il est obligé de conclure que le vote du FIS ne prédétermine pas à un engagementdans la violence contre le régime.
A.
Analyse du succès du FIS
Le succès électoral du FIS s'explique par la coalition de quatre groupes sociaux aux revendications contradictoires : l'entrepreneur militaire, le petit commerçant, le« hittiste », le fidèle-militant.
Le FIS par son argumentaire a convaincu des acteurs divers.
L'entrepreneur militaire et le petit commerçant, l'argument économique
Les entrepreneurs militaires sont les acteurs qui ont obtenus des biens vacants pour les récompenser de leur service durant la guerre de libération.
L'auteur prendl'exemple de la trajectoire de Hadi Sadok aux Eucalyptus (quartier de la banlieue d'Alger) : il a développé une entreprise de gaufrette qui s'est ensuite élargi à uneentreprise d'exploitation et de domestication du gaz.
L'entrepreneur militaire est un homme riche, qui fait preuve d'évergétisme par rapport à sa population, et quidéveloppe de nombreuses relations.
Il est donc un intermédiaire prisé dans sa commune.
Le FIS cherche donc à développer un partenariat avec ces acteurs puissants.
L'engagement des petits commerçants derrière le FIS s'explique par l'incroyable opportunité que représente l'arrivée de nouveaux responsables politiques, lescommerçants étant discriminés par l'administration en place.
Les entrepreneurs militaires comme les petits commerçants ne choisissent pas forcément le FIS par acquisition à la Cause islamiste.
Ils soutiennent le FIS car c'est leparti qui est susceptible de répondre à leur attente.
L'auteur illustre cette idée avec la trajectoire de Ahmed, le droguiste.
On attend du FIS qu'il soit capable d'instaurerun marché économique compétitif à partir de la notion de mérite.
Pour ces acteurs, l'instauration d'un Etat islamiste est un Etat qui ne met aucune entrave àl'épanouissement des énergies individuelles.
C'est un nouveau personnel politique, cadres et élus du FIS (exemple de Toumert, élu local islamiste, maire d'Eucalyptus)qui prend en compte ce besoin de reconnaissance.
Le développement d'un nouveau type d'acteur, le fidèle-militant, l'argument social et culturel
Ces fidèles-militants, issus en grande partie du monde universitaire, développent un travail social et culturel.
Avec le FIS, les valeurs s'inversent, les détenteurs ducapital scolaire culturel se sentent valorisés.
Ils ont notamment entrepris l'élimination des antennes paraboliques captant Euro-sat au profit d'Arab-sat, et ont mené desœuvres sociales au niveau local.
Le FIS et les fidèles militants inventent une différence, il invente une tenue vestimentaire, une apparence physique et un discours.
« L'islam constitue l'armature d'unenouvelle identité.
» Pour s'inventer, les fidèles militants définissent des adversaires : le gouvernement, francophone, ainsi que les communistes constituent lesnouvelles figures de l'ennemi.
Ces militants se réapproprient le mythe du peuple monopolisé par le FLN.
« Le FIS, c'est le peuple ».
Le fait que le FIS tente d'obtenirle soutien des hittistes vient appuyer cette idée populiste.
Finalement, le FIS remporte un succès dans l'élection de 1991 car le parti a su répondre aux transformations sociales de l'Algérie post-coloniale, que sont la montéeen puissance des petits commerçants, la fascination pour les nouveaux riches que sont les entrepreneurs militaires et l'engouement pour la notoriété et l'argent.
B.
La répression du FIS et ses conséquences
Après avoir vu que le FIS a réussi à répondre par ses propositions aux transformations sociales de l'Algérie, il s'agit de comprendre pourquoi les électeurs ne se sontpas révoltés lors de la dissolution du FIS en mars 1992.
La révolte de masse est inexistante, toutefois des effets pervers se produisent : des électeurs deviennent desadeptes de la violence.
Le déclenchement de la violence et le désir de vengeance
Après la dissolution du FIS, les forces de sécurité du gouvernement arrêtent les cadres du FIS.
Pourtant ces arrestations ne provoquent pas une insurrection desélecteurs.
En effet, durant le processus électoral, le soutien n'était que verbal, alors que l'engagement dans le djihâd risque de mettre la vie des électeurs en péril.
Par crainte du soulèvement, le régime développe une stratégie d'occupation et quadrillage de ces localités par les forces de sécurité.
Se dessine alors une rupture avecl'ordre légal dans ses localités.
Le soupçon et l'insécurité se généralisent.
La résistance armée
L'armée était perçue comme un éventuel partenaire de l'ex-FIS en cas d'accession au pouvoir.
Or, elle refuse de pactiser avec le FIS, ce qui suscite l'amertume et latristesse parmi les sympathisants.
Les sympathisants se regroupent alors derrière une figure, Abdelkader Chébouti, émir du MIA (Mouvement islamiste armé) : il estle bon général par excellence.
Le MIA est le seul groupement rescapé de la politique répressive.
Les hommes de Chébouti et lui-même, surnommé le « Lion de laMontagne » deviennent les héros des adolescents de quartier qui valorisent la violence et créent une identité : le moudjahid, c'est-à-dire un combattant ou résistant quicombat au nom de sa foi.
Deux nouvelles factions émergent en 1994 : le GIA (groupement islamiste armé) et le MEI (mouvement islamiste armée).
Le gouvernement quant à lui entreprend laformation d'un groupe armé spécialisé dans la lutte anti-guérilla.
Les communes islamistes ne sont pas soumises car elles constituent pour les bandes armées un« capital de guerre ».
C.
Le contrôle des communes islamistes en 1993 : enjeu militaire et politique
La politique d'isolement des communes par le gouvernement
Par cette politique d'isolement, le régime pensait développer un début de collaboration des populations.
Les arrestations des cadres du FIS met un terme à leur travailde contrôle social et de prévention de la délinquance.
En 1993, les émirs, chefs des bandes armées, apparaissent comme un remède contre la criminalité et comme uninstrument de vengeance contre les forces de sécurité.
Le délinquant se convertit à l'islamisme, ce qui illustre le fonctionnement complexe des bandes.
Toutefois dès1994, le sentiment d'insécurité s'accroit avec le développement de ses bandes armées.
Un découpage de la population s'effectue entre amis et ennemis.
Lesmaquisards développent alors une stratégie de terrorisation de la population..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La guerre de Troie n 'aura pas lieu : Fiche de lecture
- La guerre de Troie n'aura pas lieu [Jean Giraudoux] - Fiche de lecture.
- Solitudes [Luis de Góngora] - Fiche de lecture.
- Guerre et la Paix, la [Léon Tolstoï] - Fiche de lecture.
- Pièces de guerre [Edward Bond] - Fiche de lecture.