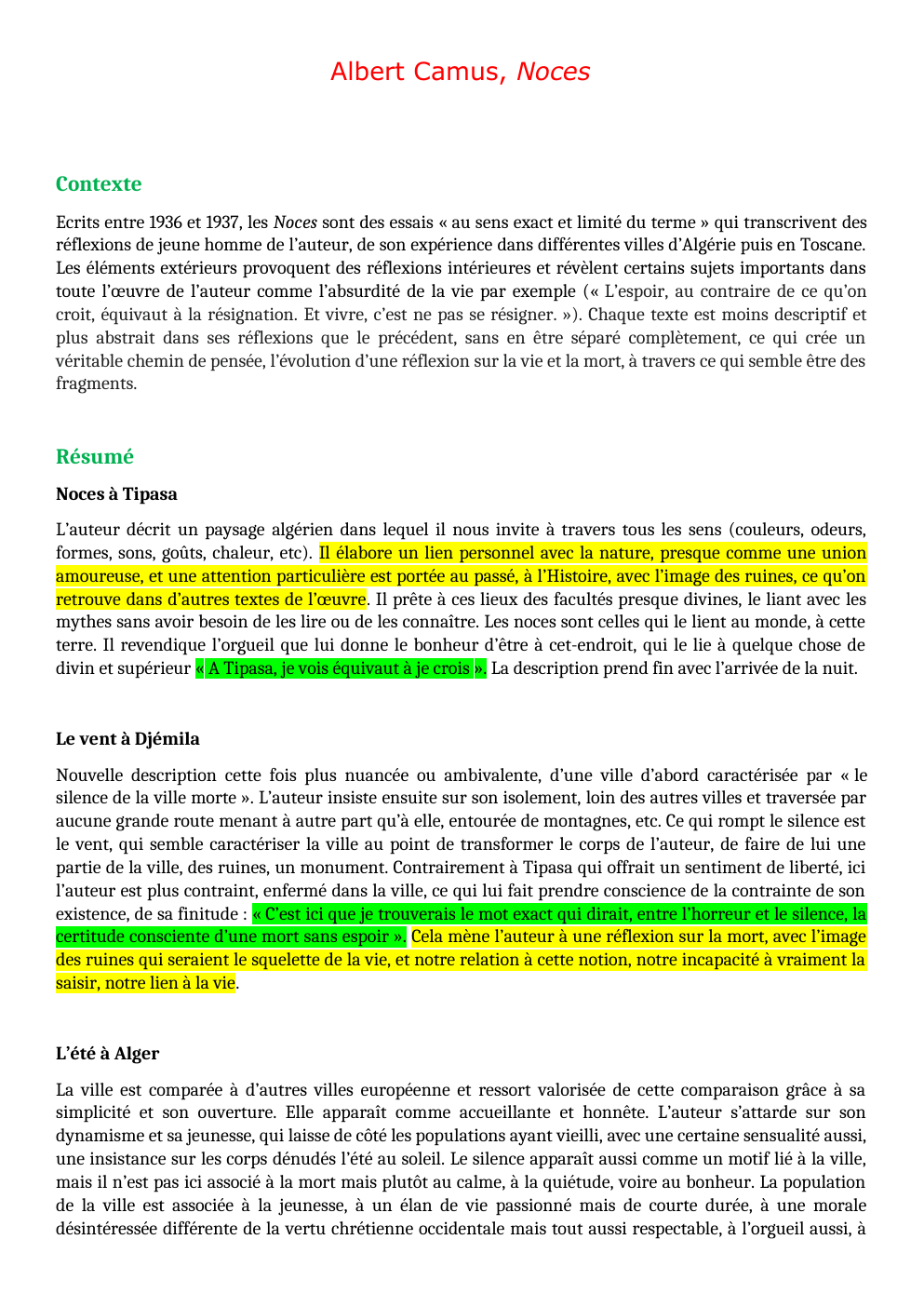Fiche de lecture Camus, Noces suivi de L'Eté
Publié le 10/01/2023
Extrait du document
«
Albert Camus, Noces
Contexte
Ecrits entre 1936 et 1937, les Noces sont des essais « au sens exact et limité du terme » qui transcrivent des
réflexions de jeune homme de l’auteur, de son expérience dans différentes villes d’Algérie puis en Toscane.
Les éléments extérieurs provoquent des réflexions intérieures et révèlent certains sujets importants dans
toute l’œuvre de l’auteur comme l’absurdité de la vie par exemple (« L’espoir, au contraire de ce qu’on
croit, équivaut à la résignation.
Et vivre, c’est ne pas se résigner.
»).
Chaque texte est moins descriptif et
plus abstrait dans ses réflexions que le précédent, sans en être séparé complètement, ce qui crée un
véritable chemin de pensée, l’évolution d’une réflexion sur la vie et la mort, à travers ce qui semble être des
fragments.
Résumé
Noces à Tipasa
L’auteur décrit un paysage algérien dans lequel il nous invite à travers tous les sens (couleurs, odeurs,
formes, sons, goûts, chaleur, etc).
Il élabore un lien personnel avec la nature, presque comme une union
amoureuse, et une attention particulière est portée au passé, à l’Histoire, avec l’image des ruines, ce qu’on
retrouve dans d’autres textes de l’œuvre.
Il prête à ces lieux des facultés presque divines, le liant avec les
mythes sans avoir besoin de les lire ou de les connaître.
Les noces sont celles qui le lient au monde, à cette
terre.
Il revendique l’orgueil que lui donne le bonheur d’être à cet-endroit, qui le lie à quelque chose de
divin et supérieur « A Tipasa, je vois équivaut à je crois ».
La description prend fin avec l’arrivée de la nuit.
Le vent à Djémila
Nouvelle description cette fois plus nuancée ou ambivalente, d’une ville d’abord caractérisée par « le
silence de la ville morte ».
L’auteur insiste ensuite sur son isolement, loin des autres villes et traversée par
aucune grande route menant à autre part qu’à elle, entourée de montagnes, etc.
Ce qui rompt le silence est
le vent, qui semble caractériser la ville au point de transformer le corps de l’auteur, de faire de lui une
partie de la ville, des ruines, un monument.
Contrairement à Tipasa qui offrait un sentiment de liberté, ici
l’auteur est plus contraint, enfermé dans la ville, ce qui lui fait prendre conscience de la contrainte de son
existence, de sa finitude : « C’est ici que je trouverais le mot exact qui dirait, entre l’horreur et le silence, la
certitude consciente d’une mort sans espoir ».
Cela mène l’auteur à une réflexion sur la mort, avec l’image
des ruines qui seraient le squelette de la vie, et notre relation à cette notion, notre incapacité à vraiment la
saisir, notre lien à la vie.
L’été à Alger
La ville est comparée à d’autres villes européenne et ressort valorisée de cette comparaison grâce à sa
simplicité et son ouverture.
Elle apparaît comme accueillante et honnête.
L’auteur s’attarde sur son
dynamisme et sa jeunesse, qui laisse de côté les populations ayant vieilli, avec une certaine sensualité aussi,
une insistance sur les corps dénudés l’été au soleil.
Le silence apparaît aussi comme un motif lié à la ville,
mais il n’est pas ici associé à la mort mais plutôt au calme, à la quiétude, voire au bonheur.
La population
de la ville est associée à la jeunesse, à un élan de vie passionné mais de courte durée, à une morale
désintéressée différente de la vertu chrétienne occidentale mais tout aussi respectable, à l’orgueil aussi, à
l’horreur de la mort, l’indifférence à l’esprit par rapport au corps, à la création.
L’auteur exprime un
attachement qui le dépasse à cette terre, une certitude qu’il y peut trouver une unité en lui-même :
« L’Unité s’exprime ici en termes de soleil et de mer ».
A nouveau, aspect cyclique du texte, qui s’achève à la
fin de l’été, avec l’arrivée de la pluie, l’espoir et la « tendresse ».
Le désert
L’auteur parle cette fois de l’Italie, plus précisément de la Toscane.
Il part de tableaux de peintres comme
Giotto ou Piero della Francesca pour tirer des réflexions métaphysiques sur l’immortalité, Dieu, les corps et
les esprits, et montre la similitude entre ces œuvres et la réalité toscane, inscrites toutes deux dans le
présent, dans le corps, donc sans espoir, sans futur, sans esprit.
Cela concerne à la fois la population et les
paysages toscans, bien qu’il faille une réflexion poussée et longue pour arriver à percer le secret de ceux-ci.
L’auteur célèbre la vie à nouveau, préférant Lorenzo, jeune amoureux sur une place, à Roméo, puisque le
premier vit pour l’amour alors que le second meurt pour lui.
Il confère aux fleurs un pouvoir de lier
l’Homme à la terre, ce qui lui fait sentir quelque chose de divin, alors même qu’il est dans un couvent de
franciscains.
« Les mythes sont à la religion ce que la poésie est à la vérité, des masques ridicules posés sur
la passion de vivre ».
Sa vision de la religion est très unique et va à l’encontre de beaucoup d’autres, de
même que sa conception de la morale, et surtout de l’immoralité, qu’il ne condamne pas, et au contraire lie
à la beauté.
Pour lui, le bonheur réside dans le fait de savoir sa finitude, et de savoir aussi son amour de la
vie : « Mais qu’est ce que le bonheur sinon le simple accord entre un être et l’existence qu’il mène ? Et quel
accord plus légitime peut unir l’homme à la vie sinon la double conscience de son désir de durée et son
destin de mort ? ».
Cela mène à apprécier le présent, à le considérer comme la « seule vérité », ce qui
permet de réellement vivre.
Il explicite enfin sa démarche intellectuelle : ces réflexions viennent bien de
son esprit, mais elles ont surgi en Italie, où une si grande beauté n’empêche pas même la mort ou l’espoir :
« Ici encore la vérité doit pourrir et quoi de plus exaltant ? ».
Toutes ces réflexions enfin sont liées à la
terre, elle provoque l’exaltation et la démesure : « Dans ce grand temple déserté par les dieux, toutes mes
idoles ont des pieds d’argile ».
Albert Camus, L’été
Contexte
L’Eté, essais écrits après Noces, et écrits pendant et après la seconde guerre mondiale, soulignent la
progression mentale de l’auteur dans le temps.
Sa vision semble plus sombre par moment, à travers
beaucoup d’ironie, mais plus nuancée et complexe, avec un certain lyrisme.
Il revient sur des paysages qu’il
a déjà évoqués, notamment l’Algérie et l’Italie, dans ce nouveau voyage en méditerranée, mais ne les
appréhende plus de la même façon, tout en gardant le fil d’une réflexion intérieure qui est provoquée par
l’extérieur.
Résumé
Le Minotaure ou La Halte d’Oran, 1939
L’auteur dit chercher la solitude, le silence, pour mieux réfléchir aux Hommes, et ainsi les aider.
Il faut
pour cela aller dans une grande ville, qui par son grand nombre d’habitants vous plonge paradoxalement
dans la solitude.
Mais les villes d’Europe remplissent ce vide social par l’Histoire, la beauté de leurs grands
personnages, leur art, tout ce qui leur est attaché : « Paris est souvent un désert pout le cœur, mais à
certaines heures, du haut du Père-Lachaise, souffle un vent de révolution qui remplit soudain ce désert de
drapeaux et de grandeurs vaincues ».
Le vrai désert, de même, ne permet pas la solitude, car malgré
l’absence totale de populations, il a été rempli de poésies et d’idée, et ne permet plus de ressentir cet
éloignement des Hommes.
C’est pour cela qu’il choisit la ville d’Oran, en Algérie, qui est « sans âme et sans
recours ».
La Rue :
Les rues d’Oran sont pour l’auteur là où réside sa vraie grandeur.
Il parle d’abord des boutiques qui les
bordent, de très mauvais goût selon lui, mais sans aucun regard dévalorisant car il leur prête une
esthétique baroque.
Partout dans la rue, dans les boutiques, les cafés, semblent régner la poussière, et le
sens de l’exagération dans un but commercial, la jeunesse inspirée par des modèles américains.
L’auteur
décrit d’ailleurs l’habitude des jeunes hommes et des jeunes femmes à se retrouver le soir, dans une sorte
de parade de séduction.
Rien d’ « élevé » ne s’y passe, ce qui permet à l’auteur sa solitude.
Le désert à Oran :
L’auteur oppose aux beaux paysages d’Oran ses constructions laides qui forcent la ville à tourner le dos à la
mer.
Il explique aussi comment les oranais préfèrent la beauté de la pierre à celle du monde végétal, au
point qu’ils l’exposent dans les boutiques.
Il explique pourquoi précisément il a choisi Oran pour sa
retraite, car c’est une ville du désert, et qui ne pousse pas à réfléchir, contrairement à d’autres villes comme
Florence ou Athènes, traditionnellement lieux qui forment des esprits et poussent au sens : « Mais
comment s’attendrir sur une ville où rien ne sollicite l’esprit, où la laideur même est anonyme, où le passé
est réduit à rien ? Le vide, l’ennui, un ciel indifférent, quelles sont les séductions de ces lieux ? C’est sans
doute la solitude […] ».
Les Jeux :
L’auteur commence par raconter un match de boxe auquel il a assisté dans un vieux garage au « Central
Sporting Club ».
Il décrit le public, presque exclusivement masculin, dans un état presque animal et
sauvage, la chaleur, la sueur, le bruit.
Il raconte certains combats entre les jeunes espoirs, la rivalité entre
Oran et Alger qui attise des confrontations.
L’auteur laisse entendre sur tout ce passage une sorte d’ironie,
en exagérant l’importance d’un tel combat entre deux jeunes inconnus « C’est donc une page d’histoire qui
se déroule sur le ring ».
Il raconte aussi un combat entre un marin français et un oranais, qui divise la
foule, et se finit en match nul, contrariant le public jusqu’à ce qu’un geste de fair-play des joueurs les
calme.
L’auteur qualifie ces combats de « rites », leur prêtant un aspect religieux et sacré.
Les Monuments :
L’auteur décrit un monument en particulier que se sont construits les oranais eux-mêmes qui est la
Maison du Colon, célébrant leurs vertus.
Il parle ensuite de deux statues de lions faites par un certain Caïn,
dont on dit qu’ils prennent vie le soir.
L’auteur ne prête à ces monuments aucun esprit, ils ne sont pas faits
par l’esprit artistique et ne suscitent aucune réflexion, au point qu’on peut questionner leur statut d’art :
« L’esprit n’y est pour rien et la matière pour beaucoup ».
Ils ne sont pas jugés de manière péjorative pour
autant.
Il qualifie également de monument, en ce qu’ils témoignent d’un aspect de la ville, les grands
travaux sur la côte, qu’il décrit aussi, avec toujours cette insistance sur la pierre, décrite comme éternelle,
et massive, puissante : « Mais aujourd’hui ces amoncellements de rochers témoignent pour les hommes au
masque de poussière et de sueur qui circulent au milieu d’eux.
Les vrais monuments d’Oran, ce sont encore
ses pierres ».
La pierre d’Ariane :
L’auteur parle ici de la permanence de la nature, que les oranais refusent de regarder, enfermés dans
l’enceinte de leurs murs, dos à la mer.
Il décrit toute la nature qui environne la ville, des montagnes à la
mer, des broussailles au vent.
Le paysage le mène à de plus profondes réflexions à nouveau, notamment
religieuses et spirituelles.
Camus parle de la tentation à se connecter avec la nature partout mais aussi avec
le passé et l’Histoire, comme l’indiquent les nombreuses références à l’Antiquité de ce passage, qui apparaît
comme une trahison du monde des Hommes, c’est devenir « rien ».
Pour lui, rejoindre le monde végétal et
minéral a autant de valeur que rester dans le monde humain.
Il fait alors le lien avec le mythe d’Ariane.
Le
fil d’Ariane de la ville, leur salut, c’est cette possibilité d’être connecté à la nature, de sacrifier leur
humanité, de « dire « oui » au Minotaure ».
Toute cette réflexion tient pour lui dans une pierre, prise sur
une falaise de la ville, la pierre d’Ariane.
Les amandiers, 1940
Ces arbres algérois représentent pour l’auteur l’illustration d’une force de caractère et d’une résolution
qu’il faut pour surmonter les horreurs du début du XXe siècle et conserver l’esprit humain.
Il commence
par une réflexion sur l’avancée des technologies militaires, avec l’idée émise par Napoléon que « Il n’y a
que deux puissances au monde : le sabre et l’esprit.
A la longue, le sabre est toujours vaincu par l’esprit ».
Désormais, les armes sont bien plus lourdes et destructrices et soumettent l’esprit.
Camus observe que, les
esprits soumis, les Hommes n’ont plus d’espoir et de foi en eux et en l’Histoire.
Loin de croire en un progrès
de l’humanité, l’auteur pense tout de même que l’Homme connaît et comprend de mieux en mieux sa
condition au fil de l’Histoire, ce qui doit pouvoir lui permettre de persévérer dans la vie, sans désespérer.
Il
dit que notre époque est tragique, mais pas désespérante, sans expliciter la différente.
Nous pouvons
comprendre cette idée avec la citation qu’il fait de Lawrence : « Le tragique devait être un grand coup de
pied donné au malheur ».
Dans une tragédie, les acteurs en connaissent la fin malheureuse, contrairement
au désespoir qui pourrait se définir par l’angoisse d’un futur incertain.
Ainsi, nous savons que nous ne
progressons pas, il ne faudrait alors pas s’en désespérer.
Survient alors l’image des amandiers d’Alger, sur
lesquels la neige tombée une nuit survit aux vents et aux pluies, et qui permet aux amendes de naître.
Pour
sauver l’esprit malgré la force violente du XXe siècle, il faut alors arrêter de désespérer sa perte, et au
contraire exalter la force qui lui est propre : « Il est vain de pleurer pour l’esprit, il suffit de travailler pour
lui ».
Il cite Nietzsche qui oppose « l’esprit de lourdeur », c’est-à-dire cette forme de désespoir et d’abandon
de l’esprit, à quelques vertus conquérantes de l’esprit : « la force de caractère, le goût, le « monde », le
bonheur classique, la dure fierté, la froide frugalité du sage ».
Camus demande à ne pas négliger la force de
caractère qui est responsable selon lui de la tenue de la neige comme du maintien de l’esprit des Hommes :
« […] celle qui résiste à tous les vents de la mer par la vertu de la blancheur et de la sève.
C’est elle qui, dans
l’hiver du monde, préparera le fruit ».
L’esprit est plus violenté à notre époque, mais il survit malgré tout si
on continue de le préserver.
Prométhée aux enfers, 1946
Camus mobilise la figure de Prométhée, qui libère les Hommes en leur donnant le feu malgré l’interdiction
des Dieux, pour illustrer le rapport des Hommes à la révolte à son époque.
Il rejette l’hypothèse que la
révolte de Prométhée trouve sa fin aujourd’hui, et dit que les Hommes sont aujourd’hui plus aliénés que
jamais, qu’ils ont perdu les arts que Prométhée leur a apportés pour s’enfermer dans la technique.
L’Homme a opéré une distinction entre ces deux domaines, il ne se préoccupe plus que du corps, et asservit
son âme, là où c’était indissociable : « L’Homme actuel croit qu’il faut d’abord libérer le corps, même si
l’esprit doit mourir provisoirement.
Mais l’esprit peut-il mourir provisoirement ? ».
Il lie cette mort
symbolique tout à la fois de l’art, de l’âme, et de Prométhée, avec le traumatisme qu’a été la guerre qui a
pour toujours changé la face du monde, et, pour lui, en a retiré tout espoir pour un futur plus beau, ce qui
explique ce recours incessant aux symboles du passé pour comprendre son présent.
Il voit l’Histoire et les
choix des Hommes comme une trahison envers Prométhée, car l’Homme choisit lui-même d’être l’esclave
de ses choix.
Il voit en certains Hommes de son temps, en ce qu’ils sont conscients de cet état, des
Prométhée modernes, qui peuvent sauver les Hommes, ou du moins les générations futures de ces
Hommes.
Il rappelle l’importance des mythes, en l’occurrence un en particulier, qu’il faut incarner de tous
temps, et donc adapter aux temps actuels, comme il le fait.
Ici, la leçon à tirer est que l’âme est aussi
importante que le corps, et qu’on ne peut scinder l’Homme en ces deux facettes : « Si nous devons nous
résigner à vivre sans....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Fiche de lecture sur la peste d'Albert Camus
- La Chute de Camus : Fiche de lecture
- L'Étranger d'Albert Camus : Fiche de lecture
- fiche de lecture de l'étranger d'Albert Camus
- PESTE (La) d'Albert Camus : Fiche de lecture