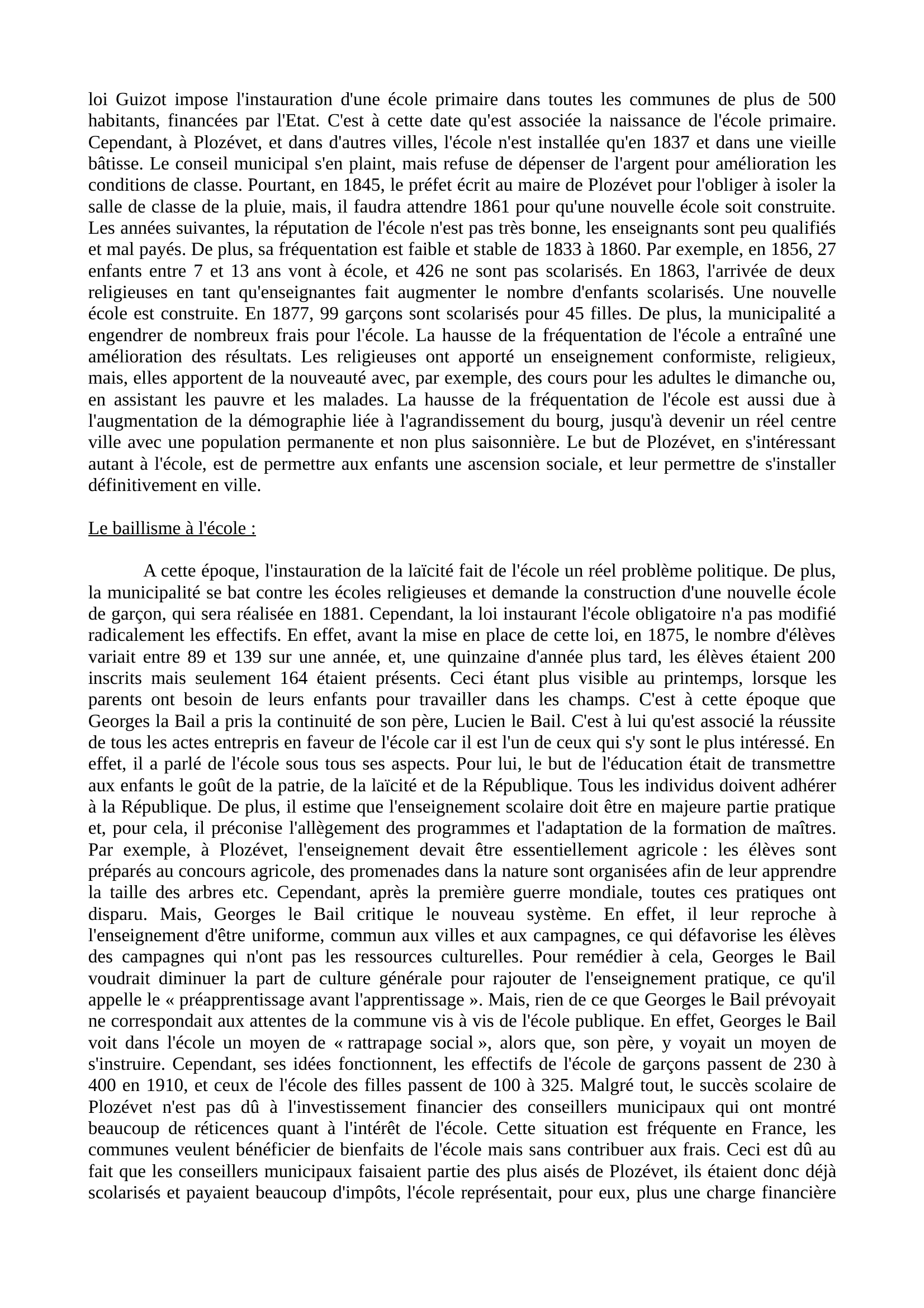Fiche de lecture André Burguière
Publié le 27/05/2014
Extrait du document
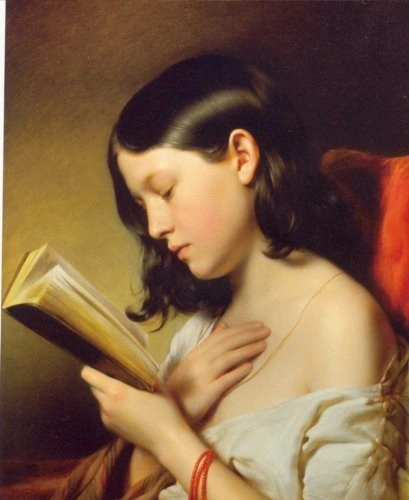
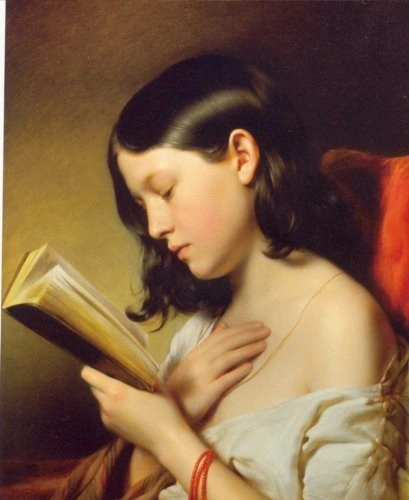
«
loi Guizot impose l'instauration d'une école primaire dans toutes les communes de plus de 500
habitants, financées par l'Etat.
C'est à cette date qu'est associée la naissance de l'école primaire.
Cependant, à Plozévet, et dans d'autres villes, l'école n'est installée qu'en 1837 et dans une vieille
bâtisse.
Le conseil municipal s'en plaint, mais refuse de dépenser de l'argent pour amélioration les
conditions de classe.
Pourtant, en 1845, le préfet écrit au maire de Plozévet pour l'obliger à isoler la
salle de classe de la pluie, mais, il faudra attendre 1861 pour qu'une nouvelle école soit construite.
Les années suivantes, la réputation de l'école n'est pas très bonne, les enseignants sont peu qualifiés
et mal payés.
De plus, sa fréquentation est faible et stable de 1833 à 1860.
Par exemple, en 1856, 27
enfants entre 7 et 13 ans vont à école, et 426 ne sont pas scolarisés.
En 1863, l'arrivée de deux
religieuses en tant qu'enseignantes fait augmenter le nombre d'enfants scolarisés.
Une nouvelle
école est construite.
En 1877, 99 garçons sont scolarisés pour 45 filles.
De plus, la municipalité a
engendrer de nombreux frais pour l'école.
La hausse de la fréquentation de l'école a entraîné une
amélioration des résultats.
Les religieuses ont apporté un enseignement conformiste, religieux,
mais, elles apportent de la nouveauté avec, par exemple, des cours pour les adultes le dimanche ou,
en assistant les pauvre et les malades.
La hausse de la fréquentation de l'école est aussi due à
l'augmentation de la démographie liée à l'agrandissement du bourg, jusqu'à devenir un réel centre
ville avec une population permanente et non plus saisonnière.
Le but de Plozévet, en s'intéressant
autant à l'école, est de permettre aux enfants une ascension sociale, et leur permettre de s'installer
définitivement en ville.
Le baillisme à l'école :
A cette époque, l'instauration de la laïcité fait de l'école un réel problème politique.
De plus,
la municipalité se bat contre les écoles religieuses et demande la construction d'une nouvelle école
de garçon, qui sera réalisée en 1881.
Cependant, la loi instaurant l'école obligatoire n'a pas modifié
radicalement les effectifs.
En effet, avant la mise en place de cette loi, en 1875, le nombre d'élèves
variait entre 89 et 139 sur une année, et, une quinzaine d'année plus tard, les élèves étaient 200
inscrits mais seulement 164 étaient présents.
Ceci étant plus visible au printemps, lorsque les
parents ont besoin de leurs enfants pour travailler dans les champs.
C'est à cette époque que
Georges la Bail a pris la continuité de son père, Lucien le Bail.
C'est à lui qu'est associé la réussite
de tous les actes entrepris en faveur de l'école car il est l'un de ceux qui s'y sont le plus intéressé.
En
effet, il a parlé de l'école sous tous ses aspects.
Pour lui, le but de l'éducation était de transmettre
aux enfants le goût de la patrie, de la laïcité et de la République.
Tous les individus doivent adhérer
à la République.
De plus, il estime que l'enseignement scolaire doit être en majeure partie pratique
et, pour cela, il préconise l'allègement des programmes et l'adaptation de la formation de maîtres.
Par exemple, à Plozévet, l'enseignement devait être essentiellement agricole : les élèves sont
préparés au concours agricole, des promenades dans la nature sont organisées afin de leur apprendre
la taille des arbres etc.
Cependant, après la première guerre mondiale, toutes ces pratiques ont
disparu.
Mais, Georges le Bail critique le nouveau système.
En effet, il leur reproche à
l'enseignement d'être uniforme, commun aux villes et aux campagnes, ce qui défavorise les élèves
des campagnes qui n'ont pas les ressources culturelles.
Pour remédier à cela, Georges le Bail
voudrait diminuer la part de culture générale pour rajouter de l'enseignement pratique, ce qu'il
appelle le « préapprentissage avant l'apprentissage ».
Mais, rien de ce que Georges le Bail prévoyait
ne correspondait aux attentes de la commune vis à vis de l'école publique.
En effet, Georges le Bail
voit dans l'école un moyen de « rattrapage social », alors que, son père, y voyait un moyen de
s'instruire.
Cependant, ses idées fonctionnent, les effectifs de l'école de garçons passent de 230 à
400 en 1910, et ceux de l'école des filles passent de 100 à 325.
Malgré tout, le succès scolaire de
Plozévet n'est pas dû à l'investissement financier des conseillers municipaux qui ont montré
beaucoup de réticences quant à l'intérêt de l'école.
Cette situation est fréquente en France, les
communes veulent bénéficier de bienfaits de l'école mais sans contribuer aux frais.
Ceci est dû au
fait que les conseillers municipaux faisaient partie des plus aisés de Plozévet, ils étaient donc déjà
scolarisés et payaient beaucoup d'impôts, l'école représentait, pour eux, plus une charge financière.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Fiche de lecture : PORTE ÉTROITE (La) d'André Gide
- NADJA d'André Breton : Fiche de lecture
- ANTIMÉMOIRES d'André Malraux (fiche de lecture)
- SI LE GRAIN NE MEURT d'André Gide : Fiche de lecture
- Fiche de lecture : RETOUR DE L’U.R.S.S. d'André Gide