Essais de Montaigne (résumé & analyse)
Publié le 24/11/2018

Extrait du document
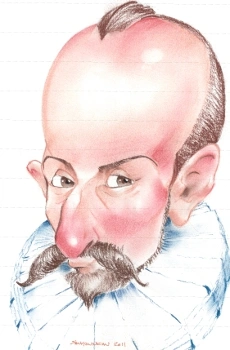
L’expérience de l’Antiquité
Les Anciens ont fourni à Montaigne ce qu’ils ont apporté aux autres auteurs du xvie siècle, à savoir : la matière principale des citations et emprunts et des notes de lecture. Mais Montaigne prend ses distances vis-à-vis d’eux au cours de la rédaction des Essais : il lui paraît urgent de se dire en se servant des autres. Le développement de l’analyse personnelle va de pair avec l’examen des exemples et du discours antiques. Ainsi, Plutarque, abondamment exploité, fournit à Montaigne bon nombre d’histoires extraordinaires : mais ce ne sont que des histoires, c’est-à-dire une matière malléable, susceptible d'être insérée dans un autre discours. Montaigne aurait emprunté au même Plutarque les images héraclitéennes sur le mobilisme universel; mais il faut dire que le disciple a largement détourné le maître, et que le mobilisme est devenu diversité. L’histoire n’est pas pour Montaigne une réalité intangible, mais du discours, puisqu’elle est précisément sujette à la variabilité temporelle. Montaigne prend ses exemples aussi bien dans la vie pratique que dans les histoires fabuleuses, parce que la différence entre l’expérience et la lecture n’est pas évidente. Notre expérience est aussi un discours sur les choses.
De même, l’Antiquité n’est pas un âge d’or plus ou moins utopique; Montaigne a senti l’exagération mythique qui gonflait, à l’époque, le prestige des auteurs anciens. Ce que d'autres évoquaient comme un âge proche de la divine nature, il le range dans le domaine de la fiction. La figure antique qui matérialise ses désirs est, de façon caractéristique, celle de Socrate; celui qui n'écrit pas, celui qu’on a raconté.
Essais
Loin de se présenter comme un livre lisse, achevé, aux liaisons soignées, les Essais ont une structure et induisent une lecture qui correspond à leur titre : montage spécifique de réflexions rédigées à diverses époques, commentées à d’autres, et qui force le lecteur à pratiquer une lecture non linéaire.
Lire en spirale
Difficulté d’abord provoquée par ce qu’on appelle les trois « strates » du texte (voir la chronologie des œuvres), c’est-à-dire la couche A (édition 1580, livres I et II), la couche B (édition 1588, livres I, II et III) et la couche C (annotations portées sur l’exemplaire de Bordeaux après 1588). La diachronie du texte s’impose, même si une lecture cursive (ou globale) tend à effacer les différentes époques de la rédaction. Encore faut-il distinguer celles-ci des moments clés que sont les dates d’édition, importantes, certes, mais qui ne rendent pas compte du travail effectué durant des années par Montaigne sur son texte.
Une des premières exigences des Essais (I, vin, « De l’oisiveté ») est celle de la liberté de l’écriture (et des réécritures) : Montaigne « met en rolle » ses « chimères et monstres fantasques ». Les premiers chapitres offrent l'aspect d’une compilation, d’un florilège d’exemples comme on en trouve dans les « leçons » de l’époque. Cet
aspect diminue à mesure que l’on pénètre dans le texte — et donc aussi selon l’évolution personnelle de Montaigne — sans jamais disparaître tout à fait. L’intervention de l’auteur se fait plus sensible, plus raffinée, plus subtile : il n’empêche qu'elle a souvent pour point de départ un élément étranger.
Montaigne revendique le droit de ne pas produire une œuvre : « Je peins principalement mes cogitations, sub-ject informe, qui ne peut tomber en production ouvra-gere » (II, xn). Son texte ne prétend pas à la profondeur ni à la hauteur, mais à l’humanité, au ras des possibilités de l’homme, quelles que soient ses aspirations à la divinité. A une telle modestie idéologique (ce n'est pas pour rien que le texte s’intitule « essais ») correspond une modestie littéraire dont la forme reste très spécifique : on a souvent tenté de l’ordonner (Pierre Charron), mais sans succès : on peut toujours aboutir à une réduction ou à une expurgation des Essais, jamais à une lecture totale.
Il faut donc renoncer à « lire totalement » Montaigne, c’est-à-dire à vouloir rendre compte d’un texte qui s’avoue lui-même comme un montage. La structure synchronique telle qu’elle s’organise au cours des pages tournées est, selon l’expression de Montaigne, une « marqueterie mal jointe » : des jonctions syntaxiques floues, des liaisons-chevilles qui renforcent l’idée d’une association plus que d’un raisonnement organisé à partir d’un plan. Refaire le plan des Essais serait une gageure. La critique s’est limitée, la plupart du temps, à étudier un chapitre ou un groupe de chapitres et à rendre compte de l'absence de structure dans les Essais par des images : architecture non terminée (A. Glauser), guirlande, bastion (M. Butor), spirale (A. Compagnon), cercles concentriques (G. Poulet). Autant de métaphores de l’impuissance à lire un texte qui nous montre ses coutures tout en cachant les indices de sa structure profonde.
Un centre?
De l’aveu de Montaigne lui-même, les Essais auraient dû avoir un centre (I, xxvm). Les « grotesques » auraient dû entourer le tableau principal d’un opuscule de La Boétie. Mais plusieurs années ont passé entre cette intention et la première édition : plusieurs années au cours desquelles s'est probablement élaborée l’« Apologie de Raymond Sebond »; années pendant lesquelles l’étude du scepticisme s’est approfondie, et pendant lesquelles l’auteur du Discours de la servitude volontaire a disparu au profit de l’ami. Un centre promis, mais non tenu.
Avec l'édition de 1580, l’« Apologie » apparaît comme un monument, ordonné en principe sur un sujet précis, la théologie de Sebond, et où Montaigne décide de parler à la place de l’auteur. L’œuvre apparaît désormais comme un labyrinthe (Butor) : on a apparemment une entrée et une sortie, un début et une fin, mais les thèmes reviennent et s’entrecroisent. De plus, ils ne sont pas spécifiques à ce chapitre : bon nombre d’entre eux sont annoncés ou développés ailleurs. L'« Apologie » ne paraît centrale que par la masse imposante de ses pages.
La rédaction des Essais conduit Montaigne, qu’il le veuille ou non, à des décentrements successifs, comme si, une fois le sujet abordé, c’était l’écriture qui comptait avant tout, et non plus un contenu forcé. L’absence de mémoire alléguée par Montaigne est un singulier prétexte : elle justifie la relecture permanente de l’œuvre et en même temps des additions nécessaires, puisqu’une certaine durée s’est écoulée et que le sujet écrivant n’est plus exactement le même. Elle justifie ce qu’on appelle le désordre du livre; le lecteur, mémorisant d’une autre façon, lit le texte à la suite, sans distinguer un à un les méandres d’une pensée qui, malgré nous, nous échappe.
Seule l’écriture est là pour pallier une mémoire presque volontairement défaillante : « Et suis si excellent en l'oubliance que mes escrits mesmes et compositions, je ne les oublie pas moins que le reste » (II, xvn, « De la praesumption »). Montaigne se relit donc, sans se dédire. Les additions insérées dans les chapitres déjà écrits sont nombreuses, les rajouts et les allongements par de nouveaux chapitres constituent la majeure partie du livre III; en revanche, les corrections sont rares, et les contradictions ne sont pas niables.
C’est pourquoi Montaigne dit avoir fait de son livre un enfant monstrueux (II, xvm, « Du démentir») : une production qui fait s’enchevêtrer des thèmes et des idées à divers degrés générateurs. L'agencement ne se fait pas selon un ordre secret — que divers critiques ont évoqué sans qu’il s’agisse d’autre chose que de l'ordre qu’ils auraient aimé y trouver (M. Baraz, A. Glauser, O. Nau-deau) —, mais selon une notion sur laquelle Montaigne revient souvent, parce qu’elle permet à l’écriture personnelle de se développer librement : le hasard : « Que sont-ce icy, à la vérité, que crotesques et corps monstrueux, rappiecez de divers membres, sans certaine figure, n’ayants ordre, suite, ny proportion que fortuite? » (I, xxviii, « De l’amitié »).
L’abandon et la négation du principe d'unité extérieure du livre seront les principaux obstacles aux lectures postérieures des Essais. La critique essaiera d’y remédier en replaçant le texte dans la perspective d'une unité interne et subjective, qui renvoie, bien sûr, à la propre subjectivité du lecteur.
La dislocation
Plusieurs éléments propres à la technique de l’écriture viennent appuyer l’idée d’un texte guidé par le hasard du lecteur Montaigne. En premier lieu, Montaigne est lecteur d’autres livres. Il commence par là. Il est conduit à pratiquer l’exemple, souvent une narration effectuée de mémoire, c’est-à-dire avec un gros risque d’erreur (I, XXI), et à rechercher une vérité d’emprunt, puisqu’il trahit — il le reconnaît lui-même — ses propres sources. Les citations, d’emblée paraissent plus vraies, plus authentiques. Elles sont légion : « Quelqu’un pourroit dire de moy que j’ay seulement faict icy un amas de fleurs estrangeres, n’y ayant fourny du mien que le filet à les lier » (III, XII, « De la phisionomie »). Elles sont avouées ou cachées, car les emprunts de Montaigne aux Anciens ou aux textes sacrés ne sont pas toujours signalés par une typographie ou une disposition particulières. L’étude des sources montaigniennes est donc particulièrement féconde mais pas toujours essentielle. Car le « filet » a sans doute plus de portée que l’emprunt lui-même, très souvent distordu de son sens premier par l’extraction du contexte. Cela est particulièrement vrai pour les références à Platon, à saint Augustin ou à l’« Ecclésiaste », en des textes utilisés par Montaigne dans le sens qui lui convenait. La citation est donc à distinguer radicalement de l’influence exercée par l'auteur cité.
Montaigne ne se contente pas de troubler le sens du texte des autres : il se transforme lui-même, dans les additions nombreuses des « strates B et C ». Il est extrêmement délicat de déterminer avec précision la portée de chacune des additions par rapport au texte original (mais peut-on parler de texte original quand c’est l’auteur qui se surajoute à lui-même?). Le plus souvent, le lecteur parcourt un chapitre d’un seul tenant : s’il revient sur les étapes A, B et C en essayant de les distinguer, il effectue une lecture érudite qui ne tient plus compte de l’effet global, sauf par un effort de recomposition a posteriori. Il semble donc que, contrairement à la citation et à l’emprunt délibérément livrés comme tels, l’addition fasse partie du texte sans être un supplément. Différencier les couches, à la lecture, est un projet aussi irréalisable que de retrouver le fil de la pensée de Montaigne entre 1571 et 1592, avec toutes les interactions biographiques possibles. Une telle entreprise de totalita-
Montaigne ne s’exclut pas des caprices de la Fortune. Lui et son livre sont tributaires du hasard; le moi n’est pas un bastion immobile, ni le livre une pierre sans âge. Le moi ne se ressemble pas. La tentative des Essais est l’inverse d’une réduction des difficultés que pose l’existence. Elle vise, au contraire, à les étaler au fil des pages, sans la honte de ne pas être éternel.
La Fortune est une des figures de la mort, qui a prise sur nous par notre nature terrestre. Au lieu de se lamenter sur celle-ci, comme Font fait ceux qui accusent le corps d’être le tombeau de l’âme, Montaigne est conduit à l’accepter, jusqu’à la complaisance. On ne trouve guère, dans les Essais, d’éloge de l’immortalité de l’âme. Le corps humain a ses plaisirs, qu’il ne faut pas dédaigner. Montaigne n’admet pas le dualisme du corps et de l’âme : sans la violence d’un libertin ou d’un athée, il s’attache à montrer leur liaison indissoluble, par l’expérience que nous en avons. En réhabilitant le corps jusque dans ses fonctions les plus basses (génitale, excrémentielle), Montaigne replace l’homme à l’endroit qu’il n’aurait jamais dû quitter, un point faible dans une Nature dissemblable. La matérialité de l'homme n’est pas un péché : « Est-ce pas erreur d’estimer aucunes actions moins dignes de ce qu’elles sont necessaires? Si ne m’osteront-ils pas de la teste que ce ne soit un très convenable mariage du plaisir et de la nécessité... » (III, xni). L’âme ne doit pas être dégoûtée du corps, car elle participe avec lui à la nature humaine, selon un principe que Montaigne ressent sans pouvoir l’expliquer : « Mais comme une impression spirituelle fasse une telle faucée (trouée, percée) dans un subject massif et solide, et la nature et liaison et cousture de ces admirables ressorts, jamais homme ne l’a sçeu » (II, XII). La présence du corps est partie intégrante d’un discours qui ne peut se construire en dehors de la matière vivante.
Remettre l’homme à sa juste place, c’est donc rendre à la Fortune ce qu’on lui doit, et redonner au corps une valeur que lui ont fait perdre quinze siècles de christianisme mal compris et des commentaires néoplatoniciens pratiquant la surenchère critique à l’égard de cette matérialité honteuse. En même temps, Montaigne ne semble pas à la recherche d’un point d’ancrage qui permettrait de soulager le moi de l’impression de déséquilibre qu’entraîne la notion omniprésente de « diversité ». Même le jugement est à remettre en question : nos opinions sont diverses, notre jugement l’est aussi; il fait son «jeu à part » (III, xiii).
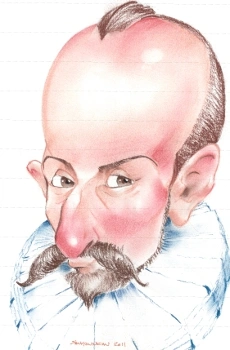
«
ne
les oublie pas moins que le reste » (Il, XVII, «De la
praesumption » ).
Montaigne se relit donc, sans se dédire.
Les additions insérées dans les chapitres déjà écrits sont
nombreuses, les rajouts et les allongements par de nou
veaux chapitres constituent la majeure partie du livre III;
en revancht:, les corrections sont rares, et les contradic
tions ne sont pas niables.
C'est pourquoi Montaigne dit avoir fait de son livre
un enfant monstrueux (Il, XVIII, « Du démentir») : une
production qui fait s'enchevêtrer des thèmes et des idées
à divers degrés générateurs.
L'agencement ne se fait pas
selon un ordre secret-que divers critiques ont évoqué
sans qu'il s'agisse d'autre chose que de l'ordre qu'ils
auraient aimé y trouver (M.
Baraz, A.
Glauser, O.
Nau
deau) -, mais selon une notion sur laquelle Montaigne
revient souvent.
parce qu'elle permet à 1 'écriture person
nelle de se développer librement : le hasard : «Que sont
ce icy, à la verité, que crotesques et corps monstrueux,
rappiecez de divers membres, sans certaine figure,
n'ayants ordre, suite, ny proportion que fortuite?» (1,
xxvm, « De l'amitié ,, ).
L'abandon et la négation du principe d'unité exté
rieure du livre �eront les principaux obstacles aux lectu
res postérieure; des Essais.
La critique essaiera d'y
remédier en replaçant le texte dans la perspective d'une
unité interne et subjective, qui renvoie.
bien sûr, à la
propre subjectivité du lecteur.
La dislocation
Plusieurs éléments propres à la technique de l'écriture
viennent appuy•!r l'idée d'un texte guidé par le hasard du
lecteur Montaigne.
En premier lieu, Montaigne est lecteur
d'autres livres.
Il commence par là.
JI est conduit à pra
tiquer l'exemple, souvent une narration effectuée de
mémoire, c'est-à-dire avec un gros risque d'erreur (I, XXI),
et à rechercher une vérité d'emprunt, puisqu'il trahit-il
le reconnaî't lui-même-ses propres sources.
Les cita
tions, d'emblée paraissent plus vraies, plus authentiques.
Elles sont légion : «Quelqu'un pourroit dire de moy que
j'a y seulement faict icy un amas de fleurs estrangeres,
n'y ayant fourny du mien que le filet à les lier» (Ill, Xli,
« De la phisionomie » ).
Elles sont avouées ou cachées,
car les emprunts de Montaigne aux Anciens ou aux textes
sacrés ne sont pas toujours signalés par une typographie
ou une disposition particulières.
L'étude des sources
montaignienne� est donc particulièrement féconde mais
pas toujours es�entielle.
Car Je.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- ESSAIS (Les) Michel de Montaigne (résumé & analyse)
- MICHEL DE MONTAIGNE (1533-1592) : Les Essais (Résumé et analyse)
- MONTAIGNE, Les Essais, III, VI: Après avoir fait selon votre préférence un résumé ou une analyse de la page de Montaigne, commentez-en un ou plusieurs thèmes qui vous paraissent essentiels.
- MONTAIGNE : ESSAIS (Résumé & Analyse)
- MONTAIGNE Livre Ier, chapitre xxvi: De l'Institution des enfants (composé à la fin de 1579, publié en 1580) (résumé & analyse)


