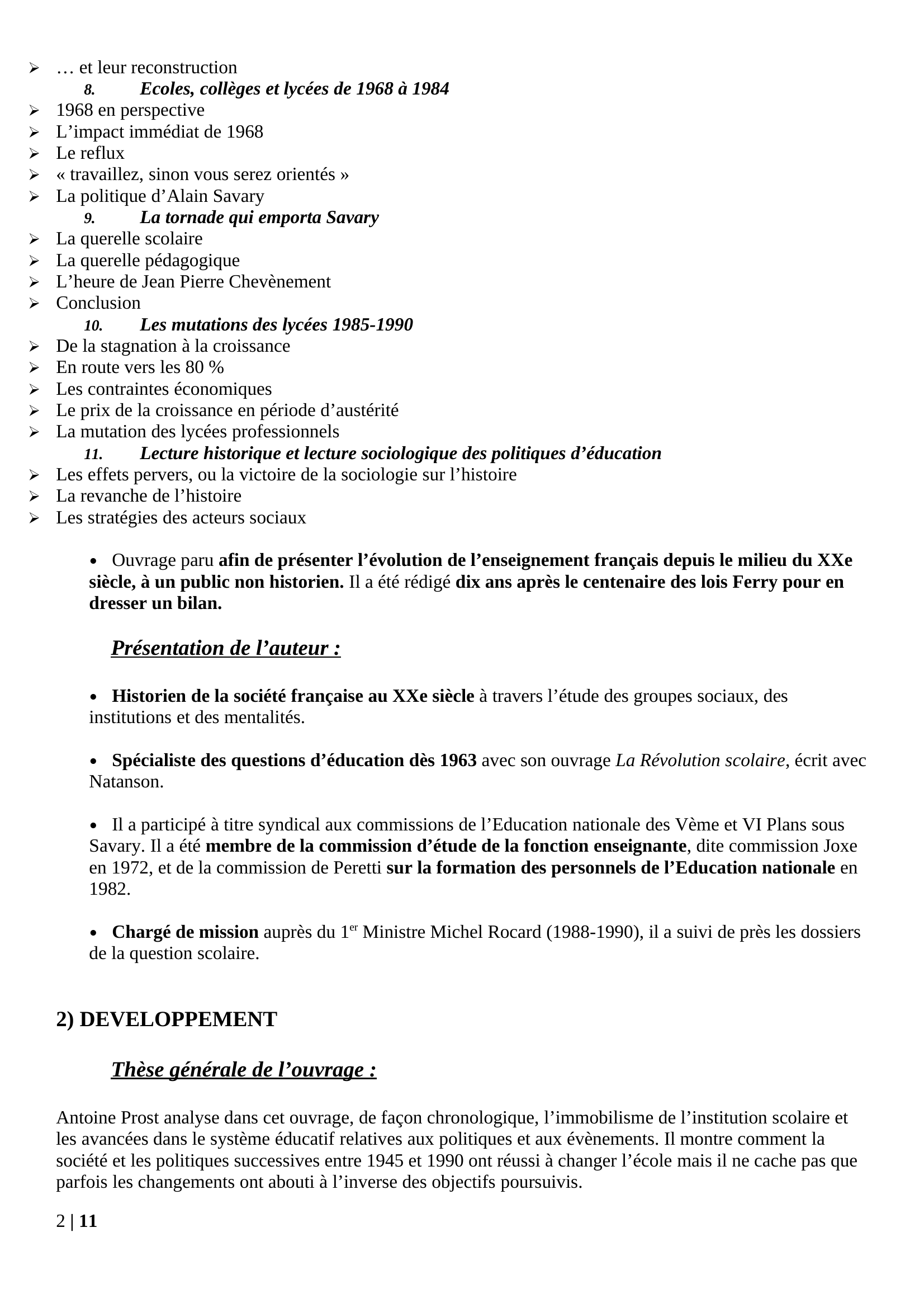Education, société et politiques
Publié le 15/05/2013
Extrait du document
«
… et leur reconstruction
8.
Ecoles, collèges et lycées de 1968 à 1984
1968 en perspective
L’impact immédiat de 1968
Le reflux
« travaillez, sinon vous serez orientés »
La politique d’Alain Savary
9.
La tornade qui emporta Savary
La querelle scolaire
La querelle pédagogique
L’heure de Jean Pierre Chevènement
Conclusion
10.
Les mutations des lycées 1985-1990
De la stagnation à la croissance
En route vers les 80 %
Les contraintes économiques
Le prix de la croissance en période d’austérité
La mutation des lycées professionnels
11.
Lecture historique et lecture sociologique des politiques d’éducation
Les effets pervers, ou la victoire de la sociologie sur l’histoire
La revanche de l’histoire
Les stratégies des acteurs sociaux
· Ouvrage paru afin de présenter l’évolution de l’enseignement français depuis le milieu du XXe
siècle, à un public non historien.
Il a été rédigé dix ans après le centenaire des lois Ferry pour en
dresser un bilan.
Présentation de l’auteur :
· Historien de la société française au XXe siècle à travers l’étude des groupes sociaux, des
institutions et des mentalités.
· Spécialiste des questions d’éducation dès 1963 avec son ouvrage La Révolution scolaire , écrit avec
Natanson.
· Il a participé à titre syndical aux commissions de l’Education nationale des Vème et VI Plans sous
Savary.
Il a été membre de la commission d’étude de la fonction enseignante , dite commission Joxe
en 1972, et de la commission de Peretti sur la formation des personnels de l’Education nationale en
1982.
· Chargé de mission auprès du 1 er
Ministre Michel Rocard (1988-1990), il a suivi de près les dossiers
de la question scolaire.
2) DEVELOPPEMENT
Thèse générale de l’ouvrage :
Antoine Prost analyse dans cet ouvrage, de façon chronologique, l’immobilisme de l’institution scolaire et
les avancées dans le système éducatif relatives aux politiques et aux évènements.
Il montre comment la
société et les politiques successives entre 1945 et 1990 ont réussi à changer l’école mais il ne cache pas que
parfois les changements ont abouti à l’inverse des objectifs poursuivis.
2 | 11.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- ESSAIS POLITIQUES SUR LES ORIGINES, LES PROGRÈS ET LA DÉCADENCE DE LA SOCIÉTÉ
- Politiques publiques education en France
- Grand oral du bac : Société LES PARTIS POLITIQUES
- Vous expliquerez et apprécierez ce parallèle entre le XVIIe siècle classique et le moyen âge : «Le XVIIe siècle - en ce qu'il a de classique - bien plus que l'introduction à la pensée scientifique, moderne et athée du XVIIIe siècle, est l'épanouissement de la pensée du moyen âge, dont il donne, sous des habits empruntés et dans une langue magnifique, une nouvelle et somptueuse image. Un homme prévenu, qui oublierait tant de poncifs et de jugements consacrés, comment ne serait-il pas fr
- ... La violence joue encore dans l'histoire un autre rôle, un rôle révolutionnaire; que selon les paroles de Marx, elle soit l'accoucheuse de toute vieille société qui en porte une nouvelle dans ses flans; qu'elle soit l'instrument grâce auquel le mouvement social l'emporte et met en pièces des formes politiques figées et mortes... Engels, Anti-Dühring, Edistions sociales, page 216. Commentez cette citation.