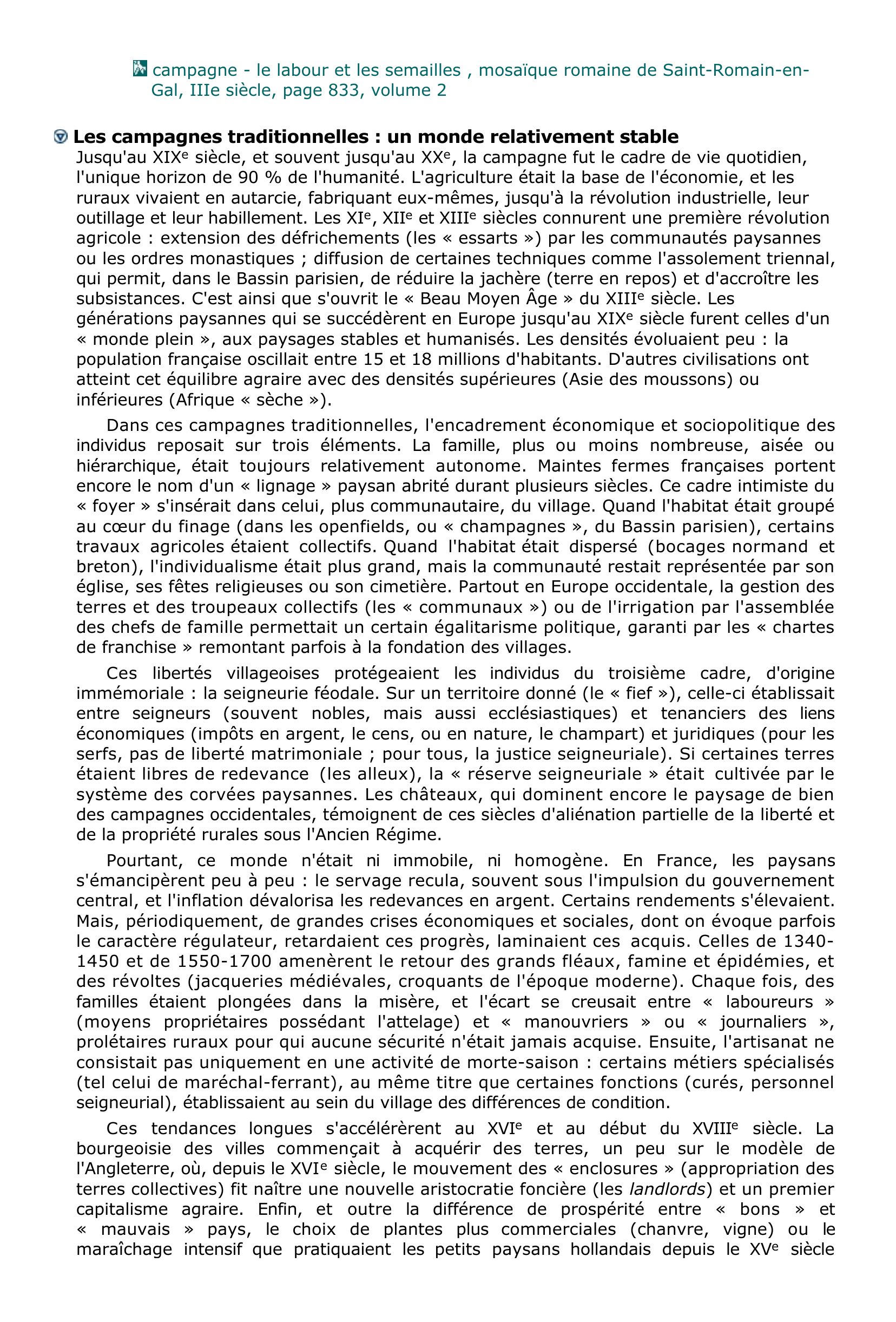Toutes les sociétés, même les plus industrielles et urbaines, ont un passé majoritairement rural et agricole.
Publié le 23/10/2013
Extrait du document
«
campagne - le labour et les semailles , mosaïque romaine de Saint-Romain-en-
Gal, IIIe siècle, page 833, volume 2
Les campagnes traditionnelles : un monde relativement stable
Jusqu'au XIX e siècle, et souvent jusqu'au XX e, la campagne fut le cadre de vie quotidien,
l'unique horizon de 90 % de l'humanité.
L'agriculture était la base de l'économie, et les
ruraux vivaient en autarcie, fabriquant eux-mêmes, jusqu'à la révolution industrielle, leur
outillage et leur habillement.
Les XI e, XII e et XIII e siècles connurent une première révolution
agricole : extension des défrichements (les « essarts ») par les communautés paysannes
ou les ordres monastiques ; diffusion de certaines techniques comme l'assolement triennal,
qui permit, dans le Bassin parisien, de réduire la jachère (terre en repos) et d'accroître les
subsistances.
C'est ainsi que s'ouvrit le « Beau Moyen Âge » du XIII e siècle.
Les
générations paysannes qui se succédèrent en Europe jusqu'au XIX e siècle furent celles d'un
« monde plein », aux paysages stables et humanisés.
Les densités évoluaient peu : la
population française oscillait entre 15 et 18 millions d'habitants.
D'autres civilisations ont
atteint cet équilibre agraire avec des densités supérieures (Asie des moussons) ou
inférieures (Afrique « sèche »).
Dans ces campagnes traditionnelles, l'encadrement économique et sociopolitique des
individus reposait sur trois éléments.
La famille, plus ou moins nombreuse, aisée ou
hiérarchique, était toujours relativement autonome.
Maintes fermes françaises portent
encore le nom d'un « lignage » paysan abrité durant plusieurs siècles.
Ce cadre intimiste du
« foyer » s'insérait dans celui, plus communautaire, du village.
Quand l'habitat était groupé
au cœur du finage (dans les openfields, ou « champagnes », du Bassin parisien), certains
travaux agricoles étaient collectifs.
Quand l'habitat était dispersé (bocages normand et
breton), l'individualisme était plus grand, mais la communauté restait représentée par son
église, ses fêtes religieuses ou son cimetière.
Partout en Europe occidentale, la gestion des
terres et des troupeaux collectifs (les « communaux ») ou de l'irrigation par l'assemblée
des chefs de famille permettait un certain égalitarisme politique, garanti par les « chartes
de franchise » remontant parfois à la fondation des villages.
Ces libertés villageoises protégeaient les individus du troisième cadre, d'origine
immémoriale : la seigneurie féodale.
Sur un territoire donné (le « fief »), celle-ci établissait
entre seigneurs (souvent nobles, mais aussi ecclésiastiques) et tenanciers des liens
économiques (impôts en argent, le cens, ou en nature, le champart) et juridiques (pour les
serfs, pas de liberté matrimoniale ; pour tous, la justice seigneuriale).
Si certaines terres
étaient libres de redevance (les alleux), la « réserve seigneuriale » était cultivée par le
système des corvées paysannes.
Les châteaux, qui dominent encore le paysage de bien
des campagnes occidentales, témoignent de ces siècles d'aliénation partielle de la liberté et
de la propriété rurales sous l'Ancien Régime.
Pourtant, ce monde n'était ni immobile, ni homogène.
En France, les paysans
s'émancipèrent peu à peu : le servage recula, souvent sous l'impulsion du gouvernement
central, et l'inflation dévalorisa les redevances en argent.
Certains rendements s'élevaient.
Mais, périodiquement, de grandes crises économiques et sociales, dont on évoque parfois
le caractère régulateur, retardaient ces progrès, laminaient ces acquis.
Celles de 1340-
1450 et de 1550-1700 amenèrent le retour des grands fléaux, famine et épidémies, et
des révoltes (jacqueries médiévales, croquants de l'époque moderne).
Chaque fois, des
familles étaient plongées dans la misère, et l'écart se creusait entre « laboureurs »
(moyens propriétaires possédant l'attelage) et « manouvriers » ou « journaliers »,
prolétaires ruraux pour qui aucune sécurité n'était jamais acquise.
Ensuite, l'artisanat ne
consistait pas uniquement en une activité de morte-saison : certains métiers spécialisés
(tel celui de maréchal-ferrant), au même titre que certaines fonctions (curés, personnel
seigneurial), établissaient au sein du village des différences de condition.
Ces tendances longues s'accélérèrent au XVI e et au début du XVIII e siècle.
La
bourgeoisie des villes commençait à acquérir des terres, un peu sur le modèle de
l'Angleterre, où, depuis le XVI e siècle, le mouvement des « enclosures » (appropriation des
terres collectives) fit naître une nouvelle aristocratie foncière (les landlords ) et un premier
capitalisme agraire.
Enfin, et outre la différence de prospérité entre « bons » et
« mauvais » pays, le choix de plantes plus commerciales (chanvre, vigne) ou le
maraîchage intensif que pratiquaient les petits paysans hollandais depuis le XV e siècle.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- LUTTE DE CLASSES, nouvelles leçons sur les sociétés industrielles (La). Raymond Aron (résumé)
- La science-fiction est un produit culturel des sociétés industrielles.
- L a consommation est devenue un phénomène de masse à ce point général dans les sociétés industrielles que celles-ci sont désormais identifiées comme des « sociétés de consommation ».
- structure agraire 1 PRÉSENTATION structure agraire, ensemble des cadres dans lesquels se réalise l'aménagement de l'espace rural en vue de la production agricole.
- LE TRAVAIL DANS LES SOCIÉTÉS INDUSTRIELLES