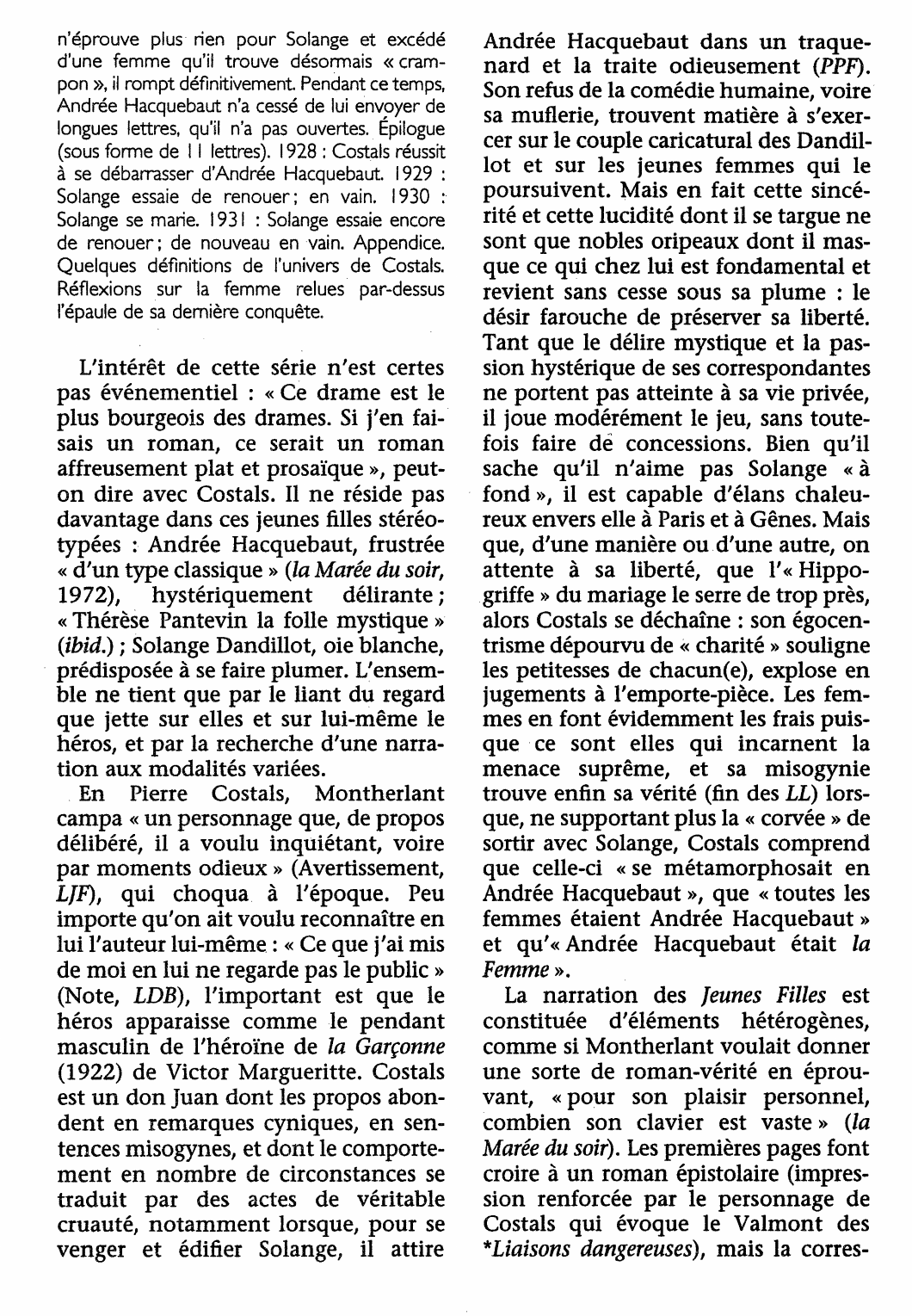MONTHERLANT (Henry Marie Joseph Millon de)
Publié le 27/01/2019

Extrait du document

MONTHERLANT (Henry Marie Joseph Millon de), écrivain français (Paris 1896-id. 1972). Il passa son enfance entre une mère malade et une grand-mère maternelle dont l'angoisse à caractère janséniste était la raison de vivre. Dans ce milieu familial noble, on se fait un point d'honneur de cultiver sa « différence ». Dès l'âge de neuf ans, la passion d'écrire s'éveille chez cet enfant hypersensible, qui, par la lecture de Quo Vadis ?, vient de découvrir le monde romain. Ce sera, avec la grandeur, la révélation d'une sagesse, d'un refus de la vulgarité, d'un art de vivre auquel l'écrivain restera toute sa vie profondément attaché, comme en témoignent les essais du Treizième César, publiés en 1970, et Thrasylle, premier roman écrit qui ne paraîtra qu'en 1984.
Les deux années passées au collège Sainte-Croix de Neuilly marquèrent fortement le jeune Montherlant, éveillant en lui la passion des êtres. « Les êtres, les êtres, il n'y avait qu'eux », écrira-t-il dans la Relève du matin (1920), suite d'essais formant un long poème à la gloire du collège : le double thème de l'amour et de l'« ordre » du collège sera repris dans une pièce, la Ville dont le prince est un enfant (1951), et dans un roman, les Garçons (1969). Autre révélation capitale : la tauromachie. De passage à Bayonne, pendant l'été 1909, le jeune Montherlant assiste à une corrida qui provoque en lui « une frénésie presque pathologique ». Par la suite, lors de séjours en Espagne, il s'exercera à toréer. Il enregistrera l'érotisme tauromachique dans son roman les Bestiaires (1926), qui insère, dans l'ensemble de l'œuvre, un cycle solaire avec le poème dramatique Pasiphaé (1928) et, dans une certaine mesure, avec les Olympiques (1924) — série d'essais et de nouvelles
à la gloire du stade. Le sport renouvelle pour Montherlant les vertus de la guerre. La guerre, c'est « le seul lieu où vous ayez pu aimer les hommes », écrira-t-il dans le Chant funèbre pour les morts de Verdun (1924) ; et le roman d'un jeune volontaire (le Songe, 1922) qualifie la guerre de « saint royaume des forts » où l'homme s'ouvre à la sympathie et à la fraternité.
En 1925, Montherlant quitte Paris. Réaliser la féerie, se désolidariser sont les sentiments qui le poussent à gagner le large. Sept années d'errance en Espagne, en Italie, en Afrique du Nord vont constituer dans la vie de l'écrivain une époque charnière, le temps de la crise des « voyageurs traqués » — selon le titre donné à l'un des essais d'Aux fontaines du désir (1927). Montherlant expérimente l'équivalence du « j'ai tout et tout m'échappe », et cherche réconfort dans l'idée d'un ciel vide. La féerie, que l'écrivain définira comme la mise en pratique de sa poésie, sera avec le jeu, la feinte, le service inutile, les réponses à une vie considérée comme une partie perdue d'avance. Mais cette féerie a besoin de « repoussoirs » pour se renouveler. Aussi le texte Syncrétisme et Alternance (1926) offre-t-il la clé de l'œuvre : l'homme doit reconnaître le rythme essentiel de la Nature qui est toute alternance, et y adhérer pleinement. C'est le rythme du oui et du non « dansant comme deux mouches accouplées » (expression de la reine Jeanne la Folle dans le Cardinal d'Espagne} ; ce oui et ce non qui, avouera Montherlant dans ses Carnets de 1968-1971 (la Marée du soir, 1972), « pèsent également et tour à tour », le faisant double et l'équilibrant. C'est le rythme que l'écrivain décèle dans l'Ecclésiaste, œuvre avec laquelle il « consonne entièrement ». En même temps va s'affirmer chez lui une connivence inébranlable avec la vie (« Quand on la retourne et qu'on la voit à fond, quand on voit ce qui est, il y a de quoi tomber à genoux »). Aussi sera-t-il inlassablement en quête de ce n'importe quoi qui remue la vie ; en quête de la saisie d'un réel en mouvement fait de sensations diverses, pures et simples.
L'histoire de la Petite Infante de Castille (1929) résume, sur un mode allègre, l'aventure du « voyageur », jouant avec « les bonheurs qu'il déchiquette et rejette », exaltant dans le plaisir sensuel la liberté, tantôt de prendre pour n'être pas pris, tantôt de renoncer pour garder au désir sa saveur. Montherlant travaille à la Rose de sable, roman qu'il qualifie d'objectif et d'anticolonialiste (il en ajournera la publication qu'il juge inopportune à cause des difficultés que traverse la France de 1932 : le livre paraîtra en 1968). Mais les Célibataires (1934) obtiennent le grand prix de littérature à l'Académie française, et le North Cliffe-Heinemann à Londres : l'écrivain y traite un sujet poignant — les délaissés — avec un naturalisme enjoué, ton très rare dans le roman français contemporain. Et les quatre volumes des Jeunes Filles (1936-1939) sont l'un des plus grands succès d'édition de l'entre-deux-guerres. Pendant cette même période, Montherlant réunit ses Carnets en vue de les publier et regroupe dans Service inutile (1935) des essais consacrés aux chemins d'une conduite individuelle fondée sur l'indépendance et la défense de la qualité humaine : « L'âme dit : service, et l'intelligence dit : inutile » ; ce que nous faisons pour les autres est inutile pour eux, mais peut satisfaire notre « part divine ». L'homme doit rechercher exclusivement une communication avec la « part la plus haute » de lui-même et, pour ce faire, il doit se rendre libre des circonstances, des aléas de la vie, en développant la « passion de l'indifférence ». Cette ligne de conduite fondamentale servira de base aux conseils donnés à un jeune homme dans la Lettre d'un père à son fils.
Durant les quelques années qui précèdent la Seconde Guerre mondiale, Montherlant tient à garder une position « apolitique » : il écrit dans des journaux et revues politiquement opposés. Pourtant, les événements de 1938 ne le laissent pas indifférent. Croyant à l'imminence d'une guerre franco-alle
970
mande, il se mobilise lui-même et part pour la ligne Maginot. Dans les essais composant l'Équinoxe de septembre (1938), l'écrivain s'en prend à « l'esprit de Munich ». En 1940, Montherlant est correspondant de guerre pour l'hebdomadaire Marianne : l'aventure est relatée dans le Rêve des guerriers, roman et journal de route sur la défaite française que son auteur détruira en partie, le jugeant trop « cruel » — ce qui en subsiste sera publié en 1953, avec d'autres essais rassemblés dans Textes sous une occupation. Les écrits de cette période troublée trahissent chez Montherlant deux attitudes contraires : une « réserve » pour sa propre destinée, pour son art, et une angoisse insupportable devant la destinée tragique de la France. Il travaille cependant à Solstice de juin, qui, d'abord interdit par les autorités allemandes d'occupation, paraîtra en octobre 1941. Parce qu'il présente — particulièrement dans le texte intitulé « les Chenilles » — l'acceptation de l'armistice comme l'accolade sportive après le match entre vainqueurs et vaincus, on a pu manquer le sens profond que désigne le titre même : à la défaite se substitue le mythe solaire de la Roue qui tourne et annonce une résurrection de la France. Ces pages s'achèvent significativement sur un texte bref : « le Sourire et le Silence ».
Après ces derniers « écrits publics », Montherlant fait retraite dans le théâtre. À l'âge de dix-huit ans, il avait écrit une pièce (TExil), où il transposait son aventure personnelle (l'engagement à la guerre). Mais c'est dans la maturité de l'âge que s'ouvre l'ère des grandes œuvres dramatiques — douze entre 1942 et 1965. L'occasion d'aborder la scène de la Comédie-Française s'offre à Montherlant lorsque J.-L. Vaudoyer lui suggère d'écrire une pièce traduite et adaptée de l'espagnol. L'écrivain choisit Régner après sa mort de Guevara, mais en change pratiquement tout le contenu : ce sera la Reine morte, en 1942. Les trois facultés : lucidité, diversité et mobilité, qui, d'après Montherlant, sont à la base de son œuvre de fiction, l'ont porté à écrire un théâtre exclusivement psychologique, un théâtre « tout intérieur » derrière lequel se retranche le poète tragique pour « crier les hauts secrets qu'on ne dit qu'à voix basse ». Montherlant s'insurge contre ceux qui tentent de définir son théâtre par « le goût de la grandeur », car il ne s'agit pas de grandeur, mais de connaissance de l'homme. Aussi propose-t-il comme titre général à son théâtre : « un théâtre de caractères », précisant que « ces caractères s'élèvent par moments, pour retomber, ensuite, à un niveau moyen ou bas ». Montherlant a pris soin de commenter son théâtre dans de nombreuses notes, en particulier celles qui ont été rassemblées dans la Tragédie sans masque (1972). Il spécifiera le caractère littéraire de son théâtre : « Voir n'est pas lire, et seul le volume compte. » Cela ne l'empêchera pas d'être assidu aux répétitions, et de travailler étroitement avec les metteurs en scène et les comédiens. Tragédies de l'aveuglement, de la faiblesse, de la peur, de l'honnêteté : tout l'homme. Qu'elles soient de veine chrétienne [le Maître de Santiago, 1947 ; la Ville dont le prince est un enfant, 1951 ; Port-Royal, 1954), de veine espagnole (le Cardinal d'Espagne, 1960), de veine italienne et romaine (Malatesta, 1950 ; la Guerre civile, 1965), ou qu'elles soient « en veston » (Fils de personne, 1943 ; Demain il fera jour, 1949 ; Celles qu 'on prend dans ses bras, 1950), toutes ces pièces sont orientées autour de problèmes qui se rapportent à la nature permanente de l'homme. Aussi a-t-on qualifié l'œuvre dramatique de Montherlant de « néoclassique ». Mais Montherlant n'imite pas, et c'est sur ce point qu'il se sépare le plus radicalement des classiques auxquels il reproche d'avoir érigé en système le manque d'originalité. Pour Montherlant, l'auteur dramatique doit tirer son œuvre de lui-même ; elle doit naître d'une « nécessité intérieure ».
Les Carnets, de 1930 à 1972, révèlent une continuité des convictions, une permanence des thèmes, particulièrement de l'amour de la vie et de la hantise de la mort qui s'affirmera de plus en plus dans les dernières œuvres. Dans son
roman le Chaos et la Nuit (1963), Montherlant pose la question du sens de la vie alors qu'il « organise » la mort de son personnage, Célestino, dont le dernier mot sera « indifférence ». Aussi pensait-il « expulser l'horreur de la mort » ou la mettre « derrière lui ». Un assassin est mon maître dénonce un monde égoïste qui ne connaît plus le précepte de l'amour du prochain. L'œuvre montherlantienne, tragique et heureuse, œuvre à « l'écriture royale » — selon l'expression d'A. Malraux —, s'achève sur un récit posthume Mais aimons-nous ceux que nous aimons ? Ces pages évoquent les joies de sa vie antérieure tissées par l'amitié et l'amour, « la matière de son œuvre ». Cette vie « qui fut une retraite perpétuelle tantôt dans le travail, tantôt dans le plaisir », il en fixa volontairement le terme, par le suicide, le 21 septembre 1972, jour de l'équinoxe — geste libre prolongé par la dispersion de ses cendres sur le Forum à Rome.

«
n'éprouve plus rien pour Solange et excédé
d'une femme qu'il trouve désormais « cram
pon ».
il rompt définitivement.
Pendant ce temps, Andrée Hacquebaut n'a cessé de lui envoyer de longues lettres, qu'il n'a pas ouvertes.
Épilogue (sous forme de 1 1 lettres).
1 928 : Costals réussit à se débarrasser d'Andrée Hacquebaut.
1929 : Solange essaie de renouer; en vain.
1930 : Solange se marie.
1931 : Solange essaie encore
de renouer ; de nouveau en vain.
Appendice.
Quelques définitions de l'univers de Costals.
Réflexions sur la femme relues par-dessus l'épaule de sa dernière conquête.
L'intérêt de cette série n'est certes
pas événementiel :
«Ce drame est le
plus bourgeois des drames.
Si j'en fai
sais un roman, ce serait un roman
affreusement plat et prosaïque >>, peut
on dire avec Costals.
Il ne réside pas
davantage dans ces jeunes filles stéréo
typées : Andrée Hacquebaut, frustrée
« d'un type classique » (la Marée du soir,
1972), hystériquement délirante;
« Thérèse Pantevin la folle mystique >>
(ibid.) ; Solange Dandillot, oie blanche,
prédisposée à se faire plumer.
L'ensem
ble ne tient que par le liant du regard
que jette sur elles et sur lui-même le
héros,
et par la recherche d'une narra
tion aux modalités variées.
En
Pierre Costals, Montherlant
campa « un personnage que, de propos
délibéré,
il a voulu inquiétant, voire
par
moments odieux>> (Avertissement,
LJF), qui choqua à l'époque.
Peu
importe qu'on ait voulu reconnaître en
lui l'auteur lui-même : « Ce que j'ai mis
de
moi en lui ne regarde pas le public >>
(Note, LDB), l'important est que le
héros apparaisse comme le
pendant
masculin de l'héroïne de la Garçonne
(1922) de Victor Margueritte.
Costals
est un don juan dont les propos abon
dent en remarques cyniques, en sen
tences misogynes, et dont le comporte
ment en nombre de circonstances se
traduit par des actes de véritable
cruauté,
notamment lorsque, pour se
venger
et édifier Solange, il attire Andrée
Hacquebaut
dans un traque
nard et la traite odieusement (PPF).
Son refus de la comédie humaine, voire
sa muflerie, trouvent matière à
s'exer
cer sur le couple caricatural des Dandil
lot et sur les jeunes femmes qui le
poursuivent.
Mais
en fait cette sincé
rité et cette lucidité dont il se targue ne
sont que nobles oripeaux dont il mas
que ce qui chez lui est fondamental et
revient sans cesse sous sa
plume : le
désir farouche de préserver sa liberté.
Tant que le délire mystique et la
pas
sion hystérique de ses correspondantes
ne portent pas atteinte à sa vie privée,
il joue modérément le jeu, sans toute
fois faire dê concessions.
Bien qu'il
sache qu'il n'aime pas Solange « à
fond,,, il est capable d'élans chaleu
reux envers elle à Paris et à Gênes.
Mais
que,
d'une manière ou d'une autre, on
attente à sa liberté, que l'« Hippo
griffe » du mariage le serre de trop près,
alors
Costals se déchaîne : son égocen
trisme dépourvu de.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Jeunes Filles (les). Tétralogie romanesque d'Henry Marie-Joseph Millon de Montherlant (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)
- MONTHERLANT, Henry Millon de (1895-1972) Ecrivain, il célèbre la grandeur antique dans ses poèmes et romans, écrits dans un style classique.
- Montherlant (Henry Millon de ), 1895-1972, né à Paris, écrivain français.
- MONTHERLANT, Henry Millon de (1895-1972)Ecrivain, il célèbre la grandeur antique dans ses poèmes et romans, écrits dans un style classique.
- Henry Millon de MONTHERLANT : Le Démon du bien