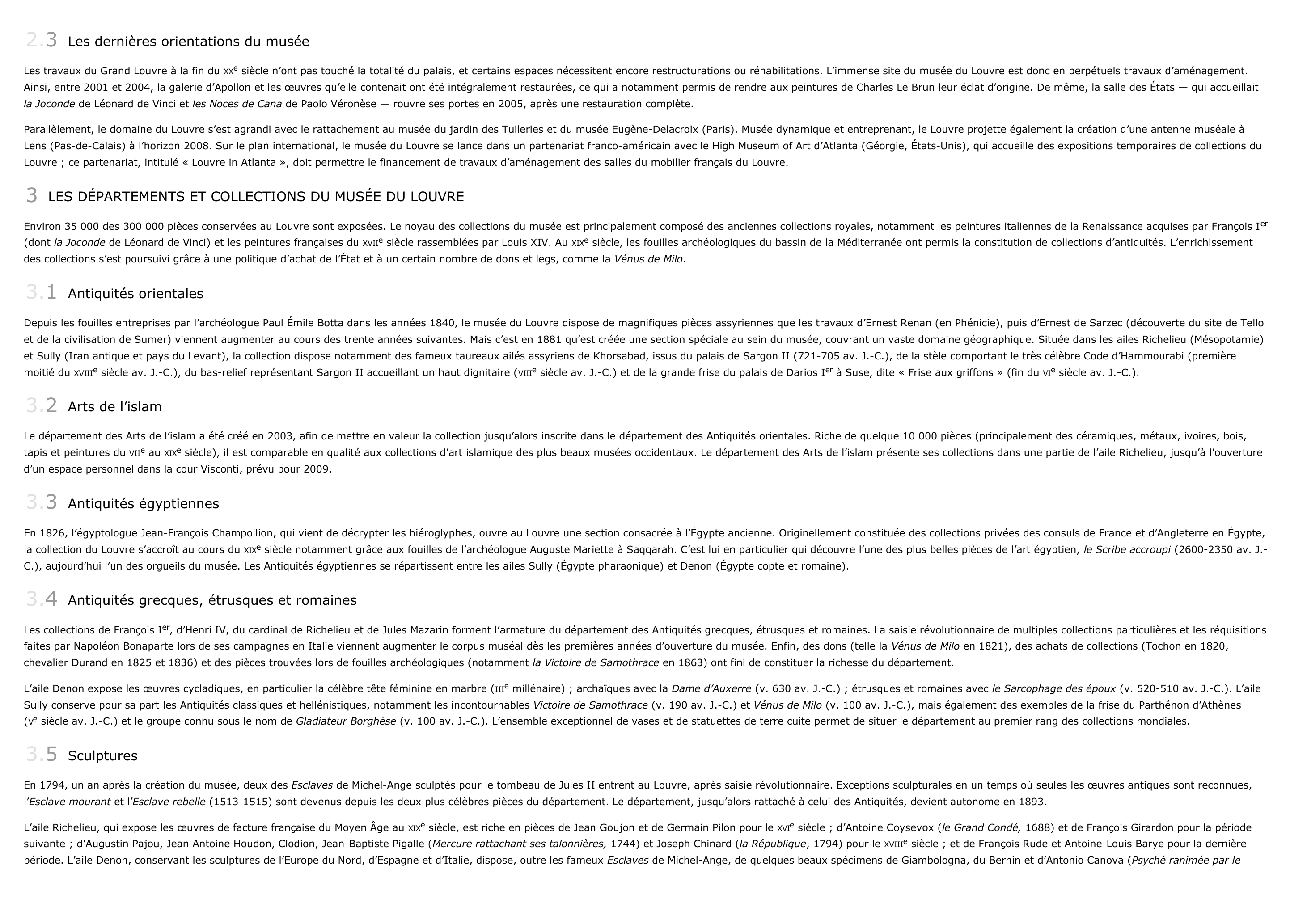Louvre, musée du - beaux-arts.
Publié le 14/05/2013
Extrait du document
«
2. 3 Les dernières orientations du musée
Les travaux du Grand Louvre à la fin du XXe siècle n’ont pas touché la totalité du palais, et certains espaces nécessitent encore restructurations ou réhabilitations.
L’immense site du musée du Louvre est donc en perpétuels travaux d’aménagement.
Ainsi, entre 2001 et 2004, la galerie d’Apollon et les œuvres qu’elle contenait ont été intégralement restaurées, ce qui a notamment permis de rendre aux peintures de Charles Le Brun leur éclat d’origine.
De même, la salle des États — qui accueillait
la Joconde de Léonard de Vinci et les Noces de Cana de Paolo Véronèse — rouvre ses portes en 2005, après une restauration complète.
Parallèlement, le domaine du Louvre s’est agrandi avec le rattachement au musée du jardin des Tuileries et du musée Eugène-Delacroix (Paris).
Musée dynamique et entreprenant, le Louvre projette également la création d’une antenne muséale à
Lens (Pas-de-Calais) à l’horizon 2008.
Sur le plan international, le musée du Louvre se lance dans un partenariat franco-américain avec le High Museum of Art d’Atlanta (Géorgie, États-Unis), qui accueille des expositions temporaires de collections du
Louvre ; ce partenariat, intitulé « Louvre in Atlanta », doit permettre le financement de travaux d’aménagement des salles du mobilier français du Louvre.
3 LES DÉPARTEMENTS ET COLLECTIONS DU MUSÉE DU LOUVRE
Environ 35 000 des 300 000 pièces conservées au Louvre sont exposées.
Le noyau des collections du musée est principalement composé des anciennes collections royales, notamment les peintures italiennes de la Renaissance acquises par François I er
(dont la Joconde de Léonard de Vinci) et les peintures françaises du XVII e siècle rassemblées par Louis XIV.
Au XIXe siècle, les fouilles archéologiques du bassin de la Méditerranée ont permis la constitution de collections d’antiquités.
L’enrichissement
des collections s’est poursuivi grâce à une politique d’achat de l’État et à un certain nombre de dons et legs, comme la Vénus de Milo .
3. 1 Antiquités orientales
Depuis les fouilles entreprises par l’archéologue Paul Émile Botta dans les années 1840, le musée du Louvre dispose de magnifiques pièces assyriennes que les travaux d’Ernest Renan (en Phénicie), puis d’Ernest de Sarzec (découverte du site de Tello
et de la civilisation de Sumer) viennent augmenter au cours des trente années suivantes.
Mais c’est en 1881 qu’est créée une section spéciale au sein du musée, couvrant un vaste domaine géographique.
Située dans les ailes Richelieu (Mésopotamie)
et Sully (Iran antique et pays du Levant), la collection dispose notamment des fameux taureaux ailés assyriens de Khorsabad, issus du palais de Sargon II (721-705 av.
J.-C.), de la stèle comportant le très célèbre Code d’Hammourabi (première
moitié du XVIII e siècle av.
J.-C.), du bas-relief représentant Sargon II accueillant un haut dignitaire ( VIIIe siècle av.
J.-C.) et de la grande frise du palais de Darios I er à Suse, dite « Frise aux griffons » (fin du VIe siècle av.
J.-C.).
3. 2 Arts de l’islam
Le département des Arts de l’islam a été créé en 2003, afin de mettre en valeur la collection jusqu’alors inscrite dans le département des Antiquités orientales.
Riche de quelque 10 000 pièces (principalement des céramiques, métaux, ivoires, bois,
tapis et peintures du VIIe au XIXe siècle), il est comparable en qualité aux collections d’art islamique des plus beaux musées occidentaux.
Le département des Arts de l’islam présente ses collections dans une partie de l’aile Richelieu, jusqu’à l’ouverture
d’un espace personnel dans la cour Visconti, prévu pour 2009.
3. 3 Antiquités égyptiennes
En 1826, l’égyptologue Jean-François Champollion, qui vient de décrypter les hiéroglyphes, ouvre au Louvre une section consacrée à l’Égypte ancienne.
Originellement constituée des collections privées des consuls de France et d’Angleterre en Égypte,
la collection du Louvre s’accroît au cours du XIXe siècle notamment grâce aux fouilles de l’archéologue Auguste Mariette à Saqqarah.
C’est lui en particulier qui découvre l’une des plus belles pièces de l’art égyptien, le Scribe accroupi (2600-2350 av.
J.-
C.), aujourd’hui l’un des orgueils du musée.
Les Antiquités égyptiennes se répartissent entre les ailes Sully (Égypte pharaonique) et Denon (Égypte copte et romaine).
3. 4 Antiquités grecques, étrusques et romaines
Les collections de François I er, d’Henri IV, du cardinal de Richelieu et de Jules Mazarin forment l’armature du département des Antiquités grecques, étrusques et romaines.
La saisie révolutionnaire de multiples collections particulières et les réquisitions
faites par Napoléon Bonaparte lors de ses campagnes en Italie viennent augmenter le corpus muséal dès les premières années d’ouverture du musée.
Enfin, des dons (telle la Vénus de Milo en 1821), des achats de collections (Tochon en 1820,
chevalier Durand en 1825 et 1836) et des pièces trouvées lors de fouilles archéologiques (notamment la Victoire de Samothrace en 1863) ont fini de constituer la richesse du département.
L’aile Denon expose les œuvres cycladiques, en particulier la célèbre tête féminine en marbre ( IIIe millénaire) ; archaïques avec la Dame d’Auxerre (v.
630 av.
J.-C.) ; étrusques et romaines avec le Sarcophage des époux (v.
520-510 av.
J.-C.).
L’aile
Sully conserve pour sa part les Antiquités classiques et hellénistiques, notamment les incontournables Victoire de Samothrace (v.
190 av.
J.-C.) et Vénus de Milo (v.
100 av.
J.-C.), mais également des exemples de la frise du Parthénon d’Athènes
(Ve siècle av.
J.-C.) et le groupe connu sous le nom de Gladiateur Borghèse (v.
100 av.
J.-C.).
L’ensemble exceptionnel de vases et de statuettes de terre cuite permet de situer le département au premier rang des collections mondiales.
3. 5 Sculptures
En 1794, un an après la création du musée, deux des Esclaves de Michel-Ange sculptés pour le tombeau de Jules II entrent au Louvre, après saisie révolutionnaire.
Exceptions sculpturales en un temps où seules les œuvres antiques sont reconnues,
l’Esclave mourant et l’ Esclave rebelle (1513-1515) sont devenus depuis les deux plus célèbres pièces du département.
Le département, jusqu’alors rattaché à celui des Antiquités, devient autonome en 1893.
L’aile Richelieu, qui expose les œuvres de facture française du Moyen Âge au XIXe siècle, est riche en pièces de Jean Goujon et de Germain Pilon pour le XVIe siècle ; d’Antoine Coysevox ( le Grand Condé, 1688) et de François Girardon pour la période
suivante ; d’Augustin Pajou, Jean Antoine Houdon, Clodion, Jean-Baptiste Pigalle ( Mercure rattachant ses talonnières, 1744) et Joseph Chinard ( la République , 1794) pour le XVIII e siècle ; et de François Rude et Antoine-Louis Barye pour la dernière
période.
L’aile Denon, conservant les sculptures de l’Europe du Nord, d’Espagne et d’Italie, dispose, outre les fameux Esclaves de Michel-Ange, de quelques beaux spécimens de Giambologna, du Bernin et d’Antonio Canova ( Psyché ranimée par le.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le musée des Beaux— Arts de Rennes
- Le musée des Beaux Arts de Lyon
- Le musée des Beaux Arts de Dijon
- Le musée des Beaux Arts de Dijon (3)
- Le musée des Beaux—Arts de Lyon (3)