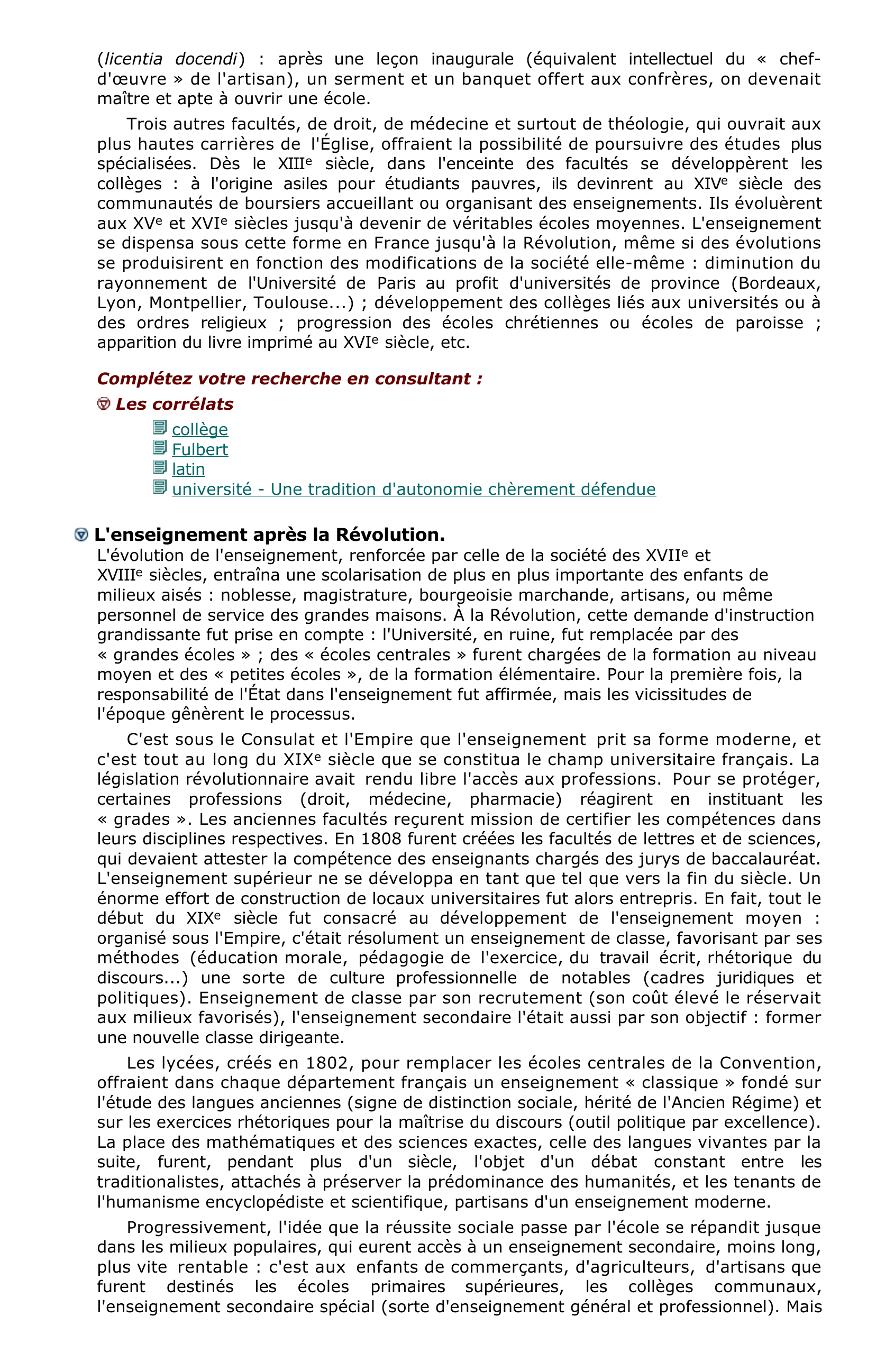Les institutions et pratiques éducatives sont étroitement liées aux systèmes sociaux.
Publié le 27/10/2013

Extrait du document
«
(licentia docendi ) : après une leçon inaugurale (équivalent intellectuel du « chef-
d'œuvre » de l'artisan), un serment et un banquet offert aux confrères, on devenait
maître et apte à ouvrir une école.
Trois autres facultés, de droit, de médecine et surtout de théologie, qui ouvrait aux
plus hautes carrières de l'Église, offraient la possibilité de poursuivre des études plus
spécialisées.
Dès le XIII e siècle, dans l'enceinte des facultés se développèrent les
collèges : à l'origine asiles pour étudiants pauvres, ils devinrent au XIV e siècle des
communautés de boursiers accueillant ou organisant des enseignements.
Ils évoluèrent
aux XV e et XVI e siècles jusqu'à devenir de véritables écoles moyennes.
L'enseignement
se dispensa sous cette forme en France jusqu'à la Révolution, même si des évolutions
se produisirent en fonction des modifications de la société elle-même : diminution du
rayonnement de l'Université de Paris au profit d'universités de province (Bordeaux,
Lyon, Montpellier, Toulouse...) ; développement des collèges liés aux universités ou à
des ordres religieux ; progression des écoles chrétiennes ou écoles de paroisse ;
apparition du livre imprimé au XVI e siècle, etc.
Complétez votre recherche en consultant :
Les corrélats
collège
Fulbert
latin
université - Une tradition d'autonomie chèrement défendue
L'enseignement après la Révolution.
L'évolution de l'enseignement, renforcée par celle de la société des XVII e et
XVIII e siècles, entraîna une scolarisation de plus en plus importante des enfants de
milieux aisés : noblesse, magistrature, bourgeoisie marchande, artisans, ou même
personnel de service des grandes maisons.
À la Révolution, cette demande d'instruction
grandissante fut prise en compte : l'Université, en ruine, fut remplacée par des
« grandes écoles » ; des « écoles centrales » furent chargées de la formation au niveau
moyen et des « petites écoles », de la formation élémentaire.
Pour la première fois, la
responsabilité de l'État dans l'enseignement fut affirmée, mais les vicissitudes de
l'époque gênèrent le processus.
C'est sous le Consulat et l'Empire que l'enseignement prit sa forme moderne, et
c'est tout au long du XIX e siècle que se constitua le champ universitaire français.
La
législation révolutionnaire avait rendu libre l'accès aux professions.
Pour se protéger,
certaines professions (droit, médecine, pharmacie) réagirent en instituant les
« grades ».
Les anciennes facultés reçurent mission de certifier les compétences dans
leurs disciplines respectives.
En 1808 furent créées les facultés de lettres et de sciences,
qui devaient attester la compétence des enseignants chargés des jurys de baccalauréat.
L'enseignement supérieur ne se développa en tant que tel que vers la fin du siècle.
Un
énorme effort de construction de locaux universitaires fut alors entrepris.
En fait, tout le
début du XIX e siècle fut consacré au développement de l'enseignement moyen :
organisé sous l'Empire, c'était résolument un enseignement de classe, favorisant par ses
méthodes (éducation morale, pédagogie de l'exercice, du travail écrit, rhétorique du
discours...) une sorte de culture professionnelle de notables (cadres juridiques et
politiques).
Enseignement de classe par son recrutement (son coût élevé le réservait
aux milieux favorisés), l'enseignement secondaire l'était aussi par son objectif : former
une nouvelle classe dirigeante.
Les lycées, créés en 1802, pour remplacer les écoles centrales de la Convention,
offraient dans chaque département français un enseignement « classique » fondé sur
l'étude des langues anciennes (signe de distinction sociale, hérité de l'Ancien Régime) et
sur les exercices rhétoriques pour la maîtrise du discours (outil politique par excellence).
La place des mathématiques et des sciences exactes, celle des langues vivantes par la
suite, furent, pendant plus d'un siècle, l'objet d'un débat constant entre les
traditionalistes, attachés à préserver la prédominance des humanités, et les tenants de
l'humanisme encyclopédiste et scientifique, partisans d'un enseignement moderne.
Progressivement, l'idée que la réussite sociale passe par l'école se répandit jusque
dans les milieux populaires, qui eurent accès à un enseignement secondaire, moins long,
plus vite rentable : c'est aux enfants de commerçants, d'agriculteurs, d'artisans que
furent destinés les écoles primaires supérieures, les collèges communaux,
l'enseignement secondaire spécial (sorte d'enseignement général et professionnel).
Mais.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Histoire des institutions éducatives
- Rapports sociaux et institutions : l'expression politique des rapports de force
- L’ACCÈS A LA CULTURE :LA POLITIQUE CULTURELLE DE L'ETAT (Travaux Pratiques Encadrés – Institutions & Politique)
- La diplomatie (Travaux Pratiques Encadrés – Institutions & Politique)
- La fonction publique (Travaux Pratiques Encadrés – Institutions & Politique)