Le symbolique en psychanalyse
Publié le 07/04/2015
Extrait du document
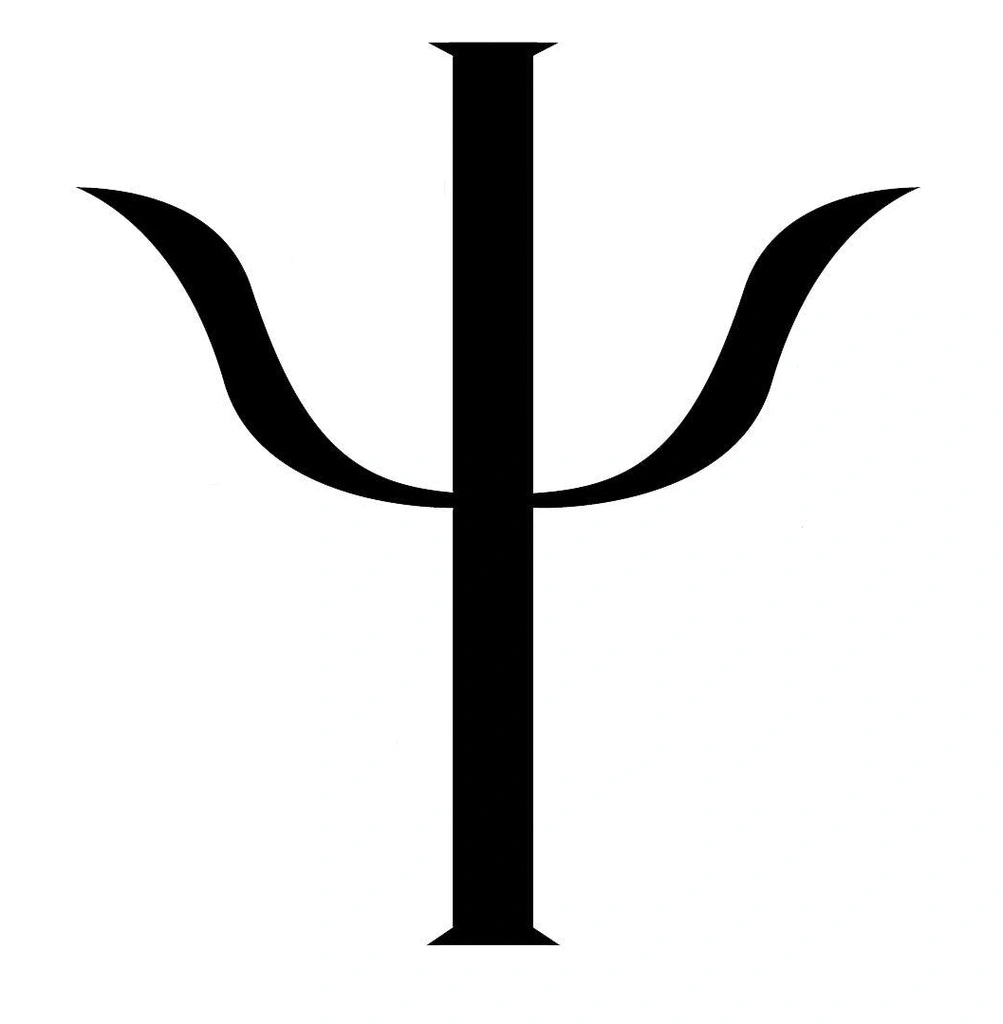
une part consciente et une part inconsciente, qui est attachée à la fonction du langage et plus spécialement à celle du signifiant.
Le symbolique fait de l'homme un animal (« parlêtre «) fondamentalement régi, subverti par le langage, lequel détermine les formes de son lien social et plus essentiellement de ses choix sexués. On parle préférentiellement d'un ordre symbolique au sens où la psychanalyse a très tôt reconnu sa primauté dans la mise en oeuvre du jeu des signifiants qui conditionnent le symptôme, d'une part, d'autre part comme étant le véritable ressort du complexe d'CEdipe, qui porte ses conséquences dans la vie affective ; enfin, son principe a été reconnu comme organisant de façon sous-jacente les formes préva-lentes de l'imaginaire (effets de compétition, de prestance, d'agression et de séduction).
CARACTÈRE UNIVERSEL DU SYMBOLIQUE
Le fait symbolique remonte à la plus haute mémoire de la relation de l'homme au langage et est attesté par les monuments les plus somptueux laissés par le temps comme par les manifestations les plus humbles et primitives de groupes sociaux : stèles, tertres, tumulus, tombeaux, gravures murales, signes marqués dans la pierre, premières écritures, etc., lesquels témoignent de la relation universelle et première de l'homme au signifiant et donc de sa reconnaissance comme être de langage. Car, sans lui, point de traces intentionnelles et symboliques concevables du passage de l'homme.
L'ethnographie des sociétés dites « primitives « a par ailleurs montré qu'un ordre symbolique (loi de l'exogamie par exemple) réglait dans le cadre des liens de parenté la circulation des biens, des animaux, des femmes; ordre qui opère autant de façon contraignante dans sa forme qu'inconsciente dans sa structure et qui, par-delà
l'échange de dons, les pactes d'alliance, la prescription de sacrifices, les rituels religieux, les prohibitions, les tabous, etc., suppose en dernière instance des lois de la parole au fondement de ces systèmes, dont l'anthropologie structurale a révélé le caractère universel de pur formalisme logique.
L'ordre symbolique, en tant que structure inconsciente, est par conséquent à distinguer du dit symbolisme, habituellement attaché à un objet déterminé : clés d'une cité, épée seigneuriale, drapeau d'une nation, etc., lesquels, s'ils peuvent s'inscrire dans cet ordre, restent des éléments distincts qui ne le représentent pas en tant que structure.
MANQUE SYMBOLIQUE
Au sens de la psychanalyse est, par définition, symbolique ce qui manque à sa place. Plus généralement, désignant ce qui fait défaut ou ce qui a été perdu (objets, êtres chers), non seulement le symbolique s'inscrit dans l'expérience humaine la plus commune la fonction du manque, mais cette rencontre
La complexité comme le caractère essentiel de cette opération exigent une explication à plusieurs niveaux. Dès sa venue au monde, le petit de l'homme est plongé dans un bain de langage qui lui préexiste et dont il aura à supporter la structure dans son ensemble comme discours de l'Autre. Ce discours est déjà connoté de ses points forts où s'expriment demande et désir de l'Autre à son endroit, discours dans lequel il occupe primordia‑
lement la place d'objet. Mais d'occuper primitivement cette place d'objet éclaire ce fait essentiel qu'au travers de l'expérience de détresse physiologique (allem. Hilflosigkeit, selon S. Freud) en rapport avec les besoins vitaux, c'est néanmoins d'abord à partir d'un manque-à-être qu'est lancé l'appel à l'autre secourable. La réponse de l'autre dès lors se dédouble sur deux registres : d'apporter la possibilité d'une satisfaction d'un besoin, d'un côté, sans pour autant être capable de combler ce manque-à-être au regard duquel est attendue une preuve d'amour. Ainsi, le signifiant de la demande première joue sans cesse sur cette équivoque pour porter ses conséquences au-delà des frontières de l'enfance et aménager au discours de l'Autre inconscient sa place symbolique. Car toute parole va désormais comporter une dimension où, au-delà de ce qu'elle va signifier, est visé quelque chose d'autre qui, par essence n'étant pas articulable dans la demande, désigne dans la parole cette part originellement refoulée. L'Autre se cerne comme lieu, censé détenir les clés de toutes les significations inaccessibles au sujet, et confère à la parole sa portée symbolique, ainsi qu'à l'Autre son obscure autorité.
Mais l'enfant a lui-même à faire l'expérience de ce manque dans sa relation à l'autre et J. Lacan a plusieurs fois repris, dans Au-delà du principe de plaisir (1920) de Freud, l'exemple canonique du jeu de l'enfant avec la bobine pour faire remarquer que les premières manifestations phonatoires malhabiles qui accompagnent le mouvement alterné de disparition (allem. Fort) et de réapparition (allem. Da) instaurent une première opposition phonématique qui connote déjà la présence-absence de l'être cher de ses marques signifiantes. C'est donc par le seul office du langage qu'au-delà de la présence ou de l'ab
sence réelles se réalise l'intégration d'une marque symbolique signifiante, qui se traduit d'abord comme meurtre de la chose, capable d'élever la chose manquante au rang de concept. Plus loin, dans les jeux de langage de l'enfant, il est observable que ce jeu consiste essentiellement en une disjonction du signifiant de sa fonction de signifié, qui, par-delà son rôle de nomination ou de désignation, institue par conséquent dans le langage la dimension symbolique.
Ainsi, l'homme, en tant qu'être de langage, accède à l'ordre symbolique essentiellement au travers de l'opération de la négation. Fait souligné par Freud dans son article sur la dénégation (die Verneinung, 1925, trad. fr. la Négation, 1934, titre auj. contesté), où l'affirmation (Bejahung) du jugement d'attribution s'énonce sur un fond préalable d'absence supposée, voire de rejet primordial (Aussto/3ung). Cet ordre symbolique, constituant du sujet, le détermine de façon inconsciente en le situant dans une radicale altérité par rapport à la chaîne signifiante et où c'est de l'Autre inconscient qu'il reçoit sa signification.
C'est par conséquent sur fond de manque, d'absence, de négation que vient s'élaborer le symbolique dans la fonction signifiante en tant que désignant la perte en général. Le désir, lui, particularise une tentative d'accord entre cet ordre signifiant symbolique qui le surdétermine et l'expérience d'appréhension d'un objet chargé ima-ginairement de représenter la retrou-vaille avec l'objet originairement perdu.
Ces différents points, qui décrivent les modalités de la rencontre primordiale de l'enfant avec le langage dans sa corrélation au manque et dans sa propriété à symboliser, sont décisifs pour appréhender les conséquences et les suites :
1. en effet, ce qui n'est pas articulable dans la demande met en place ce creux
du refoulé originaire, perte qui vient se symboliser au lieu de l'Autre inconscient et qui divise le sujet dans son rapport au signifiant (Spaltung primordiale);
LE RÔLE NORMALISATEUR DE L'OEDIPE ET Minn SYMBOLIQUE
Ce dispositif ne trouve sa structure définitive qu'avec la mise en place de l'cedipe, qui a pour rôle de normaliser le manque en lui assignant un lieu. C'est-à-dire que le signifiant originairement refoulé qui apparaît dans la demande première va dans l'oedipe recevoir sa signification seconde. En effet, l'Autre primordial (autrement dit la mère originaire) supposé supporter le signifiant phallique est interdit par le père. Dès lors, le Nom-du-Père est ce qui, au travers de l'interdit de l'inceste, fait autorité dans la mesure où la mise en place ordonnée du signifiant phallique en tant que refoulé dépend de lui (--> castration [complexe de]) et par là ce Nom-du-Père vient redoubler en place de l'Autre la fonction symbolique. Cela a pour conséquence que le trou du refoulé ainsi introduit dans la chaîne signifiante soutient la structure du désir comme telle unie à la loi, laquelle, en mettant la fonction du manque au principe de son organisation, est la loi qui régit le langage. Cette opération rend compte que ce n'est qu'au lieu de l'Autre symbolique et inconscient que le sujet puisse avoir désormais accès au phallus en tant que signifiant. Et c'est sous forme d'une dette symbolique à l'Autre qu'il en reçoit en retour le devoir de satisfaire
aux conséquences de ce manque. Cette présence du manque, introduite de structure dans l'existence du sujet, comme condition fondatrice du langage, traduit le caractère radical de la détermination du sujet, autant que de son objet, aux conditions du symbole qui l'asservit. En sorte que l'ordre symbolique apparaît non plus constitué par l'homme mais le constitue tout entier sous le coup de la surdétermination signifiante du langage. Cet ordre symbolique est par conséquent disposé selon une chaîne signifiante autonome, extérieure au sujet, lieu de l'Autre inconscient au regard duquel ce sujet ne peut qu'ex-lister sur un mode acéphale, c'est-à-dire tout entier assujetti à cet ordre.
La fonction paternelle s'éclaire de son importance par le fait d'occuper ce lieu symbolique. Freud, dans Totem et Tabou (1912-1913), a montré que, pour le névrosé, ce lieu est occupé par le père mort. C'est le meurtre du père refoulé qui engendre pour le sujet la cohorte des prohibitions, des symptômes et des inhibitions; façon pour le névrosé de prendre en compte la dette et de reconnaître qu'il ne peut assumer son statut de sujet que comme effet d'une combinatoire signifiante, à laquelle il ne peut avoir accès qu'au lieu de l'Autre.
On comprend à partir de là l'importance humaine de ce lieu de l'Autre inconscient et symbolique comme seule référence stable dans la mesure où cet Autre est le lieu du signifiant. Et la fonction de l'analyste trouve son efficacité pour autant qu'il assure cette fonction symbolique Autre non comme personne mais comme lieu, soumis à la condition de l'équivoque du signifiant et non à la signification positive du langage (théorie de la communication). Car la loi du signifiant est d'abord une loi de l'équivoque qui se traduit par le fait que la parole puisse être menteuse, donc symbolique.
RÉPÉTITION ET FONCTION SIGNIFIANTE
C'est bien à ce dernier terme du renoncement à tout idéal de maîtrise du sujet que Freud a été conduit, dans Au-delà du principe de plaisir, avec le concept d'automatisme de répétition. Il est remarquable que l'automatisme de répétition prend son point de départ précisément à la limite du processus de remémoration, soit en ce lieu Autre où se trouve le signifiant originairement refoulé. Mais cet automatisme, indifférent au principe de plaisir comme le constatera Freud, se révèle être un ordre formalisé semblable à une pure écriture littérale symbolique de type logico-mathématique à l'ceuvre dans la chaîne signifiante; écriture à laquelle le sujet est assujetti et qui signifie que son efficacité est attachée au caractère hors-sens (hors signifié) du signifiant, à l'inverse de ce qui se passe avec le symptôme, qui consiste en une précipitation d'un sens. Cependant, si l'automatisme se signale de cette fonction symbolique abstraite, l'exigence de nouveauté qui l'anime joue précisément sur l'équivoque, si bien que l'acteur ne peut reconnaître la structure latente qui se répète dans une autre scène.
L'automatisme de répétition ne souligne pas seulement la primauté du symbolique dans l'action humaine, il permet de reconsidérer l'ensemble des avatars de la subjectivité, tels que le noeud borroméen s'emploie à le démontrer: à savoir que l'imaginaire est sous le coup d'une organisation latente qui le surdétermine non sans que le symbolique lui-même s'organise à partir d'un trou réel, celui du signifiant originairement refoulé qui le conditionne tout entier.
Liens utiles
- symbolique - psychologie & psychanalyse.
- Résumé texte psychanalyse des ado
- Freud : Introduction à la Psychanalyse, explication de texte
- La peste symbolique de Cottard
- Une symbolique du sacrifice































