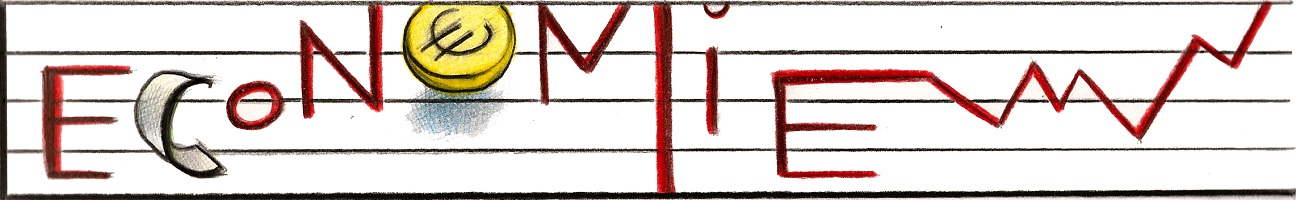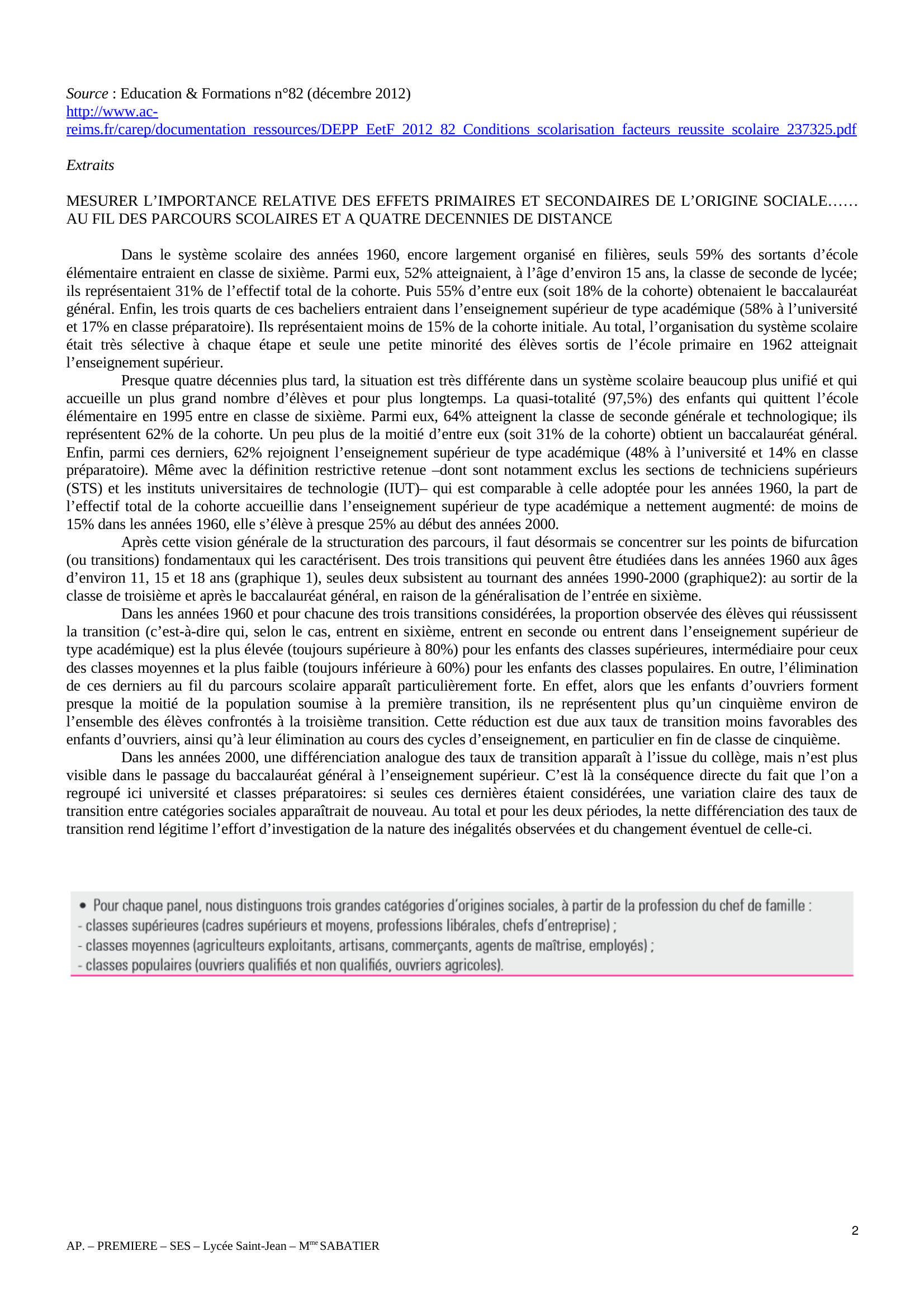Socialisation et Reproduction Sociale
Publié le 17/01/2015

Extrait du document
«
Source : Education & Formations n°82 (décembre 2012)
http://www.ac-
reims.fr/carep/documentation_ressources/DEPP_EetF_2012_82_Conditions_scolarisation_facteurs_reussite_scolaire_237325.pdf
Extraits
MESURER L’IMPORTANCE RELATIVE DES EFFETS PRIMAIRES ET SECONDAIRES DE L’ORIGINE SOCIALE……
AU FIL DES PARCOURS SCOLAIRES ET A QUATRE DECENNIES DE DISTANCE
Dans le système scolaire des années 1960, encore largement organisé en filières, seuls 59% des sortants d’école
élémentaire entraient en classe de sixième.
Parmi eux, 52% atteignaient, à l’âge d’environ 15 ans, la classe de seconde de lycée;
ils représentaient 31% de l’effectif total de la cohorte.
Puis 55% d’entre eux (soit 18% de la cohorte) obtenaient le baccalauréat
général.
Enfin, les trois quarts de ces bacheliers entraient dans l’enseignement supérieur de type académique (58% à l’université
et 17% en classe préparatoire).
Ils représentaient moins de 15% de la cohorte initiale.
Au total, l’organisation du système scolaire
était très sélective à chaque étape et seule une petite minorité des élèves sortis de l’école primaire en 1962 atteignait
l’enseignement supérieur.
Presque quatre décennies plus tard, la situation est très différente dans un système scolaire beaucoup plus unifié et qui
accueille un plus grand nombre d’élèves et pour plus longtemps.
La quasi-totalité (97,5%) des enfants qui quittent l’école
élémentaire en 1995 entre en classe de sixième.
Parmi eux, 64% atteignent la classe de seconde générale et technologique; ils
représentent 62% de la cohorte.
Un peu plus de la moitié d’entre eux (soit 31% de la cohorte) obtient un baccalauréat général.
Enfin, parmi ces derniers, 62% rejoignent l’enseignement supérieur de type académique (48% à l’université et 14% en classe
préparatoire).
Même avec la définition restrictive retenue –dont sont notamment exclus les sections de techniciens supérieurs
(STS) et les instituts universitaires de technologie (IUT)– qui est comparable à celle adoptée pour les années 1960, la part de
l’effectif total de la cohorte accueillie dans l’enseignement supérieur de type académique a nettement augmenté: de moins de
15% dans les années 1960, elle s’élève à presque 25% au début des années 2000.
Après cette vision générale de la structuration des parcours, il faut désormais se concentrer sur les points de bifurcation
(ou transitions) fondamentaux qui les caractérisent.
Des trois transitions qui peuvent être étudiées dans les années 1960 aux âges
d’environ 11, 15 et 18 ans (graphique 1), seules deux subsistent au tournant des années 1990-2000 (graphique2): au sortir de la
classe de troisième et après le baccalauréat général, en raison de la généralisation de l’entrée en sixième.
Dans les années 1960 et pour chacune des trois transitions considérées, la proportion observée des élèves qui réussissent
la transition (c’est-à-dire qui, selon le cas, entrent en sixième, entrent en seconde ou entrent dans l’enseignement supérieur de
type académique) est la plus élevée (toujours supérieure à 80%) pour les enfants des classes supérieures, intermédiaire pour ceux
des classes moyennes et la plus faible (toujours inférieure à 60%) pour les enfants des classes populaires.
En outre, l’élimination
de ces derniers au fil du parcours scolaire apparaît particulièrement forte.
En effet, alors que les enfants d’ouvriers forment
presque la moitié de la population soumise à la première transition, ils ne représentent plus qu’un cinquième environ de
l’ensemble des élèves confrontés à la troisième transition.
Cette réduction est due aux taux de transition moins favorables des
enfants d’ouvriers, ainsi qu’à leur élimination au cours des cycles d’enseignement, en particulier en fin de classe de cinquième.
Dans les années 2000, une différenciation analogue des taux de transition apparaît à l’issue du collège, mais n’est plus
visible dans le passage du baccalauréat général à l’enseignement supérieur.
C’est là la conséquence directe du fait que l’on a
regroupé ici université et classes préparatoires: si seules ces dernières étaient considérées, une variation claire des taux de
transition entre catégories sociales apparaîtrait de nouveau.
Au total et pour les deux périodes, la nette différenciation des taux de
transition rend légitime l’effort d’investigation de la nature des inégalités observées et du changement éventuel de celle-ci.
2
AP.
– PREMIERE – SES – Lycée Saint-Jean – M me
SABATIER.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- SES: Comment la socialisation contribue-t-elle à la construction et à la reproduction des rôles associés au genre ?
- À la différence biologique des sexes, qui permet la reproduction de l'espèce, s'ajoute une différence sociale des sexes, qui s'est construite au cours de l'histoire.
- Après avoir exposé comment la socialisation permet l'intégration sociale des individus, vous montrez qu'elle les différencie aussi.
- La reproduction humaine
- les inégalités sont elles compatibles avec la notion de justice sociale?