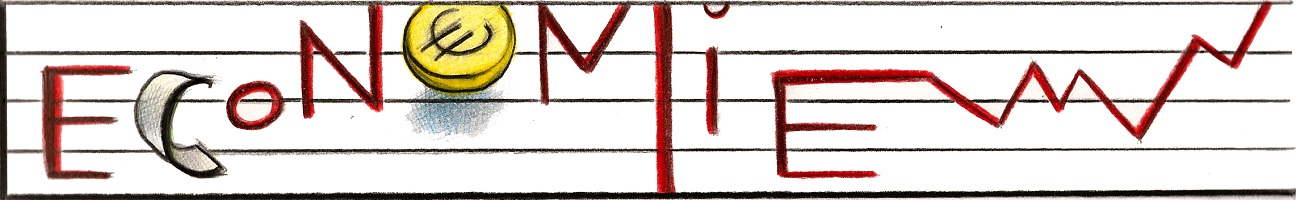Les zones intégrées économiquement sont-elles favorables à la croissance mondiale ?
Publié le 26/06/2012
Extrait du document
Dans la même période, les échanges entre l’Amérique du Nord et l’Asie se sont accrus au rythme de 12,5 % par an alors que le commerce intra-américain n’a progressé que de 8 % par an. Cette évolution montre clairement comment la construction de pôles économiques régionaux dynamiques attire les investissements et stimule l’activité des FMN (Firmes Multinationales) qui représentent l’un des principaux vecteurs de la mondialisation des échanges. Cette tendance au développement du commerce interrégional s’est trouvé récemment renforcée par l’ébauche d’un dialogue entre l’Europe et le MERCOSUR et entre l’Europe et l’Asie dans le cadre de l’ASEM (Asia Europe Meeting). Une conception isolationniste du régionalisme n’est donc guère tenable. Il est beaucoup plus réaliste de considérer que les accords commerciaux signés à l’échelle régionale permettent aux pays de s’ouvrir vers l’extérieur. L’exemple de l’Europe est d’ailleurs encourageant. Il est désormais admis que les créations de trafic l’ont emporté sur les détournements. C’est pourquoi le régionalisme doit être considéré comme un complément du multilatéralisme, à condition toutefois que l’OMC se donne les moyens d’en contrôler les dérives éventuelles.
«
de la zone et le bloc européen représente 30 % du commerce mondial.
Dans ce cas, la mise en place d'accords régionaux s'est accompagnée d'unerégionalisation du commerce.
Faut-il pour autant en conclure que tous les accords régionaux se traduiront par une régionalisation accrue du commerce ?Cela n'est pas certain car si l'on s'appuie sur l'expérience des ententes régionales conclues dans les années 1960 entre de nombreux pays endéveloppement, force est de constater que ces accords ne se sont pas traduits par une intensification du commerce régional ; en outre ces ententes sesont progressivement dégradées.
Inversement, si l'on considère le commerce asiatique, nous constatons que les exportations intra-régionalesreprésentent 46 % du total des échanges de la zone alors qu'il n'existe pas d'accord formalisé.
Nous pouvons donc en déduire que si le commerceinternational est de plus en plus polarisé sur trois zones (Europe, Amérique du Nord et Asie Pacifique), cette tendance reflète beaucoup plus lacroissance économique de ces zones que l'existence d'accords commerciaux.
Par ailleurs, la régionalisation du commerce doit être comprise commeétant un phénomène structurel lié à un ensemble de facteurs de proximité : la distance géographique, mais aussi les liens culturels, historiques etlinguistiques, la similarité des systèmes politiques ou des niveaux de vie.
Les accords commerciaux qui réussissent sont ceux qui viennent compléter unrapprochement déjà bien avancé en raison de cette proximité.
Le meilleur exemple à l'appui de cette idée serait l'exemple européen.
A l'inverse, l'APECqui comprend des membres aussi divers que les Etats-Unis, le Japon, la Corée, la Chine ou la Russie n'a jamais réussi à se structurer.
2) Régionalisme : une logique de blocs ?
L'objectif de l'OMC est de promouvoir un système d'échanges mondial fondé sur un traitement équitable de tous les partenaires commerciaux (clause dela nation la plus favorisée).
Dans cette optique, le développement du régionalisme commercial pourrait représenter un risque de fragmentation del'espace mondial en blocs rivaux, ce qui serait bien évidemment contraire au multilatéralisme préconisait par l'OMC.
Une telle vision s'alimente del'exemple des années 30 où tous les pays qui le pouvaient se sont repliés sur une zone privilégiée (l'empire dans le cas français ou britannique) et oùd'autres nations (telles l'Allemagne, l'Italie ou le Japon) ont pratiqué une double politique d'autarcie et de conquêtes territoriales.
Aujourd'hui cescraintes réapparaissent alors qu'on observe une tripolarisation du commerce mondial et le développement d'un usage régional des grandes monnaies(dollar, euro et yen).
La constitution de blocs régionaux risque de favoriser les détournements de trafic, certains pays membres pouvant être incités àimporter systématiquement des marchandises en provenance d'un pays appartenant au même bloc plutôt que de faire appel à un fournisseur moinscher extérieur à la région.
Un autre risque est que les groupes régionaux décident de barrières tarifaires.
On l'a vu début 1998 lorsque le MERCOSUR asouhaité se protéger contre les exportations des pays asiatiques en crise par un relèvement de ses tarifs.
Enfin, les groupes régionaux peuvent mettreen place des règles spécifiques rendant plus compliquée la définition de règles globales au sein de l'OMC.
Le risque que se constitue une telle logique debloc est-il réel ? Pour l'instant on peut en douter pour plusieurs raisons.
D'abord nous avons vu que le régionalisme commercial ne s'accompagne passystématiquement d'une régionalisation des échanges.
Ensuite, les Etats-Unis appartiennent à deux zones différentes : l'ALENA et l'APEC.
Il leur seraitdélicat d'envisager un repli sur l'une ou l'autre de ces zones, d'autant qu'une telle évolution ne correspondrait pas à leurs ambitions hégémoniques.Enfin, le commerce intrarégional n'empêche pas le développement du commerce interrégional.
Dans la décennie 80, les échanges entre la CEE et leJapon ont été multiplié par 3,8 alors que les échanges intra-européens ne l'étaient que par 2,2.
Dans la même période, les échanges entre l'Amérique duNord et l'Asie se sont accrus au rythme de 12,5 % par an alors que le commerce intra-américain n'a progressé que de 8 % par an.
Cette évolutionmontre clairement comment la construction de pôles économiques régionaux dynamiques attire les investissements et stimule l'activité des FMN (FirmesMultinationales) qui représentent l'un des principaux vecteurs de la mondialisation des échanges.
Cette tendance au développement du commerceinterrégional s'est trouvé récemment renforcée par l'ébauche d'un dialogue entre l'Europe et le MERCOSUR et entre l'Europe et l'Asie dans le cadre del'ASEM (Asia Europe Meeting).
Une conception isolationniste du régionalisme n'est donc guère tenable.
Il est beaucoup plus réaliste de considérer que lesaccords commerciaux signés à l'échelle régionale permettent aux pays de s'ouvrir vers l'extérieur.
L'exemple de l'Europe est d'ailleurs encourageant.
Ilest désormais admis que les créations de trafic l'ont emporté sur les détournements.
C'est pourquoi le régionalisme doit être considéré comme uncomplément du multilatéralisme, à condition toutefois que l'OMC se donne les moyens d'en contrôler les dérives éventuelles.
Sur tous les continents, des intégrations régionales se développent : en Asie, en Amérique, en Afrique.
Cette recomposition des relations internationalesn'est pas neutre.
Certains observateurs considèrent que l'ordre économique mis en place au lendemain de la seconde guerre mondiale est en voie deréorganisation sous l'effet de l'émergence de pôles régionaux.
Même si certains auteurs peuvent analyser l'intégration économique régionale uniquementsous l'angle de la « libéralisation commerciale » (Venables 2000), l'intégration économique régionale ne se limite plus aux seules dimensionscommerciales, elle concerne les mouvements de facteurs (capital et travail), les questions monétaires, la coordination des politiques, les institutionspolitiques… et participe à la création de nouveaux espaces de régulation (Faugère 2000).
L'intégration régionale n'est pas aujourd'hui de façondéterminante de forme commerciale, elle revêt une dimension institutionnelle forte.
Dans ce nouveau régionalisme, l'intégration prend le pas surl'ouverture en incorporant de nouvelles dimensions : investissements, mobilité du travail, coordination des politiques et des réglementationsinfrastructure, protection de l'environnement...
Le régionalisme devient un véritable espace de régulation nécessaire puisqu'il permet aux économies defavoriser leur croissance économique en agissant et réagissant de façon concertée face aux changements conjoncturels (crises, surchauffe, …)..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- la croissance économique mondiale et le développement durable sont-ils conciliables ?
- La croissance économique mondiale (XIXème –XXème siècles)
- NOTE DE CONJONCTURE : « Les incertitudes de la croissance de l’économie mondiale ».
- L'économie mondiale de la croissance à la crise
- CROISSANCE MONDIALE ET COMMERCE MONDIAL