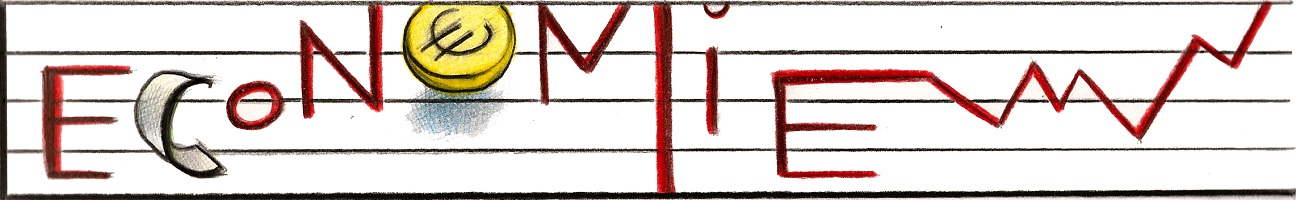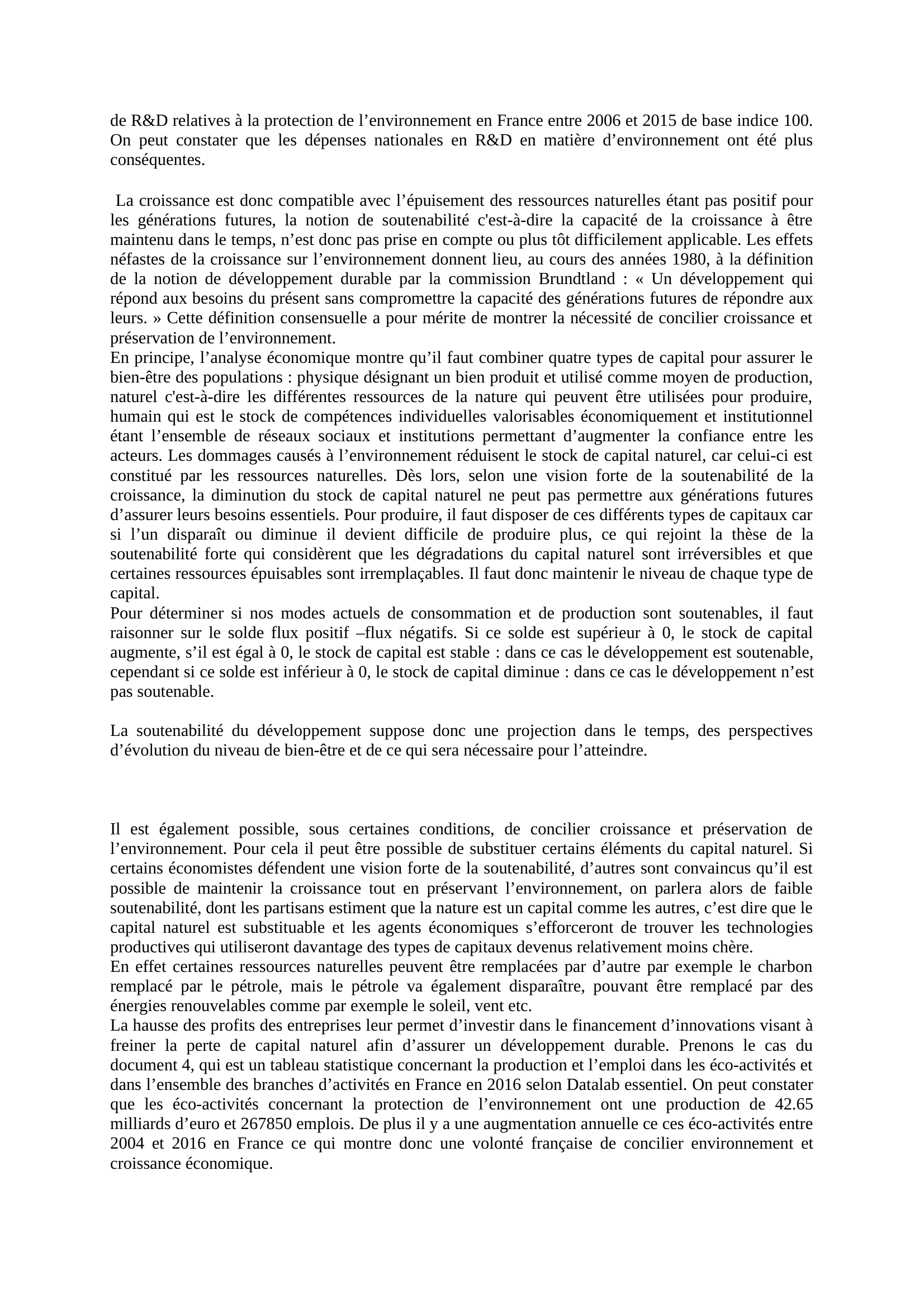La croissance économique nuit-elle à la préservation de l’environnement ?
Publié le 26/04/2020

Extrait du document
La croissance économique conditionne le monde, elle est l’accroissement sur une longue période des quantités de biens et services produites dans un pays. Cette croissance se traduit par une forte empreinte écologique, c'est-à-dire la mesure de la pression qu’exerce l’homme sur l’environnement, par la mesure de l’épuisement du capital naturel qu’entrainent nos activités économiques. En effet en 2007 plus de la moitié de la surface de la mer d’Aral a été perdu par cause d’une surexploitation de coton. Cette perte de ressource naturelle est le résultat d’une modification du mode vie d’une population et permet de prendre conscience des limites de la croissance économique. Ce qui nous amène à la problématique suivante : Est-ce que l’accroissement sur une longue période des quantités de biens et services produites nuit à la préservation de l’environnement ? Afin d’y répondre nous allons tout d’abord voir que la croissance économique nuit à la préservation de l’environnement, puis qu’il est possible de concilier les deux par l’intermédiaire de certaines conditions.
Tout d’abord la croissance économique est un phénomène quantitatif, ce phénomène annuel est créer pour augmenter les niveaux de vie des populations et favoriser une hausse de la richesse. Toutefois du fait que la croissance ne prend pas en compte la préservation de l’environnement et des ressources qui l’habitent sur un long terme, permet de mettre en évidence la prise en compte des limites écologiques de la croissance économique sur le monde. En effet ces limites écologiques apparaissent notamment par cause des pays développés qui depuis les années 70, sont dans un système de surexploitation des ressources naturelles dans le but de satisfaire la demande global des consommateurs. Ce système productiviste peut avoir pour conséquence la disparition définitive de certaines espèces animales, d’où le cas de la Mer d’Aral (document2) à cause de la perte de plus de la moitié de sa surface cela à « réduit la faune sauvage, mais également l’élevage ». Cette disparition d’espèce animale est due par la disparition de l’environnement de ces espèces par la déforestation notamment la forêt d’Amazonie, ou encore les marées noires etc. De plus ce système entraine pour conséquence la pollution de la planète, due à la dégradation des sources d’eau potable, notamment dans le document 2 où : « l’emploi excessif de pesticides et d’engrais a pollué les eaux de surfaces et souterraines », bien sûr conduisant à une multiplication de maladies pour les populations de la région.
Ensuite l’appauvrissement des sols a un impact sur les rendements car les aires de pâturages peuvent diminuer et donc entrainer une forte diminution des récoltes. Et sans oublier que la croissance repose surtout sur l’exploitation de ressources non renouvelables, comme le pétrole, le gaz, ces ressources s’épuisent ce qui n’est pas positif pour les générations futures, car les industries des pays développés les exploitent en pensant au temps présent et non au temps qui suit, et les exploitent de manière excessif et non raisonné ce qui conduit donc à perte définitive.
«
de R&D relatives à la protection de l’environnement en France entre 2006 et 2015 de base indice 100.
On peut constater que les dépenses nationales en R&D en matière d’environnement ont été plus
conséquentes.
La croissance est donc compatible avec l’épuisement des ressources naturelles étant pas positif pour
les générations futures, la notion de soutenabilité c'est-à-dire la capacité de la croissance à être
maintenu dans le temps, n’est donc pas prise en compte ou plus tôt difficilement applicable.
Les effets
néfastes de la croissance sur l’environnement donnent lieu, au cours des années 1980, à la définition
de la notion de développement durable par la commission Brundtland : « Un développement qui
répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux
leurs.
» Cette définition consensuelle a pour mérite de montrer la nécessité de concilier croissance et
préservation de l’environnement.
En principe, l’analyse économique montre qu’il faut combiner quatre types de capital pour assurer le
bien-être des populations : physique désignant un bien produit et utilisé comme moyen de production,
naturel c'est-à-dire les différentes ressources de la nature qui peuvent être utilisées pour produire,
humain qui est le stock de compétences individuelles valorisables économiquement et institutionnel
étant l’ensemble de réseaux sociaux et institutions permettant d’augmenter la confiance entre les
acteurs.
Les dommages causés à l’environnement réduisent le stock de capital naturel, car celui-ci est
constitué par les ressources naturelles.
Dès lors, selon une vision forte de la soutenabilité de la
croissance, la diminution du stock de capital naturel ne peut pas permettre aux générations futures
d’assurer leurs besoins essentiels.
Pour produire, il faut disposer de ces différents types de capitaux car
si l’un disparaît ou diminue il devient difficile de produire plus, ce qui rejoint la thèse de la
soutenabilité forte qui considèrent que les dégradations du capital naturel sont irréversibles et que
certaines ressources épuisables sont irremplaçables.
Il faut donc maintenir le niveau de chaque type de
capital.
Pour déterminer si nos modes actuels de consommation et de production sont soutenables, il faut
raisonner sur le solde flux positif –flux négatifs.
Si ce solde est supérieur à 0, le stock de capital
augmente, s’il est égal à 0, le stock de capital est stable : dans ce cas le développement est soutenable,
cependant si ce solde est inférieur à 0, le stock de capital diminue : dans ce cas le développement n’est
pas soutenable.
La soutenabilité du développement suppose donc une projection dans le temps, des perspectives
d’évolution du niveau de bien-être et de ce qui sera nécessaire pour l’atteindre.
Il est également possible, sous certaines conditions, de concilier croissance et préservation de
l’environnement.
Pour cela il peut être possible de substituer certains éléments du capital naturel.
Si
certains économistes défendent une vision forte de la soutenabilité, d’autres sont convaincus qu’il est
possible de maintenir la croissance tout en préservant l’environnement, on parlera alors de faible
soutenabilité, dont les partisans estiment que la nature est un capital comme les autres, c’est dire que le
capital naturel est substituable et les agents économiques s’efforceront de trouver les technologies
productives qui utiliseront davantage des types de capitaux devenus relativement moins chère.
En effet certaines ressources naturelles peuvent être remplacées par d’autre par exemple le charbon
remplacé par le pétrole, mais le pétrole va également disparaître, pouvant être remplacé par des
énergies renouvelables comme par exemple le soleil, vent etc.
La hausse des profits des entreprises leur permet d’investir dans le financement d’innovations visant à
freiner la perte de capital naturel afin d’assurer un développement durable.
Prenons le cas du
document 4, qui est un tableau statistique concernant la production et l’emploi dans les éco-activités et
dans l’ensemble des branches d’activités en France en 2016 selon Datalab essentiel.
On peut constater
que les éco-activités concernant la protection de l’environnement ont une production de 42.65
milliards d’euro et 267850 emplois.
De plus il y a une augmentation annuelle ce ces éco-activités entre
2004 et 2016 en France ce qui montre donc une volonté française de concilier environnement et
croissance économique..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La croissance économique s’oppose-t-elle à a préservation de environnement ?
- La croissance économique est elle compatible avec la croissance préservation de l'environnement ?
- La croissance économique au sein des PDEM (Pays Développés à Economie de Marché) peut-elle être conciliable avec la préservation de l'environnement ?
- Comment peut-on concilier croissance économique et environnement ?
- La protection de l'environnement est-elle incompatible avec la croissance économique ?