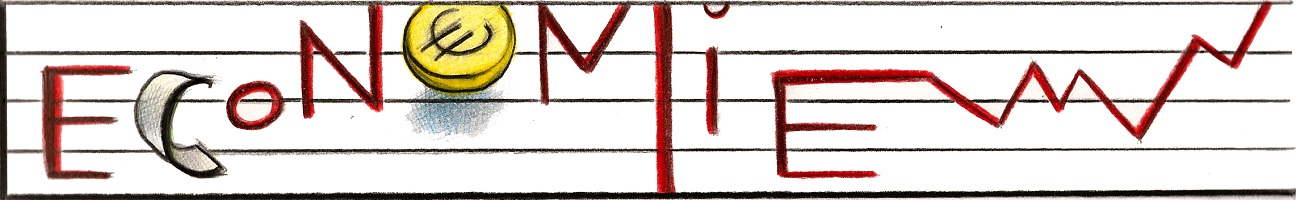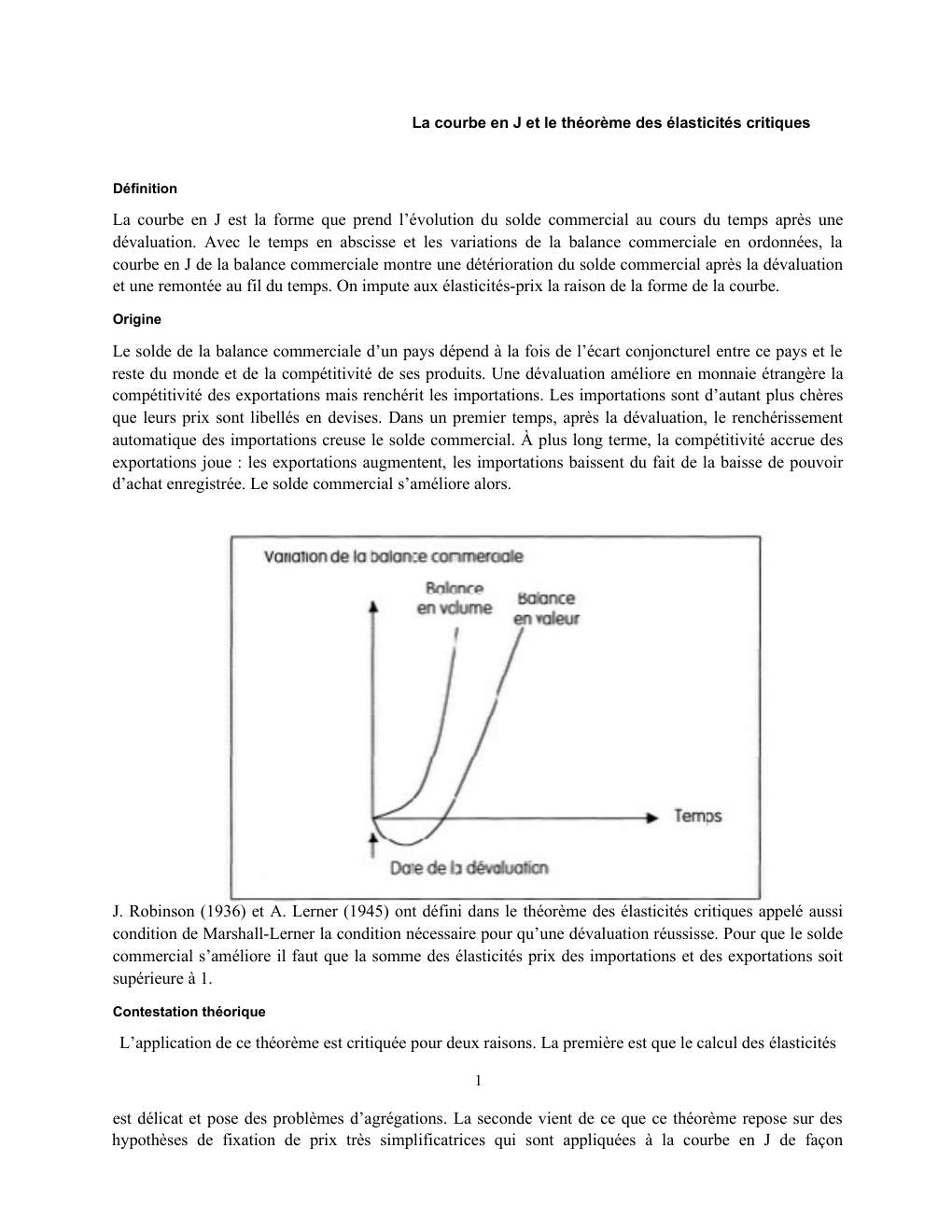La courbe en J et le théorème des élasticités critiques
Publié le 21/01/2025
Extrait du document
«
La courbe en J et le théorème des élasticités critiques
Définition
La courbe en J est la forme que prend l’évolution du solde commercial au cours du temps après une
dévaluation.
Avec le temps en abscisse et les variations de la balance commerciale en ordonnées, la
courbe en J de la balance commerciale montre une détérioration du solde commercial après la dévaluation
et une remontée au fil du temps.
On impute aux élasticités-prix la raison de la forme de la courbe.
Origine
Le solde de la balance commerciale d’un pays dépend à la fois de l’écart conjoncturel entre ce pays et le
reste du monde et de la compétitivité de ses produits.
Une dévaluation améliore en monnaie étrangère la
compétitivité des exportations mais renchérit les importations.
Les importations sont d’autant plus chères
que leurs prix sont libellés en devises.
Dans un premier temps, après la dévaluation, le renchérissement
automatique des importations creuse le solde commercial.
À plus long terme, la compétitivité accrue des
exportations joue : les exportations augmentent, les importations baissent du fait de la baisse de pouvoir
d’achat enregistrée.
Le solde commercial s’améliore alors.
J.
Robinson (1936) et A.
Lerner (1945) ont défini dans le théorème des élasticités critiques appelé aussi
condition de Marshall-Lerner la condition nécessaire pour qu’une dévaluation réussisse.
Pour que le solde
commercial s’améliore il faut que la somme des élasticités prix des importations et des exportations soit
supérieure à 1.
Contestation théorique
L’application de ce théorème est critiquée pour deux raisons.
La première est que le calcul des élasticités
1
est délicat et pose des problèmes d’agrégations.
La seconde vient de ce que ce théorème repose sur des
hypothèses de fixation de prix très simplificatrices qui sont appliquées à la courbe en J de façon
permanente.
Or, l’évolution du solde commercial en forme de J s’explique par des élasticités prix qui
varient avec le délai qui suit la dévaluation.
Le théorème en lui-même est critiqué par les auteurs non-keynésiens car il repose sur une logique
keynésienne de relance par la demande.
Le solde commercial apparaît alors comme une variable clé du
plein emploi.
La dévaluation de la monnaie n’est plus alors considérée que comme un moyen d’assurer un
emploi maximum.
Développement
La courbe en J vient de ce que l’effet prix est beaucoup plus rapide que l’effet volume.
Autrement dit,
dans un premier temps l’effet prix joue en renchérissant les importations à volume constant d’importation
et d’exportation.
L’effet volume c’est-à-dire l’augmentation des exportations par augmentation des parts
de marché et la baisse des importations par réduction des importations par moindre pouvoir d’achat ne
vient qu’après coup.
Il résulte aussi de la condition Marshall-Lerner que plus le déficit initial est grand
plus les élasticités prix doivent être fortes pour que le solde commercial retrouve une valeur positive.
Cependant, l’évolution au cours du temps du solde commercial dépend de trois critères.
Le premier
concerne le contenu en matière première des importations.
Si les importations en matières premières
facturées en devises représentent un poste important dans les importations, une dévaluation va provoquer
un creux plus important dans un premier temps et un redressement limité par la suite.
En effet, les
matières premières ne sont forcément pas substituables à des produits nationaux.
Le second facteur
concerne le comportement des exportateurs.
La courbe en J fait l’hypothèse que le prix des exportations
en monnaie nationale ne varie pas.
Cela exclut la possibilité qu’ont les exportateurs de moduler leurs
marges bénéficiaires.
Or, les exportateurs peuvent avoir un comportement de marge.
Si les exportateurs
vendent dans un pays dont la monnaie s’apprécie, ils peuvent accroître leurs marges pour bénéficier de
profits accrus en monnaie nationale.
S’ils vendent dans un pays dont la monnaie se déprécie ils peuvent
réduire ces marges pour limiter leur perte de part de marché en freinant la hausse de leurs prix en devises.
Enfin, la dévaluation à moyen terme augmente les exportations donc la production, ce qui suscite la
hausse des importations.
La hausse des prix importés se répercute sur les prix domestiques et réduit ainsi
la compétitivité.
Débat
La courbe en J donne-t-elle une image de la conjoncture ? Depuis le début des années 80, la condition de
Marshall, Lerner et Robinson est considérée comme nécessaire mais pas suffisante.
Pour qu’une
dévaluation soit réussie, il faut que cette condition soit remplie mais cela ne suffit pas à la réussite de la
dévaluation.
Les Etats-Unis, malgré une somme d’élasticités critiques comprise entre 1,3 et 2,2, n’ont pas
enregistré une corrélation entre dépréciation du dollar et redressement des comptes extérieurs sur les
années 80-90.
Trois éléments contribuent au succès d’une dévaluation.
Le premier concerne les comportements de
marge.
La période précédant la dévaluation est généralement marquée par une compression des marges
des producteurs domestiques de biens....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Cédric Villani : Théorème vivant
- Théorème de Tietze-Urysohn
- Analyse de La courbe de tes yeux de Paul Éluard
- Fiche outil sur la critique de roman + mes critiques
- Nom : Date : Réussite : Prénom : Numération 1) Place les nombres suivants sur la courbe.