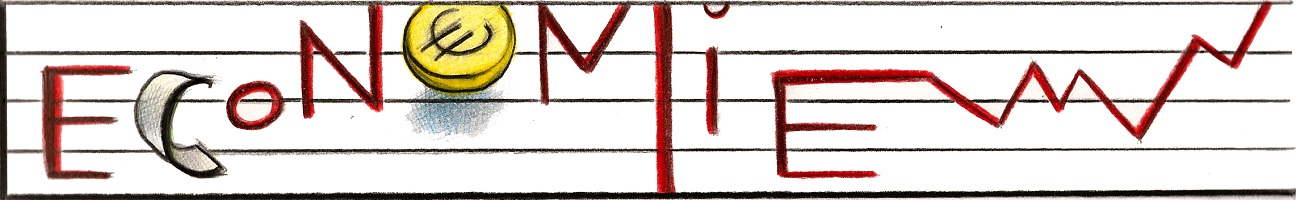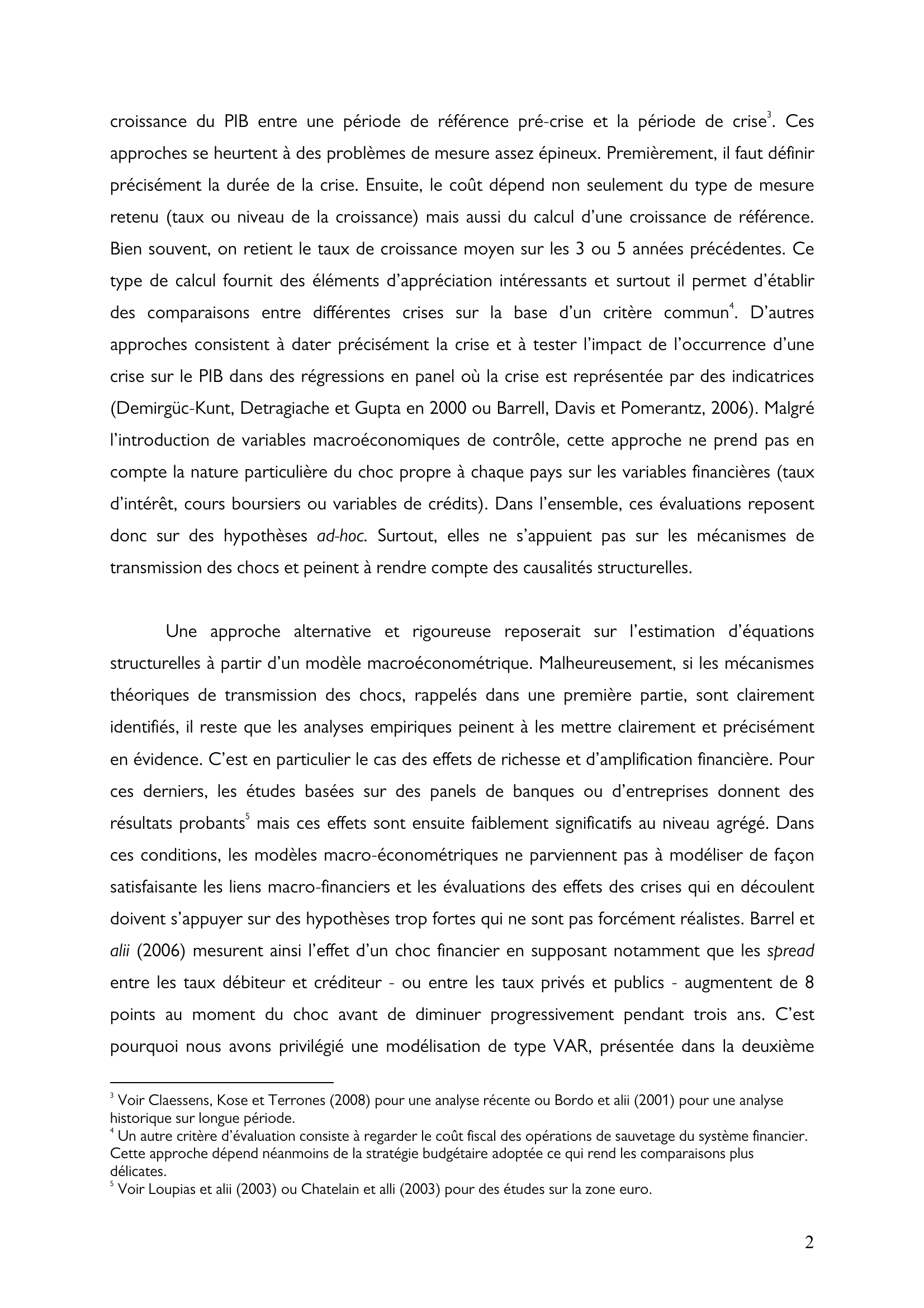crise économique
Publié le 27/11/2012

Extrait du document
«
2 croissance du PIB entre une période de référence pré-crise et la période de crise
3.
Ces
approches se heurtent à des problèmes de mesure assez épineux.
Premièrement, il faut définir
précisément la durée de la crise.
Ensuite, le coût dépend non seulement du type de mesure
retenu (taux ou niveau de la croissance) mais aussi du calcul d’une croissance de référence.
Bien souvent, on retient le taux de croissance moyen sur les 3 ou 5 années précédentes.
Ce
type de calcul fournit des éléments d’appréciation intéressants et surtout il permet d’établir
des comparaisons entre différentes crises sur la base d’un critère commun
4.
D’autres
approches consistent à dater précisément la crise et à tester l’impact de l’occurrence d’une
crise sur le PIB dans des régressions en panel où la crise est représentée par des indicatrices
(Demirgüc-Kunt, Detragiache et Gupta en 2000 ou Barrell, Davis et Pomerantz, 2006).
Malgré
l’introduction de variables macroéconomiques de contrôle, cette approche ne prend pas en
compte la nature particulière du choc propre à chaque pays sur les variables financières (taux
d’intérêt, cours boursiers ou variables de crédits).
Dans l’ensemble, ces évaluations reposent
donc sur des hypothèses ad-hoc.
Surtout, elles ne s’appuient pas sur les mécanismes de
transmission des chocs et peinent à rendre compte des causalités structurelles.
Une approche alternative et rigoureuse reposerait sur l’estimation d’équations
structurelles à partir d’un modèle macroéconométrique.
Malheureusement, si les mécanismes
théoriques de transmission des chocs, rappelés dans une première partie, sont clairement
identifiés, il reste que les analyses empiriques peinent à les mettre clairement et précisément
en évidence.
C’est en particulier le cas des effets de richesse et d’amplification financière.
Pour
ces derniers, les études basées sur des panels de banques ou d’entreprises donnent des
résultats probants
5 mais ces effets sont ensuite faiblement significatifs au niveau agrégé.
Dans
ces conditions, les modèles macro-économétriques ne parviennent pas à modéliser de façon
satisfaisante les liens macro-financiers et les évaluations des effets des crises qui en découlent
doivent s’appuyer sur des hypothèses trop fortes qui ne sont pas forcément réalistes.
Barrel et
alii (2006) mesurent ainsi l’effet d’un choc financier en supposant notamment que les spread
entre les taux débiteur et créditeur - ou entre les taux privés et publics - augmentent de 8
points au moment du choc avant de diminuer progressivement pendant trois ans.
C’est
pourquoi nous avons privilégié une modélisation de type VAR, présentée dans la deuxième
3 Voir Claessens, Kose et Terrones (2008) pour une analyse récente ou Bordo et alii (2001) pour une analyse
historique sur longue période.
4 Un autre critère d’évaluation consiste à regarder le coût fiscal des opérations de sauvetage du système financier.
Cette approche dépend néanmoins de la stratégie budgétaire adoptée ce qui rend les comparaisons plus
délicates.
5 Voir Loupias et alii (2003) ou Chatelain et alli (2003) pour des études sur la zone euro..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La crise économique de 29
- Une crise économique n'a-t'elle que des aspects négatifs ? Faut-il vraiment la redouter ?
- crise économique de 1929.
- crise économique & économie.
- Stratégies de sortie de crise économique