Un dossier très complet sur le classicisme, sur la peinture, la littérature, l'architecture, le contexte, les grandes querelles et les grands auteurs du 17ème
Publié le 06/06/2011
Extrait du document
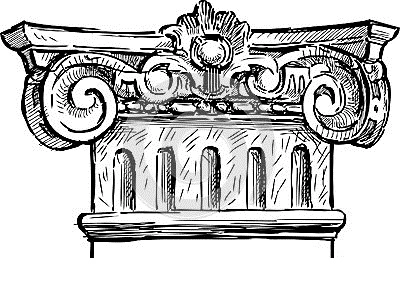
Dossier sur le classicisme
Un mouvement artistique et littéraire du XVIIe siècle
Lecture de Molière par Jean-François de Troy, vers 1728.
Amice Marie
\"Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage : Polissez-le sans cesse et le repolissez\"
Nicolas Boileau, L'art poétique, Chant I, 1674
Partie I : Présentation.
Le classicisme est un mouvement littéraire faisant appel à l'inspiration antique. Pendant le Moyen Âge et surtout à la renaissance, tous les grands auteurs admiraient le génie des anciens. Les écrivains classiques, à leur tour, les imitent car ils pensent que les grands auteurs de l'antiquité avaient atteint la perfection, prouvée selon eux par la durée de leur renommée. Molière a ainsi imité Plaute, Racine Sénèque ou Euripide, La Fontaine, le fabuliste grec Ésope, Boileau dans son Art Poétique la Poétique d'Aristote...
Ce mouvement exige la perfection, d'où les nombreuses règles qui codifient la littérature comme la règle des trois unités par exemple. Les écrivains classiques aiment le travail bien fait, et le génie n'empêche pas un énorme et rigoureux travail. Cependant ce travail doit rester invisible, sinon, l'œuvre perd son charme. Les classiques veulent rendre la littérature universelle, par conséquent, les écrivains de cette période privilégient la description d'un type humain plutôt que d'un individu et ils utilisent beaucoup les procédés d’écriture brefs comme la litote qui ne surcharge pas le lecteur de détails superflus.
L'idéal humain est l'honnête homme : il fait preuve de retenue, est ouvert, curieux, savant sans être pédant, agréable, poli, raffiné. En fait, il doit plaire, tant par son physique, que par son discours.
Le but primordial de ce mouvement est de plaire et d'instruire. L'art doit provoquer la réflexion par le biais d'une forte réaction émotionnelle, sinon, il reste superficiel et inutile. L'art classique se veut naturel, mais ce naturel résulte d'une « recherche qui ne retient que ce qui est significatif » comme le disait Molière. La tragédie permet un effet de catharsis sur le lecteur pour le purger de ses passions, la comédie corrige les mœurs par le rire…Par le biais du divertissement, la littérature classique est avant tout instructive. Le classicisme est un mouvement littéraire qui se développe en France, et plus largement en Europe, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle.
Le classicisme se forme en opposition à un autre mouvement artistique antérieur, le baroque. Ce style naît en Italie à Rome, Mantoue, Venise et Florence à partir du XVIe et XVIIe siècles, il se répand rapidement dans la plupart des pays d’Europe. Il touche tous les domaines artistiques, sculpture, peinture, littérature, architecture et musique et se caractérise par l’exagération du mouvement, la surcharge décorative, les effets dramatiques, la tension, l’exubérance et la grandeur parfois pompeuse. Ce mouvement cherche à émouvoir, il utilise de nombreuses couleurs vives, de courbes, de torsades et les artistes baroques s’intéressent beaucoup à la mise en scène, qu'ils jugent importante. Au contraire, le classicisme accentue l'ordre, l'équilibre, l'harmonie, les lignes droites, la symétrie et fait de nombreuses références à l' Antiquité.
Quant au contexte politique, deux forces dominantes au XVIe siècle déclinent au XVIIe siècle, l’aristocratie et la religion protestante. Richelieu triomphe des protestants réfugiés à La Rochelle en 1628, et Louis XIV révoque l’édit de Nantes en 1685. De plus, Richelieu met en place une monarchie absolue, où le pouvoir central cherche à tout contrôler. L’Académie française est ainsi créée en 1634. L’absolutisme met en place une vaste propagande culturelle pour glorifier la monarchie. Concernant le contexte religieux. Le XVIIe siècle est empreint d’une profonde spiritualité catholique avec Saint-Vincent-de-Paul, le cardinal de Bérulle ou encore Pascal, Bossuet. Les jésuites s’opposent aux jansénistes comme Mademoiselle de La Fayette ou Racine, dont le berceau est l'abbaye de Port-Royal, qui affirment que l’homme vit dans le péché, et que seule la grâce divine peut le sauver. Certaines œuvres, comme Les Provinciales de Pascal ou l'œuvre de Bossuet relèvent même entièrement de la religion. Les querelles théologiques s’enveniment, et Louis XIV fait raser l’abbaye de Port-Royal en 1710. Le classicisme français correspond à une période brève dans l’histoire de France, la première partie du règne personnel de Louis XIV (1661-1685). Ainsi, le classicisme possède une poétique, un ensemble de règles établies par des théoriciens. Il devient un modèle artistique à suivre.
Partie II : Le classicisme dans les arts
La peinture classique
I. Les caractéristiques de la peinture classique
Le classicisme caractérise l'école de peinture française du XVIIe siècle. En réponse aux extravagances du baroque, le mouvement s'inspire des maîtres de la renaissance classique et devient un langage pictural au service de la monarchie absolue.
Le classicisme prend ses racines en Italie dans le travail d’Annibal Carrache qui, à l’opposé de Caravage, renoue avec la tradition classique de la renaissance. Désireux de revenir à une peinture débarrassée de détails superflus, Carrache revient aux influences de l’Antiquité et à une conception idéalisée de la beauté qu’il étend au genre du paysage.
Contrairement au baroque qui recherche le débordement et le mouvement, le classicisme offre une composition claire et ordonnée dans laquelle le message s’énonce de manière évidente et sans détour. La composition est souvent fermée, c'est à dire que la scène est entièrement contenue à l'intérieur du cadre, contrairement à la composition ouverte du style baroque dans laquelle les motifs et les personnages sortent de la surface de la toile. La mise en page préfère la construction selon des lignes verticales ou horizontales, ce qui donne à l'image un aspect serein et rigoureux. Il y a aussi de nombreuses connotations antiques dans les tableaux classiques. La politique de contre-réforme menée par les jésuites ayant trouvé son expression avec le baroque, c’est en France que va pouvoir s’épanouir et se développer le style initié par Annibal Carrache.
II. Les grands peintres du classicisme
Nicolas Poussin est la figure majeure du courant. Il commence très jeune sa carrière de peintre et s'installe à Rome à partir de 1624. Au contact du travail des italiens il développe son propre style caractérisé par une grande rigueur dans la composition et des sujets, souvent inspirés de la mythologie et de l'histoire romaine et chrétienne, dans lesquels il apporte une réflexion sur l'homme, la morale héroïque et la nature. Comme Poussin, Claude Lorrain fait carrière à Rome. Il contribue à donner ses lettres de noblesse à la peinture de paysage. L'univers idéalisé qu'il propose est construit à partir d'éléments empruntés à la réalité. En France, Charles Le Brun est le peintre officiel de la cour de Louis XIV. Élève de Simon Vouet et fortement influencé par le travail de Nicolas Poussin il exprime dans sa peinture des sentiments héroïques et dramatiques. Chargé de décorer le Louvre et les châteaux de Vaux-le-Vicomte et de Versailles, il met son art au service de la monarchie en exaltant la grandeur du roi. Dans un classicisme très différent, Louis Le Nain représente la vie des paysans français du XVIIe siècle. Là encore l'idéalisation classique fait de ses modèles des personnages dignes et emprunts de noblesse qui contrastent avec une réalité bien moins reluisante concernant les gens du peuples, miséreux et fatigués par une existence souvent pénible à supporter.
III. Description d'un tableau
Louis XIV, Anne d'Autriche et Philippe d'Anjou présentés à la Trinité par Saint-Benoît et Sainte Scolastique par Philippe de Champaigne, 1646
A droite du tableau, nous voyons Anne d’Autriche, la régente, et ses deux enfants, Louis XIV et Philippe d’Anjou à gauche. Au centre, nous apercevons différents objets à valeurs de symboles ; la couronne qui est le symbole du pouvoir politique, le globe qui est le lieu sur lequel est exercé le pouvoir. Enfin la mitre rouge, la tiare et la mitre blanche à trois couronnes, que portait le pape, sont des symboles liés au pouvoir religieux. Au second plan, nous remarquons Saint-Benoît, le maître spirituel de Louis XIV et de tout le monarchisme occidental puisque c’est la référence du moine Saint. Il a fondé l’ordre des Bénédictins. Sainte- Scolastique, à droite, est sa sœur. Derrière eux, deux petits angelots tiennent un livre, sans doute la bible ou la règle des monastères bénédictins. Au dernier plan, la Sainte Trinité chrétienne est représentée avec Dieu le père, le Christ, le Saint Esprit sous la forme d’une colombe. En regardant ce tableau, nous avons l’impression que la régente et le futur roi ont placé en signe d’allégeance les signes de leur pouvoir aux pieds des Intercesseurs.
VI. Analyse du tableau
A travers ce tableau, nous retrouvons l’idée maîtresse du classicisme qui est le hiératisme puisque nous percevons dans ce tableau, l’ordre, l’harmonie, la hiérarchie, la solennité…Nous remarquons la figure du triangle qui nous montre que le but de la société de l’ancien régime était la soumission à Dieu, puisqu’il est placé tout en haut du tableau. Il y a une idée de salut religieux. La forme pyramidale fait aussi penser aux « castes » de l’époque où la société culmine vers Dieu. L’organisation schématique du tableau, formant un triangle, est transfigurée par une sorte de dramaturgie de la lumière qui conduit le regard à travers trois niveaux de réalité jusqu’à une progressive immatérialité qui s’atteint dans Dieu.
V. Le genre pictural des « Vanités »
« Vanité des vanités, tout n’est que vanité » Pascal
Lié au dogme chrétien de l’état de grâce, le genre des vanités s’épanouit au XVIIe siècle et rencontre un grand succès dans les pays catholiques. C’est un type de peintures qui illustre de façon symbolique, le thème philosophique de l’inéluctabilité de la mort, la fragilité des biens terrestres, la futilité des plaisirs à travers la représentation de natures mortes d’allégories ou de grands saints. Les vanités évoquent la place de l’homme dans l’univers, les artistes insistent sur l’insignifiance des œuvres humaines, face à celles de Dieu.
Dans ce tableau, nous remarquons les symboles qui caractérisent le genre pictural des vanités. Dans un premier temps, le miroir que la jeune fille ne regarde pas, montre sa prise de conscience de la futilité de la coquetterie et du caractère éphémère de la beauté ou de la jeunesse. Ensuite, les bougies évoquent la fragilité de la vie qui est courte. Enfin, le crâne souligne le caractère transitoire de la vie humaine.
Madeleine en pénitence, Georges de la Tour, 1625-1650
L'architecture classique
I. Les caractéristiques de l’architecture classique
Par sa condamnation de l'emploi des cartouches, des frontons brisés, des corniches trop saillantes qui avaient envahi les monuments, le classicisme en architecture prônait un retour à la simplicité telle que l'avait définie le monde antique. Les architectes se référeront désormais aux temples, arcs de triomphe, théâtres, thermes, et leurs nouvelles compositions deviendront à leur tour des modèles. L'architecture française des années 1640-1690, fondée sur la clarté et la sobriété, imposera certaines formules : lignes droites s'articulant avec des angles droits, utilisation des courbes régulières, recours à la symétrie et à des proportions mathématiques, emploi d'un seul ordre par étage et non plus de l'ordre colossal ou du mélange des ordres comme dans le baroque. Par ces moyens, les architectes français entendent trouver un style plus large, qui permette d'organiser les masses architecturales de façon claire et de souligner l'essentiel.
Les architectes ayant le plus marqués le classicisme sont François Mansart, né en 1598 à Paris, il est issu d'une famille modeste d'artisans du bâtiment. Véritable génie de l’architecture, le nom d’Hardouin-Mansart est attaché aux réalisations les plus grandioses du règne de Louis XIV comme la galerie des Glaces, l’Orangerie, le Grand Trianon et le couvent des Récollets… Pour Mme de Montespan, Hardouin-Mansart bâtit à Versailles en 1675 le fameux château de Clagny, aujourd’hui détruit. Il est aussi l’auteur des pavillons et jardins de Marly ; de la maison de Saint-Cyr pour Mme de Maintenon ; du château neuf de Meudon pour le Grand Dauphin ; des places des Victoires et Vendôme à Paris…Il devient le premier architecte du Roi-Soleil en 1612.
Mais il y a aussi Le Vau premier grand architecte du Versailles de Louis XIV, il est l’auteur des grands appartements du roi et de la reine ainsi que de la façade de pierre du château côté jardin. Versailles fut assurément la dernière réalisation majeure de ce grand architecte du milieu du XVIIe siècle. Suite au Grand Divertissement de 1668, Louis XIV confie à Le Vau, premier architecte du roi depuis 1654, l’extension du château de brique et pierre de son père Louis XIII. Du côté de la cour, il bâtit dans le même style les ailes symétriques des écuries et des communs mais choisit la pierre pour entourer le château primitif du côté des jardins.
II. Représentation et analyse d'un monument :
Le château de Vaux-le-Vicomte est bien représentatif de l'architecture classique du XVIIe siècle. En effet, nous remarquons que ce château est construit selon des lignes horizontales et verticales (les lignes noires). Le portail du château marque la symétrie du bâtiment (la ligne rose). Par ailleurs, le château comporte de nombreuses connotations antiques comme les colonnes qui marquent l'entrée du château, mais aussi les devantures de fenêtres (les ronds roses). D'autre part, les formes rondes côtoient les angles perpendiculaires, cette caractéristique se retrouve dans de nombreux bâtiments d'inspiration classique. La façade du château est claire, simple, elle n'est pas surchargée. Tout est proportionnel, comme le voulaient les classiques.
Partie III : La littérature
I. Le théâtre
Les grandes règles du théâtre classique
Au XVIIe siècle, les doctes entreprennent de «codifier» le théâtre et tout particulièrement la tragédie. C'est principalement après la «querelle» du Cid en 1636, qui opposa partisans d'un théâtre réglementé et tenants d'une création de liberté, que s'est constitué un ensemble de règles inspirées, pour la plupart, de La Poétique d'Aristote. Le théâtre classique était régi par plusieurs règles, notamment la règle des quatre unités, de la vraisemblance et de la bienséance.
Tout d'abord voici la règle des quatre unités. Le développement de la pièce classique doit obéir au principe d'unité défini par Boileau dans Art poétique, en 1674 : «Qu'en un lieu, en un jour, un seul fait accompli tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli». La règle des trois unités vise à renforcer l'illusion théâtrale en réduisant l'écart entre action et représentation. Dans un premier temps, le dramaturge devait respecter l'unité d'action. Elle vise à supprimer les intrigues secondaires et à concentrer l'intérêt dramatique autour d'une action unique pour ne pas perturber le spectateur. Une fois échappé au danger qui le menace, le héros ne doit pas s'affronter à un nouveau péril qui n'est pas une conséquence directe du premier. D'autre part, la pièce devait prendre en compte l'unité de temps. Toute l'action représentée est censée avoir lieu en un seul jour. Racine voulait rapprocher le plus possible la durée de la représentation à la durée de l'histoire, c'est-à-dire environ trois heures, mais Corneille voyait la question de façon plus large et admettait que certaines de ses pièces dépassaient légèrement les 24 heures. Cette règle cherche à entretenir l'illusion d'une coïncidence entre la durée de la fiction et le temps de la représentation. Mais il y a aussi l'unité de lieu. Elle résulte des deux premières. Toute l'action représentée se déroule dans un seul endroit. On ne peut pas montrer un champ de bataille et ensuite l'intérieur d'un palais. Pour la tragédie, on choisit le plus souvent une salle commune à l'intérieur d'un palais mais Corneille croyait qu'on pouvait représenter différentes salles dans un même palais. La comédie préfère une salle dans une maison bourgeoise ou un carrefour public. L'unité de lieu exige des récits de ce qui se passe ailleurs, les récits de combats notamment. Enfin la moins connue est l'unité de ton. L’unité de ton doit être respectée afin de maintenir la séparation des genres entre la tragédie et la comédie. L’unité de ton, liée à la séparation des genres avec des sujets propres, des types de personnages spécifiques, des niveaux de langue et de ton dans un objectif différent.
Vient ensuite la règle de la vraisemblance. Elle veut que s'impose l'impression de vérité. L'action dramatique doit être crédible : «L'esprit n'est point ému de ce qu'il ne croit pas» comme le disait Boileau. Cette règle de la vraisemblance est censée donner au texte une impression de déjà vécu et ainsi donner l'impression que se qui se passe dans le texte aurait pu se produire dans la vie de tous les jours ce qui permet au spectateur de mieux se projeter a la place des personnages et peut-être de mieux comprendre leurs réactions, leurs gestes et leur pensées. Cette règle a donc pour but de rendre plus réaliste les actions des récits pour les spectateurs. Pour certains auteurs, le vraisemblable est encore plus exigeant que le vrai, puisque « le vrai peut quelque fois n'être point vraisemblable » comme le disait Boileau. Pour conclure, nous nous sommes penchés sur la règle de bienséance. La règle de bienséance oblige à ne représenter sur scène que ce qui ne choquera pas le public. On écarte la violence physique mais aussi l'intimité physique. Les scènes violentes doivent ainsi être racontées par un personnage. Quelques exceptions sont restées célèbres comme les morts de Phèdre et de Don Juan dans les pièces éponymes de Racine et de Molière ainsi que la folie du personnage d'Oreste dans Andromaque. Elle conduit au respect des usages et des conventions. Il s'agit, d'une part, de ne pas choquer le public. D'autre part, les agissements et les sentiments du héros doivent être conformes à son rang.
La séparation des genres
Au XVIIe siècle, les deux grands genres de théâtre sont la tragédie et la comédie. Pour mieux les apprécier, ces deux genres sont séparés. Tout d'abord, les ressorts de la comédie et de la tragédie sont différents. La tragédie a pour but de purger les passions par l'émotion avec l'effet de catharsis de la pièce quant à la comédie, elle corrige les mœurs par le rire comme en témoigne cette maxime: « Castigare ridendo mores ». Dans les tragédies, l'action est sous la forme d'une aventure extraordinaire éloignée dans le temps .Les comédies mettent en scène des aventures ordinaires et contemporaines comme l’ambition sociale, les tromperies conjugales. La tragédie oppose des personnages hors du commun, rois, guerriers... à des personnages familiers de la bourgeoisie, du peuple, de la petite aristocratie. La tragédie a une tonalité de fatalité et de mort, le destin y est individuel et collectif, et il y a une universalité de la condition humaine, le dénouement malheureux. Dans la comédie, le réalisme est relatif, avec le reflet d’une société donnée, il y a des effets comiques variés et la fin est heureuse. Dans la tragédie, la forme est soutenue, avec des alexandrins, au contraire, dans la comédie il y a souvent cinq actes en langue familière. Le titre dans une tragédie est un nom propre comme Andromaque, Phèdre, et Horace, dans une comédie c’est un nom commun ou un personnage collectif, par exemple l'Avare ou Les Précieuses ridicules.
Les grands auteurs
Plusieurs grands dramaturges ont marqué le XVIIe siècle. Tout d'abord, Molière ou Jean-Baptiste Poquelin né en janvier 1622 à Paris. Fils d’un tapissier, Molière fait ses études chez les jésuites avant d’aller étudier le droit à Orléans. Avec Madeleine Béjart, il crée l’Illustre-Théâtre qui est un échec en raison de dettes, en août 1645, Molière est même emprisonné. Cette même année, il quitte Paris pour la province. Il y restera treize ans. En 1658, il revient à Paris. C’est la pièce Les Précieuses ridicules (1659) qui lui apporte la célébrité. Molière obtient du roi la salle du Petit Bourbon puis celle du Palais-Royal, à partir de 1660 où il remporte de nombreux succès en tant que dramaturge, acteur et directeur de troupe. Tartuffe, jouée pour la première fois en 1664 à Versailles, pièce dans laquelle il critique l’hypocrisie des faux dévots, fait scandale. La pièce est interdite par le roi sous la pression des dévots qui se sentent visés. En 1665, Dom Juan suscite également des remous. Malgré son succès, la pièce est retirée. Molière continue cependant de bénéficier de la faveur du roi. Viennent les pièces Le Misanthrope (1666), Le Bourgeois Gentilhomme (1670), L’Avare (1668), Les Fourberies de Scapin (1671), Les Femmes savantes (1672). Épuisé par le travail et la maladie, Molière meurt le 17 février 1673 après la quatrième représentation du Malade imaginaire où il jouait le rôle d’Argan.
Ses comédies ont pour cadre les milieux contemporains, les nobles, les bourgeois, observés avec précision. Chaque personnage a la marque de son métier et de sa position sociale. Ainsi, le théâtre de Molière fait-il un tableau presque complet de la société du XVIIe siècle. La cour y est représentée avec les pédants, les précieux...Mais aussi la bourgeoisie, la province avec les valets, les marchants... La vérité humaine est éternelle : « il faut peindre d’après nature », aussi Molière a-t-il créé des types immortels solidement ancrés dans la réalité de leur époque mais dépassant leur intemporalité. Le but de la comédie de Molière est de faire rire et pour cela il faut savoir utiliser tout ce qui provoque le rire. Molière a souvent recours au « gros rire », celui de la farce, les coups de bâtons...Mais si Molière tient à faire rire, il veut surtout instruire. En effet il était un fin observateur de ses contemporains et c’est en toute lucidité qu’il a pu constater que les hommes sont malheureux et qu’ils se dégradent moralement. Ce sont des inadaptés qui agissent contre le bon sens et la raison. Molière ne pensait pas vraiment corriger les hommes de leurs vices mais il voulait travailler « à rectifier et à adoucir les passions » comme il l'écrivait dans la préface de Tartuffe. Au lieu de nous donner une leçon de morale, c’est la vie elle-même qui nous invite à la réflexion Molière est impitoyable pour la préciosité avec les femmes savantes, les pédants, les précieuses; il s’en prend à leurs affectations de langage et de leurs mœurs : « ce n’est que jeux de mots, qu’affectation pure/ Et ce n’est pas ainsi que parle la nature » comme le disait un personnage, Aleste.
L’éducation des jeunes filles est un sujet que Molière affectionne particulièrement. Il dénonce l’éducation dans les couvents. Quant à l’amour, c'est un élan du cœur qui ne dépend ni du mérite, ni du bon sens, ni de la fortune, ni de la sagesse. De plus, on ne saurait imposer l’imposer par la force et par la raison. Il est contre les mariages arrangés par les parents pour des raisons qui leur appartiennent et qui sont le plus souvent des raisons sociales. Molière évoque aussi les malheurs et les infidélités qui sont les conséquences de ce genre d’attitudes. Enfin, Molière dénonce les faux dévots, les hypocrites, ceux qui se servent de la religion, mais il ne dénonce pas la religion.
Il ne faut pas oublier un autre grand dramaturge du XVIIe siècle, Racine. Né le 22 décembre 1639 et mort à Paris le 21 avril 1699, il est considéré comme l'un des plus grands auteurs de tragédies de la période classique de la France de Louis XIV. Issu d'une famille de petits notables, et vite orphelin, il est élevé par sa grand-mère et sa marraine et reçoit une solide éducation littéraire marquée par le jansénisme. Il choisit ensuite de se consacrer à la littérature et particulièrement au théâtre en faisant jouer La Thébaïde en 1664 et Alexandre le Grand en 1665, qui est son premier succès et qui lui vaut le soutien du jeune roi Louis XIV mais il se brouille avec Molière. Le succès d'Andromaque en 1667 ouvre une décennie de grande création où l'on trouve à côté d'une unique comédie, six grandes tragédies. Auteur à succès mais ébranlé par les cabales et ayant renoué avec le jansénisme, Racine abandonne le théâtre, devient historiographe du Roi et entre à l'Académie française en 1672. C'est pour répondre à la demande de Madame de Maintenon qu'il revient à l'écriture théâtrale et donne deux tragédies aux sujets bibliques aux jeunes filles de Saint-Cyr : Esther (en 1689) et Athalie (en 1691).
Comme Molière, Racine a pour but d'instruire les spectateurs. En effet, le théâtre de Racine peint la passion comme une force fatale qui détruit celui qui en est possédé. On retrouve ici les théories jansénistes : soit l'homme a reçu la grâce divine, soit il en est dépourvu, rien ne peut changer son destin, il est condamné dès sa naissance. Réalisant l'idéal de la tragédie classique, le théâtre racinien présente une action simple, claire, dont les péripéties naissent de la passion même des personnages. Par le biais de ses tragédies, Racine veut montrer que la passion entraîne de nombreux problèmes et faire un effet de catharsis sur les spectateurs pour qu'ils évitent de faire les mêmes erreurs.
Présentation d'un extrait d'une tragédie et d'un extrait d'une comédie
Nous allons maintenant procéder à l'étude d'une de leurs comédies et tragédies. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à Andromaque qui est une tragédie en cinq actes et en vers écrite en 1667 et représentée pour la première fois au château du Louvre le 17 novembre 1667 devant la reine par la troupe de l'Hôtel de Bourgogne. Le rôle titre était tenu par Mademoiselle Du Parc. La pièce connaît un grand succès auprès de la cour, mais est critiquée par ses rivaux. Elle reste l'une des pièces les plus jouées à la Comédie-Française. L'action se situe après la légendaire guerre de Troie, remportée par les Grecs. Pyrrhus a ramené de Troie une captive, Andromaque. Il l'aime mais Andromaque reste fidèle au souvenir d'Hector, son époux défunt. De cette union, elle a eu un enfant, Astyanax, dont Oreste, l'ambassadeur des Grecs, et Hermione, la fiancée de Pyrrhus, veulent la mort. Pyrrhus trahira-t-il sa patrie pour se faire aimer ou sacrifiera-t-il le fils de sa prisonnière aux intérêts de la Grèce ? Tout le génie de Racine s'exprime dans cette œuvre, très émouvante. Ainsi Andromaque n’est pas seulement la mère opiniâtre, décidée à tous les sacrifices pour défendre son fils. C’est encore une jeune princesse profondément attachée à un mari adoré mais trop tôt disparu. Aussi n’est-il pas étonnant de la voir révoltée par les avances d’un vainqueur que son pouvoir rend outrecuidant, d’autant plus que le prétendant est le fils de celui qui a tué Hector. Cependant Andromaque représente avant tout la fidélité à un homme mort, à une cause apparemment perdue avec lesquelles elle ne saurait transiger. Si Pyrrhus meurt pour avoir trahi la loi des Grecs, Andromaque triomphe justement pour la raison strictement inverse : alors que la cause troyenne paraît désespérée puisqu’elle n’est plus représentée que par une veuve, un orphelin et le tombeau d’Hector, la mère d’Astyanax parvient à régner sur les vainqueurs d’hier pour avoir cru sans défaillance à l’ordre auquel elle appartenait. Andromaque, c’est le triomphe de la « foi ».
Quant à Molière, une de ses comédies les plus célèbres est sans doute L'Avare. Harpagon, vieil avare tyrannique, a entrepris de réduire le train de vie de sa maison. Par la pratique de l’usure, il continue à accroître sa fortune. Veuf, il abrite sous son toit ses deux enfants; sa fille Élise et son fils Cléante. Au début de la pièce, nous apprenons qu’Élise est amoureuse de Valère, le fils d’un noble napolitain exilé, cachant son identité sous un faux nom, mais elle n’ose envisager un mariage sans l’accord de son père. Valère, pour vivre auprès d’elle, a donc imaginé de se faire engager comme majordome d’Harpagon. Cléante, quant à lui, souhaite épouser Mariane, jeune fille sans fortune vivant avec sa mère. Harpagon, grâce à l’entremetteuse Frosine, nourrit lui aussi un projet matrimonial avec la jeune fille. Tout chavire lorsque Cléante essaie de rassembler une grosse somme d’argent. L’usurier qu’on lui indique n’est autre que son père ! Harpagon a entretemps dissimulé dans son jardin une cassette remplie de dix mille écus. Cette somme ensevelie le tourmente de craintes si bien qu’il devient obnubilé par la peur d’être volé. Son incessant manège a été repéré par La Flèche, le valet de Cléante, qui voit dans le coffre une solution aux difficultés d’argent de son maître. Après avoir découvert que son fils se couvrait de dettes, Harpagon apprend que ce dernier est épris de Mariane. Ainsi le père se trouve-t-il en concurrence avec son fils. Sa fureur est alors portée à son comble. Il entend écarter son fils au nom de l’obéissance due à l’autorité paternelle et l’obliger à s’engager dans un mariage contre nature avec la riche veuve qu’il lui destine. Quand, peu après, il découvre qu’on lui a dérobé sa chère cassette, il sombre dans un délire paranoïaque. Il accable alors Valère dénoncé par un serviteur qui désire se venger du majordome. Valère qui ignore ce qu’on lui reproche avoue vouloir épouser Élise. Alors que la tension monte dangereusement en présence d’un commissaire venu enquêter sur le vol, tout va heureusement se terminer. Valère fait connaître sa véritable identité et retrouve son père et sa sœur, qui n’est autre que Mariane. Cléante épousera Mariane, Valère épousera Élise, tandis qu’Harpagon reste seul avec sa cassette.
Cette pièce illustre les problèmes liés à l'argent. Si le titre pointe sur le péché capital de l’avarice, ce vice n’est pas l’unique manière d’envisager les rapports à l’argent dans cette pièce. En fait, Molière aborde aussi deux autres questions de société qui, pour rester secondaires, n’en sont pas moins fort développées. Molière aborde le rôle de l’argent dans ses rapports avec le pouvoir. Celui qui a de l’argent peut imposer sa volonté à ses semblables. Il est écouté sinon entendu, craint à défaut d’être respecté. La fortune donne du poids à ses envies. Il tient comme en otages ceux qui gravitent dans son entourage. Il est exposé à la flatterie. Il ne reçoit qu’une image déformée de son être. L’argent déréglé entraîne des pulsions réactionnelles contre nature, il est le terreau d’un immoralisme destructeur des relations de confiance.
La querelle entre Racine et Corneille
L'année 1637 marque un tournant dans la carrière de Corneille : alors qu'il n'est jusqu'alors qu'un auteur de théâtre parmi d'autres, le Cid le consacre comme le dramaturge le plus célèbre de son temps. La pièce est une tragi-comédie qui met en scène les amours de Rodrigue et de Chimène. Elle fait un triomphe, mais déclenche une vive controverse connue sous le nom de « querelle du Cid ». Cette polémique naît sans doute de conflits d'intérêts divers et des jalousies aiguisées par le succès de la pièce, mais elle donne lieu à un débat intéressant qui nous renseigne sur la formation de l'esthétique classique, puisque l'on reproche à Corneille de n'avoir pas respecté la règle classique des trois unités et de ne pas avoir écrit une pièce selon les conventions de l'époque. La querelle court depuis 1664 et la première de La Thébaïde révéle le jeune Racine. Six ans plus tard, le duel eut lieu en champ clos, avec la représentation à sept jours de distance d'une Bérénice signée Racine à l'hôtel de Bourgogne et d'un Tite et Bérénice signé Corneille au Palais-Royal. D'un côté une tragédie sans mort, sans action, sans autre pouvoir que celui des mots, de l'autre une pièce pleine de beaux gestes et de déchirements politiques. Bérénice eut la faveur du public. On célébra Racine comme un génie, on jura que Corneille était fini. Mais, lors de la présentation de Bajazet en 1672, l'auteur d'Horace avait toujours des partisans, ainsi Mme de Sévigné s'exclamant «Vive donc notre vieil ami Corneille!» pour dire sa déception à Mme de Grignan: «Le dénouement n'est point bien préparé: on n'entre point dans les raisons de cette grande tuerie. Il y a pourtant des choses agréables, et rien de parfaitement beau, rien qui enlève, point de ces tirades de Corneille qui font frissonner. Ma fille, gardons-nous bien de lui comparer Racine, sentons-en la différence.» Cette confrontation que s'interdit la marquise devint pourtant une mode. En 1685, Bayle célèbre Suréna et Le Cid comme les chefs-d'œuvre d'un auteur qui refusa toujours de sacrifier au goût du temps, ne voulant point «sortir de sa noblesse ordinaire ni de la grandeur romaine». Quelques mois plus tard, Longepierre publie un Parallèle de M. Corneille et de M. Racine, qui donne l'avantage à celui-ci. «On a mis Racine en parallèle avec Corneille, cet auteur incomparable», s'offusquera Charles Perrault dans Les Hommes illustres du XVIIe siècle. Chef de file des Modernes, il se prononçait pour l'auteur de Médée: les partis se prenaient alors à front renversé. Enfin La Bruyère vint, porte parole du parti des Anciens, et ses Caractères établissant la célèbre distinction: «L'on est plus occupé aux pièces de Corneille; l'on est plus ébranlé et plus attendri à celles de Racine. Corneille est plus moral, Racine plus naturel.».
II. Le roman La princesse de Clèves de Mme de la Fayette
Le résumé du roman
L'action se déroule, en 1558, à la cour du roi Henri II durant les dernières années de son règne. Autour du roi, princes et princesses rivalisent d'élégance et de galanterie. Mlle de Chartres, jeune orpheline de seize ans, élevée par sa mère selon de rigoureuses règles de morale, parait pour la première fois au Louvre. Le prince de Clèves, honnête homme d'une grande droiture morale, tombe amoureux d'elle dès qu'il l'aperçoit. Ebloui par sa beauté, il la demande en mariage. Mlle de Chartres n'a aucune expérience de l'amour et l'épouse sans être amoureuse de lui. Alors qu'elle est mariée, Mme de Clèves rencontre, à la cour, le duc de Nemours. Naît entre eux un amour immédiat et partagé. Mme de Chartres découvre cette passion naissante et met en garde sa fille du danger de ce désir illégitime. Avant de mourir, Mme de Chartres conjure sa fille de lutter contre l'amour coupable que lui inspire le duc de Nemours. Ayant perdu le soutien de sa mère, et afin d'éviter M. de Nemours, qu'elle ne peut s'empêcher d'estimer, Mme de Clèves décide de se retirer à la campagne. Au cours de l'histoire, M. de Clèves meurt de chagrin quand il apprend que sa femme est éprise de M. de Nemours. La douleur prive la princesse de toute raison. Elle éprouve pour elle-même et M. de Nemours un véritable effroi. Elle refuse de voir M. de Nemours, repensant continuellement à la crainte de son défunt mari de la voir épouser M. de Nemours. Le Vidame de Chartres réussit tout de même à organiser une entrevue secrète entre les deux amants. Elle le regarde avec douceur, mais lui conseille de rechercher ailleurs une destinée plus heureuse. Puis elle sort sans que Nemours puisse la retenir. La princesse tentera d'apaiser sa douleur en s'exilant dans les Pyrénées. Elle mourra quelques années plus tard en succombant à une maladie de langueur.
Un extrait du roman
Nous allons vous présenter un extrait de ce roman, qui est la scène de rencontre entre Mme de Clèves et M. de Nemours.
« Mme de Clèves avait ouï parler de ce prince à tout le monde, comme de ce qu'il y avait de mieux fait et de plus agréable à la cour ; et surtout madame la dauphine le lui avait dépeint d'une sorte, et lui en avait parlé tant de fois, qu'elle lui avait donné de la curiosité, et même de l'impatience de le voir. Elle passa tout le jour des fiançailles chez elle à se parer, pour se trouver le soir au bal et au festin royal qui se faisait au Louvre. Lorsqu'elle arriva, l'on admira sa beauté et sa parure; le bal commença et, comme elle dansait avec M. de Guise, il se fit un assez grand bruit vers la porte de la salle, comme de quelqu'un qui entrait et à qui on faisait place. Mme de Clèves acheva de danser et, pendant qu'elle cherchait des yeux quelqu'un qu'elle avait dessein de prendre, le roi lui cria de prendre celui qui arrivait. Elle se tourna et vit un homme qu'elle crut d'abord ne pouvoir être que M. de Nemours, qui passait par-dessus quelques sièges pour arriver où l'on dansait. Ce prince était fait d'une sorte qu'il était difficile de n'être pas surprise de le voir quand on ne l'avait jamais vu, surtout ce soir-là, où le soin qu'il avait pris de se parer augmentait encore l'air brillant qui était dans sa personne; mais il était difficile aussi de voir Mme de Clèves pour la première fois sans avoir un grand étonnement. M. de Nemours fut tellement surpris de sa beauté que, lorsqu'il fut proche d'elle, et qu'elle lui fit la révérence, il ne put s'empêcher de donner des marques de son admiration. Quand ils commencèrent à danser, il s'éleva dans la salle un murmure de louanges. Le roi et les reines se souvinrent qu'ils ne s'étaient jamais vus, et trouvèrent quelque chose de singulier de les voir danser ensemble sans se connaître. Ils les appelèrent quand ils eurent fini sans leur donner le loisir de parler à personne et leur demandèrent s'ils n'avaient pas bien envie de savoir qui ils étaient, et s'ils ne s'en doutaient point :
« Pour moi, madame, dit M. de Nemours, je n'ai pas d'incertitude; mais comme Mme de Clèves n'a pas les mêmes raisons pour deviner qui je suis que celles que j'ai pour la reconnaître, je voudrais bien que Votre Majesté eût la bonté de lui apprendre mon nom.
- Je crois, dit Mme la dauphine, qu'elle le sait aussi bien que vous savez le sien.
- Je vous assure, madame, reprit Mme de Clèves, qui paraissait un peu embarrassée, que je ne devine pas si bien que vous pensez.
- Vous devinez fort bien, répondit Mme la dauphine; et il y a même quelque chose d'obligeant pour M. de Nemours à ne vouloir pas avouer que vous le connaissez sans l'avoir jamais vu. »
La reine les interrompit pour faire continuer le bal; M. de Nemours prit la reine dauphine. Cette princesse était d'une parfaite beauté et avait paru telle aux yeux de M. de Nemours avant qu'il allât en Flandre; mais, de tout le soir, il ne put admirer que Mme de Clèves. »
Un roman classique qui a pour but d'être moraliste
Ce roman a été écrit au XVIIe siècle mais la scène se passe au XVIe siècle à la cour d'Henry II. Cette scène, situé au Louvres, célèbre les fiançailles de la fille du roi Claude de France avec un prince de Lorraine. M de Nemours et Mme de Clèves vont tomber amoureux. La Princesse de Clèves, écrit en 1678, est le premier roman d’analyse psychologique. En effet, la peinture du cœur humain en est le principal objet. Après 1660, le genre romanesque français connaît une profonde mutation : les pastorales ont fait leur temps, et on leur préfère dorénavant les « nouvelles » à la narration simple et linéaire, proche de la concentration tragique. La Princesse de Clèves en est l’un des archétypes les plus connus. Dans la morale classique, la recherche d'un ordre satisfaisant pour la vie sociale, comme celle d'une victoire sur l'intempérance des mœurs, conduit à un véritable héroïsme. La tragédie cornélienne s'est bâtie sur ces valeurs généreuses. Souvent partagé entre la passion et le devoir, le héros classique choisit toujours de rester maître de lui-même. Dans son Traité des passions de l'âme, Descartes définit cette morale hautaine de l'individu qui manifeste une « libre disposition » à « ne manquer jamais de volonté pour entreprendre toutes les choses et exécuter toutes les choses qu'il jugera être les meilleures; ce qui est suivre parfaitement la vertu.». Or dans le roman de Mme de la Fayette, Mme. De Clèves choisi de s'abandonner à M. de Nemours alors qu'elle est mariée. Elle n'est pas maîtresse d’elle même puisque c'est la passion qui guide ses actions. Par conséquent, elle va être punie de ses actes par la mort de son mari. Ce roman met en garde les jeunes filles des dangers de la passion en montrant la déchéance de Mme. De Clèves après la mort de son époux. Ce roman est donc moraliste et classique.
III. La poésie
La poésie classique est très réglementée. Les règles auxquelles on se réfère encore actuellement pour la poésie classique ont été précisées et codifiées par Malherbe (1555-1628) puis par Boileau (1636-1711). Il existe la poésie classique à « forme fixe ». Ces formes fixes sont un ensemble de règles structurant un poème classique. Nous trouvons notamment : le sonnet, le pantoum, la ballade, le triolet...Il faut aussi respecter l'égalité dans le nombre de pieds. Hormis quelques exceptions, les poèmes classiques requièrent l’emploi d’un nombre égal de pieds au fur et à mesure des vers. Ainsi, si le premier vers est en alexandrin, tous les autres vers seront de même. De plus, les poètes classiques doivent éviter les échos, bannir les hiatus, soigner les rimes. En poésie classique, il faut faire rimer les singuliers ensemble, et les pluriels ensemble. Il faut également alterner les rimes féminines et masculines. D'autre part, une terminaison de vers féminine ne peut rimer avec une terminaison de vers masculine. Enfin, plus la rime est riche, plus elle est appréciée et une strophe doit contenir le plus possible de vers se lisant à la suite, sans point.
L’Art poétique de Nicolas Boileau est un traité en alexandrins classiques, paru en 1674. Il traite des règles fondamentales de l'écriture en vers classiques, et de la manière de tendre dans cet art vers la perfection.
Avant donc que d'écrire, apprenez à penser (Chant I)
Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement,
Et les mots pour le dire arrivent aisément. (Chant I)
Hâtez-vous lentement, et sans perdre courage,
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage,
Polissez-le sans cesse, et le repolissez,
Ajoutez quelquefois, et souvent effacez. (Chant I)
Un sot trouve toujours un plus sot qui l'admire. (Chant I)
Il n'est point de serpent ni de monstre odieux,
Qui par l'art imité ne puisse plaire aux yeux,
D'un pinceau délicat l'artifice agréable
Du plus affreux objet fait un objet aimable. (Chant III)
Soyez plutôt maçon, si c'est votre talent. (Chant IV)
Les deux poètes les plus connus de cette époque sont Malherbe et Mainard. François de Malherbe est un poète français, né à Caen en 1555 et mort à Paris le 16 octobre 1628.
Épurer et discipliner la langue française a été l’œuvre de sa vie. Malherbe considérait la poésie tout à fait comme son métier. Il manifestait pour cela une grande sévérité à l’égard du maniérisme et du baroque des poètes du siècle précédent et notamment de Philippe Desportes. On peut le considérer comme le premier théoricien de l’art classique fait de mesure et bienséance et l’un des réformateurs de notre langue.
L’hommage que lui adressa Boileau « Enfin Malherbe vint…, » exprime cette dette des écrivains classiques. François Mainard est l'un des deux fervents disciples de Malherbe. Né en 1582 et mort en 1646, il arrive à Paris en 1605 comme secrétaire de Marguerite de Valois. Grâce à elle, il rencontre le poète Malherbe. Même si il fait parti de l'Académie française dès sa création, il fréquente les libertins de l'époque comme Saint-Amant, Colletet...Il devient secrétaire de l'ambassade à Rome mais comme la fortune ne lui sourit pas, il se retire dans sa terre de Saint-Céré, où il compose ses plus beaux poèmes. Il meurt à l'âge de 64 ans.
Voici un poème du XVIIe siècle, écrit par Malherbe, « Consolation à M. du Perrier » (1598). Cet extrait de poème va de la première strophe à la septième.
Ta douleur, Du Périer, sera donc éternelle, Et les tristes discours Que te met en l’esprit l’amitié paternelle L’augmenteront toujours ! Le malheur de ta fille au tombeau descendue Par un commun trépas, Est-ce quelque dédale, où ta raison perdue Ne se retrouve pas ? Je sais de quels appas son enfance était pleine, Et n’ai pas entrepris, Injurieux ami, de soulager ta peine Avec que son mépris. Mais elle était du monde où les plus belles choses Ont le pire destin, Et rose elle a vécu ce que vivent les roses, L’espace d’un matin. Puis quand ainsi serait que selon ta prière, Elle aurait obtenu D’avoir en cheveux blancs terminé sa carrière, Qu’en fût-il advenu ? Penses-tu que, plus vieille, en la maison céleste Elle eût eu plus d’accueil ? Ou qu’elle eût moins senti la poussière funeste Et les vers du cercueil ? Non, non, mon Du Périer, aussitôt que la Parque Ôte l’âme du corps, L’âge s’évanouit au-deçà de la barque, Et ne suit point les morts.
IV. Les moralistes
Selon La Rochefoucaud, les moralistes « étudient l'anatomie de tout les replies du cœur. »
Un moraliste est un écrivain qui propose, sous une forme discontinue, des réflexions sur les mœurs. En latin mos, moris signifie les usages et les coutumes humaines, les caractères et les façons de vivre, plus simplement, le comportement des hommes. Le XVIIe siècle est le siècle d'apogée des moralistes.
La bruyère est un de ses fameux moralistes, c'est d'ailleurs à travers ses Caractères, qu'il livre une peinture exacte des mœurs de son temps. Voici un des ses portraits, Arrias :
« Arrias a tout lu, a tout vu, il veut le persuader ainsi; c'est un homme universel, et il se donne pour tel : Il aime mieux mentir que de se taire ou de paraître ignorer quelque chose. On parle, à la table d'un grand, d'une cour du Nord : il prend la parole, et l'ôte à ceux qui allaient dire ce qu'ils en savent ; il s'oriente dans cette région lointaine comme s'il en était originaire ; il discourt des moeurs de cette cour, des femmes du pays, de ses lois et de ses coutumes : il récite des historiettes qui y sont arrivées ; il les trouve plaisantes, et il en rit le premier jusqu'à éclater. Quelqu'un se hasarde de le contredire, et lui prouve nettement qu'il dit des choses qui ne sont pas vraies. Arrias ne se trouble point, prend feu au contraire contre l'interrupteur. « je n'avance, lui dit-il, je ne raconte rien que je ne sache d'original : je l'ai appris de Sethon, ambassadeur de France dans cette cour, revenu à Paris depuis quelques jours, que je connais familièrement, que j'ai fort interrogé, et qui ne m'a caché aucune circonstance. » Il reprenait le fil de sa narration avec plus de confiance qu'il ne l'avait commencée, lorsque l'un des conviés lui dit : « C'est Sethon à qui vous parlez, lui-même, et qui arrive de son ambassade. »
Ce portrait s'oppose tout à fait à l'idéal de l'honnête homme du XVIIe siècle. En effet, La Bruyère met l'accent sur le bavardage du personnage qui n'intéresse que lui, il monopolise la conversation alors que l'honnête homme doit mettre en lumière les autres convives. Arrias est égocentrique. Le personnage ne connaît pas ses convives et il ne porte aucune attention aux interlocuteurs contrairement à l'idéal de l'honnête homme du XVIIe siècle. D'autre part, il est prétentieux, trop sur de lui puisqu'il « ne se trouble point ».Arrias est un mythomane culturel. Il « aime mieux mentir que de se taire ». Nous pouvons dire que le personnage se vante jusqu'au bout, arrivant même à inventer pour combler ses lacunes de connaissances.
Il est aussi un mythomane social. Il veut étaler ses relations qui sont fausses, c'est un snob. Il se vante d'un pouvoir qu'il ne possède pas, il se prend pour quelqu'un qu'il n'est pas. Les caractéristiques d'Arrias nous montrent qu'il s'oppose complètement à l'idéal de l'honnête homme. Sa façon de converser n'est pas celle voulue au XVIIe siècle. Tous les défauts qui ne sont pas acceptés à l'époque sont illustrés dans le personnage d'Arrias.
V. Le genre épistolaire
Mme de Sévigné est certainement l'une des plus grandes figures du genre épistolaire. Elle vécut au XVIIe siècle, cette époque où la littérature était un sujet de choix, fort important ; elle fréquenta les salons comme celui de l'hôtel de Rambouillet, où grandes dames, gentilshommes et gens de lettres se rencontraient pour tenir des conversations raffinées, écouter ou lire les œuvres nouvelles ; elle y était connue et appréciée pour la vivacité de son esprit, sa curiosité toujours en alerte, son imagination, que l'on retrouve dans ses Lettres. Marie de Rabutin Chantal, marquise de Sévigné, est née le 5 février 1627, au château de Bourbilly, près de Saumur, en Bourgogne. En 1644, elle épouse Henri, marquis de Sévigné, de l'une des plus anciennes maisons de Bretagne; mais en 1651, le marquis est tué dans un duel par le chevalier d'Albret. Veuve à 25 ans, elle se consacre totalement à l'éducation de son fils et de sa fille. Sa fille ayant épousé le lieutenant général comte de Grignan doit le suivre dans son commandement de Provence; la séparation est très dure pour Mme de Sévigné qui entretient alors avec elle une correspondance régulière. Dans ces lettres, Mme de Sévigné raconte tous les événements qui se passaient à la cour comme à la ville, mais aussi à la campagne où elle se retire souvent au château des Rochers près de Vitré en Bretagne, dans les stations thermales où elle se rend pour se reposer. Cette correspondance n'est interrompue que par les trois voyages que la marquise fait à Grignan chez sa fille...
C'est pendant son troisième séjour à Grignan durant lequel elle a soigné sa fille malade qu'elle tombe malade à son tour et meurt de la petite vérole 6 jours plus tard en avril 1696. Ses Lettres , répandues de son vivant ne sont publiées qu'après sa mort .Elles constituent une sorte de chronique de la vie mondaine et parisienne, une évocation vivante de la cour brillante de Louis XIV, un témoignage sur une certaine société, l'aristocratie française, à une certaine époque, le XVIIe siècle. Voici l'extrait d'une de ses lettres qu’elle a envoyé à une de ses amies, pomponne.
A Pomponne « Il faut que je vous conte une petite historiette, qui est très vraie et qui vous divertira. Le Roi se mêle depuis peu de faire des vers ; MM. De Saint-Aignan et Dangeau lui apprennent comme il s'y faut prendre. Il fit l'autre jour un petit madrigal, que lui-même ne trouva pas trop joli. Un matin, il dit au maréchal de Gramont : Monsieur le maréchal, je vous prie, lisez ce petit madrigal, et voyez si vous en avez jamais vu un si impertinent. Parce qu'on sait que depuis peu j'aime les vers, on m'en apporte de toutes les façons. » Le maréchal, après avoir lu, dit au Roi : « Sire, Votre Majesté juge divinement bien de toutes choses ; il est vrai que voilà le plus sot et le plus ridicule madrigal que j'aie jamais lu. » Le Roi se mit à rire, et lui dit : « N'est-il pas vrai que celui qui l'a fait est bien fat ? – Sire, il n'y a pas moyen de lui donner un autre nom. – Oh bien ! dit le Roi, je suis ravi que vous m'en ayez parlé si bonnement ; c'est moi qui l'ai fait. – Ah ! Sire, quelle trahison ! Que votre majesté me le rende ; je l'ai lu brusquement. – Non, Monsieur le maréchal ; les premiers sentiments sont toujours les plus naturels. » Le Roi a fort ri de cette folie, et tout le monde trouve que voilà la plus cruelle petite chose que l'on puisse faire à un vieux courtisan. Pour moi, qui aime toujours à faire des réflexions, je voudrais que le Roi en fît là-dessus, et qu'il jugeât par là combien il est loin de ne connaître jamais la vérité. A Paris, lundi 1er décembre (1664) Mme de Sévigné met en scène, dans cette lettre une anecdote illustrant l'état d'esprit qui règne dans l'entourage de Louis XIV. Elle est présentée sous la forme d'un récit et d'un dialogue, pour raconter une petite scène de vie de cour qui s'apparente au théâtre par la mise en situation, la rapidité de la scène et la tonalité comique qui la traverse. L'intérêt majeur de cette lettre réside dans la mise en scène du roi qui met à l'épreuve la sincérité d'un courtisan. Ce récit propose ensuite une réflexion sur l'hypocrisie du courtisan et des courtisans en général.
VI. La querelle des anciens
À la fin du XVIIe siècle, cette controverse littéraire oppose les « Anciens » qui défendent les grands auteurs antiques et souhaitent qu’ils restent des « modèles » dans la création artistique et les « Modernes », quant à eux, estiment qu’il faut innover et pensent que la création artistique de l’époque peut rivaliser avec le passé.
Le 27 janvier 1687, Charles Perrault présente à l’Académie française son poème \"Le siècle de Louis le Grand\" qui déclenche une polémique dans le domaine littéraire. Dès lors, deux groupes d'écrivains s'opposent sur la direction à prendre dans ce domaine. Les Anciens, dont font partie La Fontaine, Boileau ou encore Racine, prônent l'imitation et l'adaptation d'œuvres antiques dans leurs ouvrages. Les Modernes, emmenés par Perrault, soutiennent que les oeuvres de l'Antiquité grecque et romaine peuvent être dépassées en qualité par des formes artistiques nouvelles.
La « querelle » des Anciens et des Modernes fut donc pour ceux qui la vécurent un débat très intense, virulent et pas seulement une dispute entre érudits. Elle ne cesse, dans le dernier quart du XVIIe siècle, de prendre de l'ampleur. Boileau vole au secours de Phèdre, son élection à l'Académie française, en 1684, marque la faveur du roi et le déclin apparent du parti adverse. Mais, en 1687, Perrault donne son Siècle de Louis le Grand, où il dit préférer « le siècle de Louis au beau siècle d'Auguste ». Puis il commence les Parallèles des Anciens et des Modernes, qui compteront quatre volumes, dont le dernier paraît en 1697 ; quatre volumes encore des Hommes illustres qui ont paru en France durant ce siècle se succéderont de 1696 à 1700. Les deux ennemis n'accepteront de se réconcilier qu'en 1694, après une intervention du Grand Arnauld, à la veille de sa mort ! Avec la Digression sur les Anciens et les Modernes de Fontenelle, l'argument est moins politique ou esthétique que philosophique, et il annonce les Lumières : il est raisonnable de concevoir une accumulation progressive des savoirs. Cette idée enlève tout prestige à l'Antiquité, elle inscrit l'activité des hommes dans le temps de l'histoire, et non plus dans celui des renaissances. En 1691, l'élection de Fontenelle à l'Académie semblait marquer un nouveau retournement, cette fois en faveur des Modernes. Celle de La Bruyère en 1693, partisan déclaré des Anciens, concrétisait la trêve.
La querelle allait rebondir, au début du siècle suivant, entre Anne Dacier, auteur d'une traduction savante de l'Iliade parue en 1711et Houdar de la Motte, protégé de Fontenelle, qui ne revendiquant plus qu'une fidélité au « fond des choses » voulut offrir une traduction très libre et versifiée – au motif qu'Homère était devenu à peu près illisible, et qu'il convenait de le mettre au goût du jour. Sa version de l'épopée, avec le Discours sur Homère qui l'accompagnait, allait susciter aussitôt une réplique de Mme Dacier avec Des causes de la corruption du goût, et un grand remue-ménage dans la république des Lettres. Cette « querelle d'Homère » semble se clore avec la correspondance entre La Motte et Fénelon, puis la Lettre à l'Académie de ce dernier, louant aussi bien Homère et Virgile que Molière. La Querelle a contribué à l'affirmation d'une « doctrine classique », contrariée par les Modernes, comme à la promotion de genres comme l'opéra ou le conte, plus proches de la préciosité et du goût mondain. Les débats entre « corruption » et « progrès » ont ouvert un espace nouveau, en posant sous un nouveau jour la question de la relativité du goût et la question du beau.
Partie IV : La vie au château de Chantilly
Scène de chasse devant le château de Chantilly, Perdrix, Jean-François,
Le Grand Condé, David Teniers le Jeune
Sommaire
Partie I : Présentation page 3
Partie II : Le classicisme dans les arts page 5
Partie III : Littérature page 10
-Le théâtre page 10
-Le roman page 15
-La poésie page 16
-Les moralistes page 18
-Le genre épistolaire page 19
-La querelle des Anciens et des Modernes page 20
Partie IV : La vie au château de Chantilly page 22
Liens utiles
- Vous développerez librement, en vous appuyant sur des exemples précis, tirés de vos lectures ou de votre expérience artistique, les réflexions que vous suggèrent ces remarques d'André Gide : « C'est un travers de notre époque de surcoter l'originalité. Il n'est pas un des grands auteurs du XVIIe siècle qui n'ait été (et ne se soit donné pour) un imitateur. Mais de nos jours, ce que l'on estime avant tout, ce sont, en musique, peinture ou littérature, des points de départ, dussent-ils n
- "Dans toutes les littératures, les auteurs subjectifs ont été nombreux. Et c'est une vérité élémentaire que de dire qu'en un sens tout écrivain est subjectif, quels que puissent être ses efforts pour éliminer le coefficient personnel dans la peinture qu'il fait des choses et de l'homme. Mais il n'est pas moins vrai que les différences à cet égard sont infiniment graduées, et que les termes extrêmes de l'échec en arrivent à représenter deux fonctions de l'écrivain qui sont presque sans
- Le Classicisme dans l'architecture et la peinture
- Un historien de la littérature française écrit : « La Bruyère, dans ses Caractères, imite bien les grands moralistes classiques, mais il innove par les raffinements et les nouveautés de son style, par le souci du détail concret, par les portraits et la peinture des moeurs contemporaines. » Illustrez et commentez, en donnant des exemples.
- Toutes les expressions artistiques - arts plastiques, architecture, musique, littérature - sont concernées par le mouvement baroque, qui s'est étendu à tous les pays catholiques en leur donnant parfois leurs plus grands chefs-d'oeuvre.































