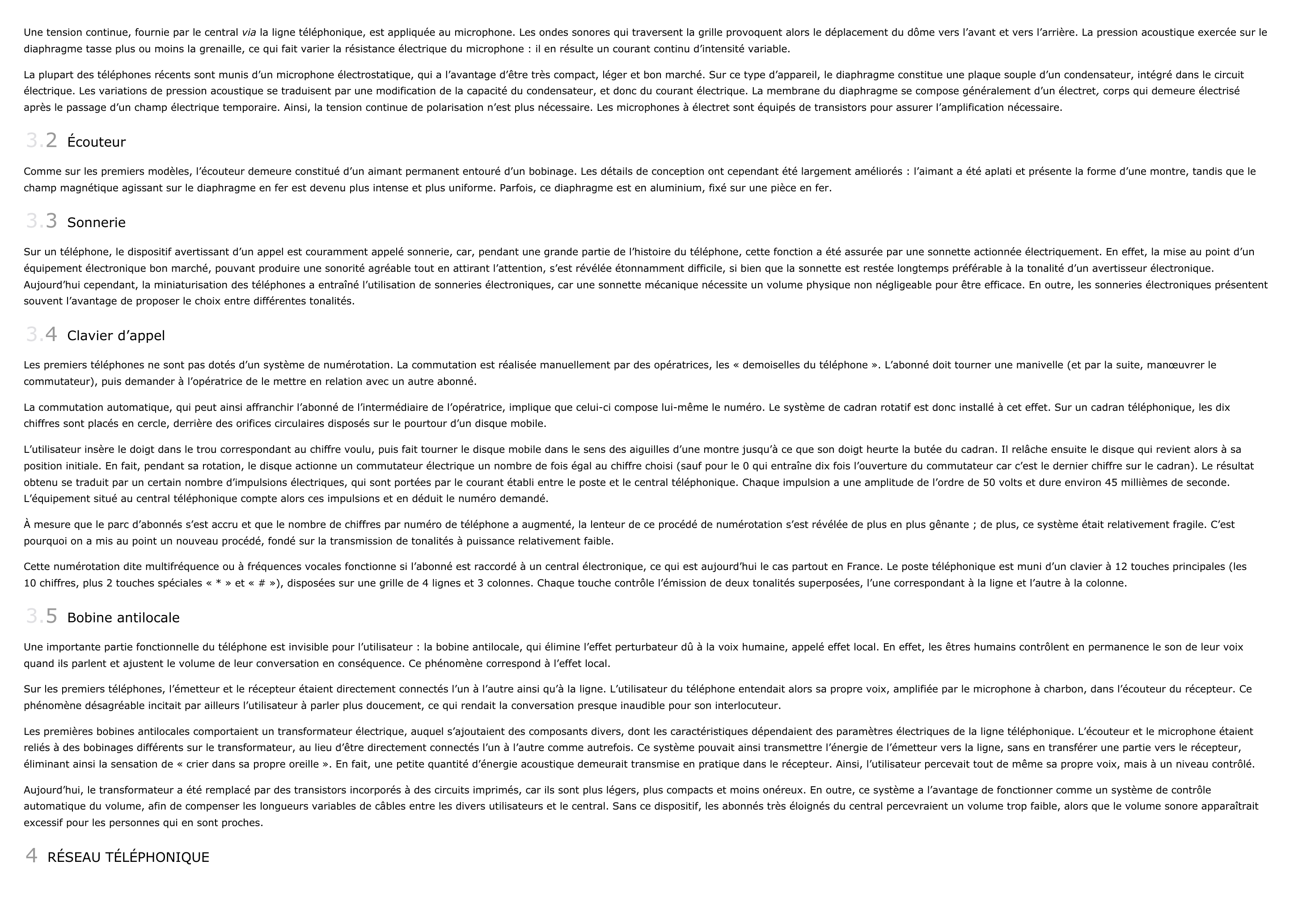téléphone - informatique.
Publié le 25/04/2013
Extrait du document
«
Une tension continue, fournie par le central via la ligne téléphonique, est appliquée au microphone.
Les ondes sonores qui traversent la grille provoquent alors le déplacement du dôme vers l’avant et vers l’arrière.
La pression acoustique exercée sur le
diaphragme tasse plus ou moins la grenaille, ce qui fait varier la résistance électrique du microphone : il en résulte un courant continu d’intensité variable.
La plupart des téléphones récents sont munis d’un microphone électrostatique, qui a l’avantage d’être très compact, léger et bon marché.
Sur ce type d’appareil, le diaphragme constitue une plaque souple d’un condensateur, intégré dans le circuit
électrique.
Les variations de pression acoustique se traduisent par une modification de la capacité du condensateur, et donc du courant électrique.
La membrane du diaphragme se compose généralement d’un électret , corps qui demeure électrisé
après le passage d’un champ électrique temporaire.
Ainsi, la tension continue de polarisation n’est plus nécessaire.
Les microphones à électret sont équipés de transistors pour assurer l’amplification nécessaire.
3. 2 Écouteur
Comme sur les premiers modèles, l’écouteur demeure constitué d’un aimant permanent entouré d’un bobinage.
Les détails de conception ont cependant été largement améliorés : l’aimant a été aplati et présente la forme d’une montre, tandis que le
champ magnétique agissant sur le diaphragme en fer est devenu plus intense et plus uniforme.
Parfois, ce diaphragme est en aluminium, fixé sur une pièce en fer.
3. 3 Sonnerie
Sur un téléphone, le dispositif avertissant d’un appel est couramment appelé sonnerie, car, pendant une grande partie de l’histoire du téléphone, cette fonction a été assurée par une sonnette actionnée électriquement.
En effet, la mise au point d’un
équipement électronique bon marché, pouvant produire une sonorité agréable tout en attirant l’attention, s’est révélée étonnamment difficile, si bien que la sonnette est restée longtemps préférable à la tonalité d’un avertisseur électronique.
Aujourd’hui cependant, la miniaturisation des téléphones a entraîné l’utilisation de sonneries électroniques, car une sonnette mécanique nécessite un volume physique non négligeable pour être efficace.
En outre, les sonneries électroniques présentent
souvent l’avantage de proposer le choix entre différentes tonalités.
3. 4 Clavier d’appel
Les premiers téléphones ne sont pas dotés d’un système de numérotation.
La commutation est réalisée manuellement par des opératrices, les « demoiselles du téléphone ».
L’abonné doit tourner une manivelle (et par la suite, manœuvrer le
commutateur), puis demander à l’opératrice de le mettre en relation avec un autre abonné.
La commutation automatique, qui peut ainsi affranchir l’abonné de l’intermédiaire de l’opératrice, implique que celui-ci compose lui-même le numéro.
Le système de cadran rotatif est donc installé à cet effet.
Sur un cadran téléphonique, les dix
chiffres sont placés en cercle, derrière des orifices circulaires disposés sur le pourtour d’un disque mobile.
L’utilisateur insère le doigt dans le trou correspondant au chiffre voulu, puis fait tourner le disque mobile dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que son doigt heurte la butée du cadran.
Il relâche ensuite le disque qui revient alors à sa
position initiale.
En fait, pendant sa rotation, le disque actionne un commutateur électrique un nombre de fois égal au chiffre choisi (sauf pour le 0 qui entraîne dix fois l’ouverture du commutateur car c’est le dernier chiffre sur le cadran).
Le résultat
obtenu se traduit par un certain nombre d’impulsions électriques, qui sont portées par le courant établi entre le poste et le central téléphonique.
Chaque impulsion a une amplitude de l’ordre de 50 volts et dure environ 45 millièmes de seconde.
L’équipement situé au central téléphonique compte alors ces impulsions et en déduit le numéro demandé.
À mesure que le parc d’abonnés s’est accru et que le nombre de chiffres par numéro de téléphone a augmenté, la lenteur de ce procédé de numérotation s’est révélée de plus en plus gênante ; de plus, ce système était relativement fragile.
C’est
pourquoi on a mis au point un nouveau procédé, fondé sur la transmission de tonalités à puissance relativement faible.
Cette numérotation dite multifréquence ou à fréquences vocales fonctionne si l’abonné est raccordé à un central électronique, ce qui est aujourd’hui le cas partout en France.
Le poste téléphonique est muni d’un clavier à 12 touches principales (les
10 chiffres, plus 2 touches spéciales « * » et « # »), disposées sur une grille de 4 lignes et 3 colonnes.
Chaque touche contrôle l’émission de deux tonalités superposées, l’une correspondant à la ligne et l’autre à la colonne.
3. 5 Bobine antilocale
Une importante partie fonctionnelle du téléphone est invisible pour l’utilisateur : la bobine antilocale, qui élimine l’effet perturbateur dû à la voix humaine, appelé effet local.
En effet, les êtres humains contrôlent en permanence le son de leur voix
quand ils parlent et ajustent le volume de leur conversation en conséquence.
Ce phénomène correspond à l’effet local.
Sur les premiers téléphones, l’émetteur et le récepteur étaient directement connectés l’un à l’autre ainsi qu’à la ligne.
L’utilisateur du téléphone entendait alors sa propre voix, amplifiée par le microphone à charbon, dans l’écouteur du récepteur.
Ce
phénomène désagréable incitait par ailleurs l’utilisateur à parler plus doucement, ce qui rendait la conversation presque inaudible pour son interlocuteur.
Les premières bobines antilocales comportaient un transformateur électrique, auquel s’ajoutaient des composants divers, dont les caractéristiques dépendaient des paramètres électriques de la ligne téléphonique.
L’écouteur et le microphone étaient
reliés à des bobinages différents sur le transformateur, au lieu d’être directement connectés l’un à l’autre comme autrefois.
Ce système pouvait ainsi transmettre l’énergie de l’émetteur vers la ligne, sans en transférer une partie vers le récepteur,
éliminant ainsi la sensation de « crier dans sa propre oreille ».
En fait, une petite quantité d’énergie acoustique demeurait transmise en pratique dans le récepteur.
Ainsi, l’utilisateur percevait tout de même sa propre voix, mais à un niveau contrôlé.
Aujourd’hui, le transformateur a été remplacé par des transistors incorporés à des circuits imprimés, car ils sont plus légers, plus compacts et moins onéreux.
En outre, ce système a l’avantage de fonctionner comme un système de contrôle
automatique du volume, afin de compenser les longueurs variables de câbles entre les divers utilisateurs et le central.
Sans ce dispositif, les abonnés très éloignés du central percevraient un volume trop faible, alors que le volume sonore apparaîtrait
excessif pour les personnes qui en sont proches.
4 RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Philippe Breton, Histoire de l'informatique (résumé et analyse)
- rapport de stage en informatique au TIC de l'hôpital de Vésale en Belgique
- Stage d'observation Informatique 3eme
- rapport de stage en entreprise informatique
- L'informatique transforme-t-elle la pensée ?