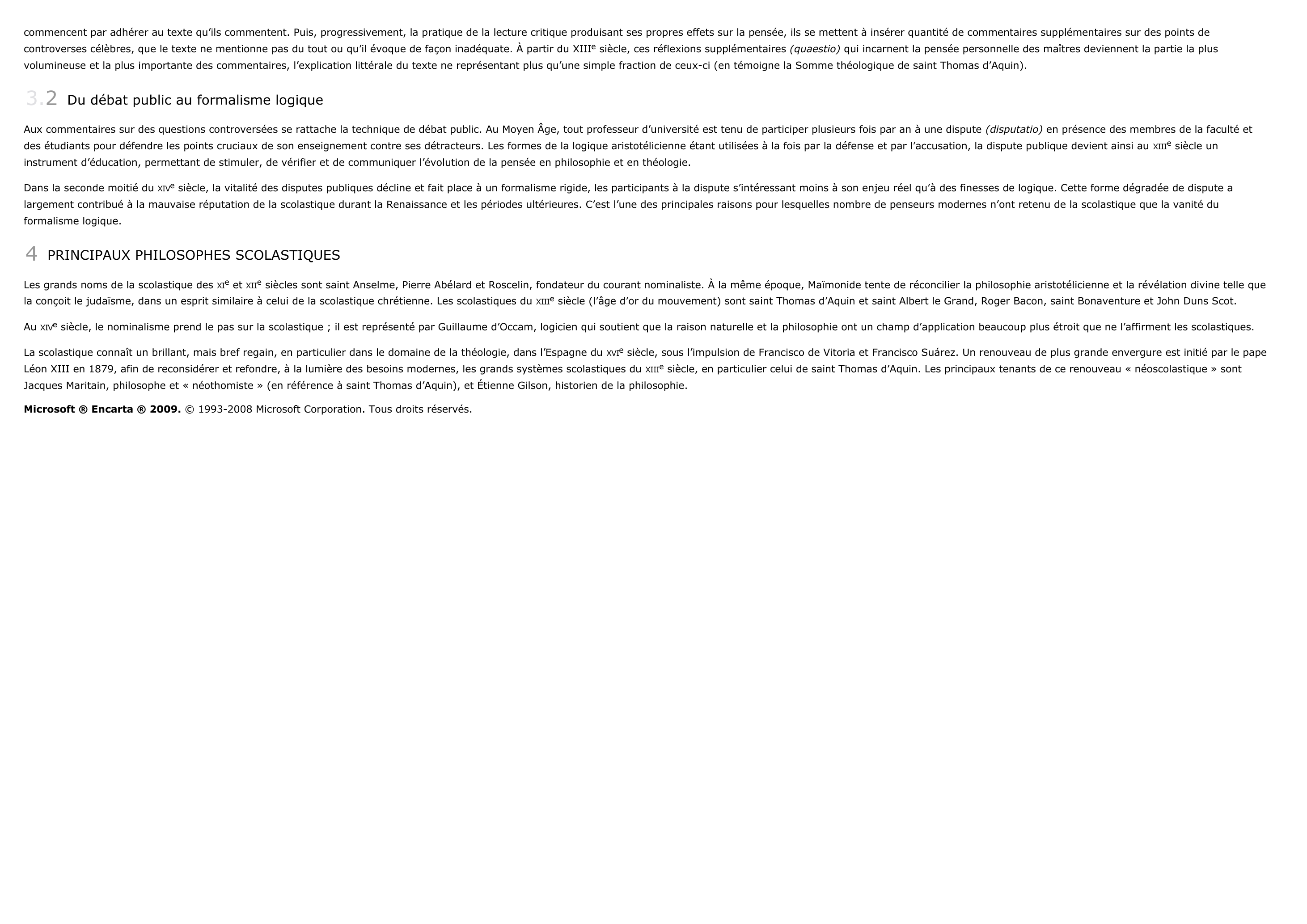scolastique - philosophie.
Publié le 08/05/2013
Extrait du document


«
commencent par adhérer au texte qu’ils commentent.
Puis, progressivement, la pratique de la lecture critique produisant ses propres effets sur la pensée, ils se mettent à insérer quantité de commentaires supplémentaires sur des points de
controverses célèbres, que le texte ne mentionne pas du tout ou qu’il évoque de façon inadéquate.
À partir du XIII e siècle, ces réflexions supplémentaires (quaestio) qui incarnent la pensée personnelle des maîtres deviennent la partie la plus
volumineuse et la plus importante des commentaires, l’explication littérale du texte ne représentant plus qu’une simple fraction de ceux-ci (en témoigne la Somme théologique de saint Thomas d’Aquin).
3. 2 Du débat public au formalisme logique
Aux commentaires sur des questions controversées se rattache la technique de débat public.
Au Moyen Âge, tout professeur d’université est tenu de participer plusieurs fois par an à une dispute (disputatio) en présence des membres de la faculté et
des étudiants pour défendre les points cruciaux de son enseignement contre ses détracteurs.
Les formes de la logique aristotélicienne étant utilisées à la fois par la défense et par l’accusation, la dispute publique devient ainsi au XIIIe siècle un
instrument d’éducation, permettant de stimuler, de vérifier et de communiquer l’évolution de la pensée en philosophie et en théologie.
Dans la seconde moitié du XIVe siècle, la vitalité des disputes publiques décline et fait place à un formalisme rigide, les participants à la dispute s’intéressant moins à son enjeu réel qu’à des finesses de logique.
Cette forme dégradée de dispute a
largement contribué à la mauvaise réputation de la scolastique durant la Renaissance et les périodes ultérieures.
C’est l’une des principales raisons pour lesquelles nombre de penseurs modernes n’ont retenu de la scolastique que la vanité du
formalisme logique.
4 PRINCIPAUX PHILOSOPHES SCOLASTIQUES
Les grands noms de la scolastique des XIe et XIIe siècles sont saint Anselme, Pierre Abélard et Roscelin, fondateur du courant nominaliste.
À la même époque, Maïmonide tente de réconcilier la philosophie aristotélicienne et la révélation divine telle que
la conçoit le judaïsme, dans un esprit similaire à celui de la scolastique chrétienne.
Les scolastiques du XIIIe siècle (l’âge d’or du mouvement) sont saint Thomas d’Aquin et saint Albert le Grand, Roger Bacon, saint Bonaventure et John Duns Scot.
Au XIVe siècle, le nominalisme prend le pas sur la scolastique ; il est représenté par Guillaume d’Occam, logicien qui soutient que la raison naturelle et la philosophie ont un champ d’application beaucoup plus étroit que ne l’affirment les scolastiques.
La scolastique connaît un brillant, mais bref regain, en particulier dans le domaine de la théologie, dans l’Espagne du XVIe siècle, sous l’impulsion de Francisco de Vitoria et Francisco Suárez.
Un renouveau de plus grande envergure est initié par le pape
Léon XIII en 1879, afin de reconsidérer et refondre, à la lumière des besoins modernes, les grands systèmes scolastiques du XIIIe siècle, en particulier celui de saint Thomas d’Aquin.
Les principaux tenants de ce renouveau « néoscolastique » sont
Jacques Maritain, philosophe et « néothomiste » (en référence à saint Thomas d’Aquin), et Étienne Gilson, historien de la philosophie.
Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation.
Tous droits réservés..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'oisiveté est la mère de la philosophie (Hobbes)
- Philosophie marc aurele
- M Vergeade Philosophie : Explication du texte janv.21 Les idées et les âges (1927)P 102 -Manuel Delagrave -P 427-
- À propos de l'histoire de la philosophie (I).
- Philosophie Post-moderne