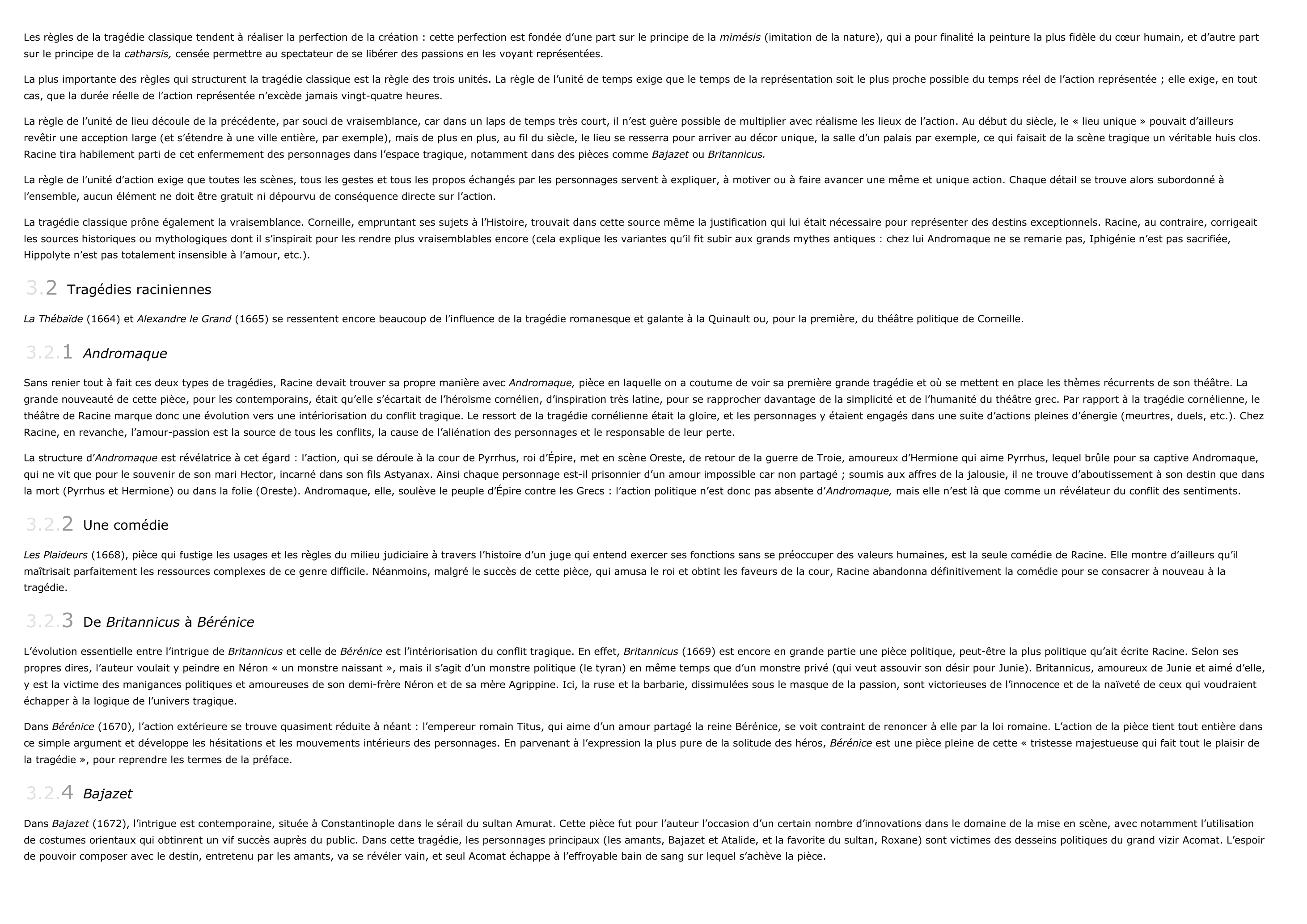Racine, Jean.
Publié le 14/05/2013
Extrait du document


«
Les règles de la tragédie classique tendent à réaliser la perfection de la création : cette perfection est fondée d’une part sur le principe de la mimésis (imitation de la nature), qui a pour finalité la peinture la plus fidèle du cœur humain, et d’autre part
sur le principe de la catharsis, censée permettre au spectateur de se libérer des passions en les voyant représentées.
La plus importante des règles qui structurent la tragédie classique est la règle des trois unités.
La règle de l’unité de temps exige que le temps de la représentation soit le plus proche possible du temps réel de l’action représentée ; elle exige, en tout
cas, que la durée réelle de l’action représentée n’excède jamais vingt-quatre heures.
La règle de l’unité de lieu découle de la précédente, par souci de vraisemblance, car dans un laps de temps très court, il n’est guère possible de multiplier avec réalisme les lieux de l’action.
Au début du siècle, le « lieu unique » pouvait d’ailleurs
revêtir une acception large (et s’étendre à une ville entière, par exemple), mais de plus en plus, au fil du siècle, le lieu se resserra pour arriver au décor unique, la salle d’un palais par exemple, ce qui faisait de la scène tragique un véritable huis clos.
Racine tira habilement parti de cet enfermement des personnages dans l’espace tragique, notamment dans des pièces comme Bajazet ou Britannicus.
La règle de l’unité d’action exige que toutes les scènes, tous les gestes et tous les propos échangés par les personnages servent à expliquer, à motiver ou à faire avancer une même et unique action.
Chaque détail se trouve alors subordonné à
l’ensemble, aucun élément ne doit être gratuit ni dépourvu de conséquence directe sur l’action.
La tragédie classique prône également la vraisemblance.
Corneille, empruntant ses sujets à l’Histoire, trouvait dans cette source même la justification qui lui était nécessaire pour représenter des destins exceptionnels.
Racine, au contraire, corrigeait
les sources historiques ou mythologiques dont il s’inspirait pour les rendre plus vraisemblables encore (cela explique les variantes qu’il fit subir aux grands mythes antiques : chez lui Andromaque ne se remarie pas, Iphigénie n’est pas sacrifiée,
Hippolyte n’est pas totalement insensible à l’amour, etc.).
3. 2 Tragédies raciniennes
La Thébaïde (1664) et Alexandre le Grand (1665) se ressentent encore beaucoup de l’influence de la tragédie romanesque et galante à la Quinault ou, pour la première, du théâtre politique de Corneille.
3.2. 1 Andromaque
Sans renier tout à fait ces deux types de tragédies, Racine devait trouver sa propre manière avec Andromaque, pièce en laquelle on a coutume de voir sa première grande tragédie et où se mettent en place les thèmes récurrents de son théâtre.
La
grande nouveauté de cette pièce, pour les contemporains, était qu’elle s’écartait de l’héroïsme cornélien, d’inspiration très latine, pour se rapprocher davantage de la simplicité et de l’humanité du théâtre grec.
Par rapport à la tragédie cornélienne, le
théâtre de Racine marque donc une évolution vers une intériorisation du conflit tragique.
Le ressort de la tragédie cornélienne était la gloire, et les personnages y étaient engagés dans une suite d’actions pleines d’énergie (meurtres, duels, etc.).
Chez
Racine, en revanche, l’amour-passion est la source de tous les conflits, la cause de l’aliénation des personnages et le responsable de leur perte.
La structure d’ Andromaque est révélatrice à cet égard : l’action, qui se déroule à la cour de Pyrrhus, roi d’Épire, met en scène Oreste, de retour de la guerre de Troie, amoureux d’Hermione qui aime Pyrrhus, lequel brûle pour sa captive Andromaque,
qui ne vit que pour le souvenir de son mari Hector, incarné dans son fils Astyanax.
Ainsi chaque personnage est-il prisonnier d’un amour impossible car non partagé ; soumis aux affres de la jalousie, il ne trouve d’aboutissement à son destin que dans
la mort (Pyrrhus et Hermione) ou dans la folie (Oreste).
Andromaque, elle, soulève le peuple d’Épire contre les Grecs : l’action politique n’est donc pas absente d’ Andromaque, mais elle n’est là que comme un révélateur du conflit des sentiments.
3.2. 2 Une comédie
Les Plaideurs (1668), pièce qui fustige les usages et les règles du milieu judiciaire à travers l’histoire d’un juge qui entend exercer ses fonctions sans se préoccuper des valeurs humaines, est la seule comédie de Racine.
Elle montre d’ailleurs qu’il
maîtrisait parfaitement les ressources complexes de ce genre difficile.
Néanmoins, malgré le succès de cette pièce, qui amusa le roi et obtint les faveurs de la cour, Racine abandonna définitivement la comédie pour se consacrer à nouveau à la
tragédie.
3.2. 3 De Britannicus à Bérénice
L’évolution essentielle entre l’intrigue de Britannicus et celle de Bérénice est l’intériorisation du conflit tragique.
En effet, Britannicus (1669) est encore en grande partie une pièce politique, peut-être la plus politique qu’ait écrite Racine.
Selon ses
propres dires, l’auteur voulait y peindre en Néron « un monstre naissant », mais il s’agit d’un monstre politique (le tyran) en même temps que d’un monstre privé (qui veut assouvir son désir pour Junie).
Britannicus, amoureux de Junie et aimé d’elle,
y est la victime des manigances politiques et amoureuses de son demi-frère Néron et de sa mère Agrippine.
Ici, la ruse et la barbarie, dissimulées sous le masque de la passion, sont victorieuses de l’innocence et de la naïveté de ceux qui voudraient
échapper à la logique de l’univers tragique.
Dans Bérénice (1670), l’action extérieure se trouve quasiment réduite à néant : l’empereur romain Titus, qui aime d’un amour partagé la reine Bérénice, se voit contraint de renoncer à elle par la loi romaine.
L’action de la pièce tient tout entière dans
ce simple argument et développe les hésitations et les mouvements intérieurs des personnages.
En parvenant à l’expression la plus pure de la solitude des héros, Bérénice est une pièce pleine de cette « tristesse majestueuse qui fait tout le plaisir de
la tragédie », pour reprendre les termes de la préface.
3.2. 4 Bajazet
Dans Bajazet (1672), l’intrigue est contemporaine, située à Constantinople dans le sérail du sultan Amurat.
Cette pièce fut pour l’auteur l’occasion d’un certain nombre d’innovations dans le domaine de la mise en scène, avec notamment l’utilisation
de costumes orientaux qui obtinrent un vif succès auprès du public.
Dans cette tragédie, les personnages principaux (les amants, Bajazet et Atalide, et la favorite du sultan, Roxane) sont victimes des desseins politiques du grand vizir Acomat.
L’espoir
de pouvoir composer avec le destin, entretenu par les amants, va se révéler vain, et seul Acomat échappe à l’effroyable bain de sang sur lequel s’achève la pièce..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Bérénice (1671) de Jean Racine (1639-1699)
- THÉBAÏDE OU LES FRÈRES ENNEMIS (La) Jean Racine (résumé)
- IPHIGÉNIE de Jean Racine (résumé & analyse)
- Phèdre 1677 Jean Racine
- BAJAZET Jean Racine - résumé de l'œuvre