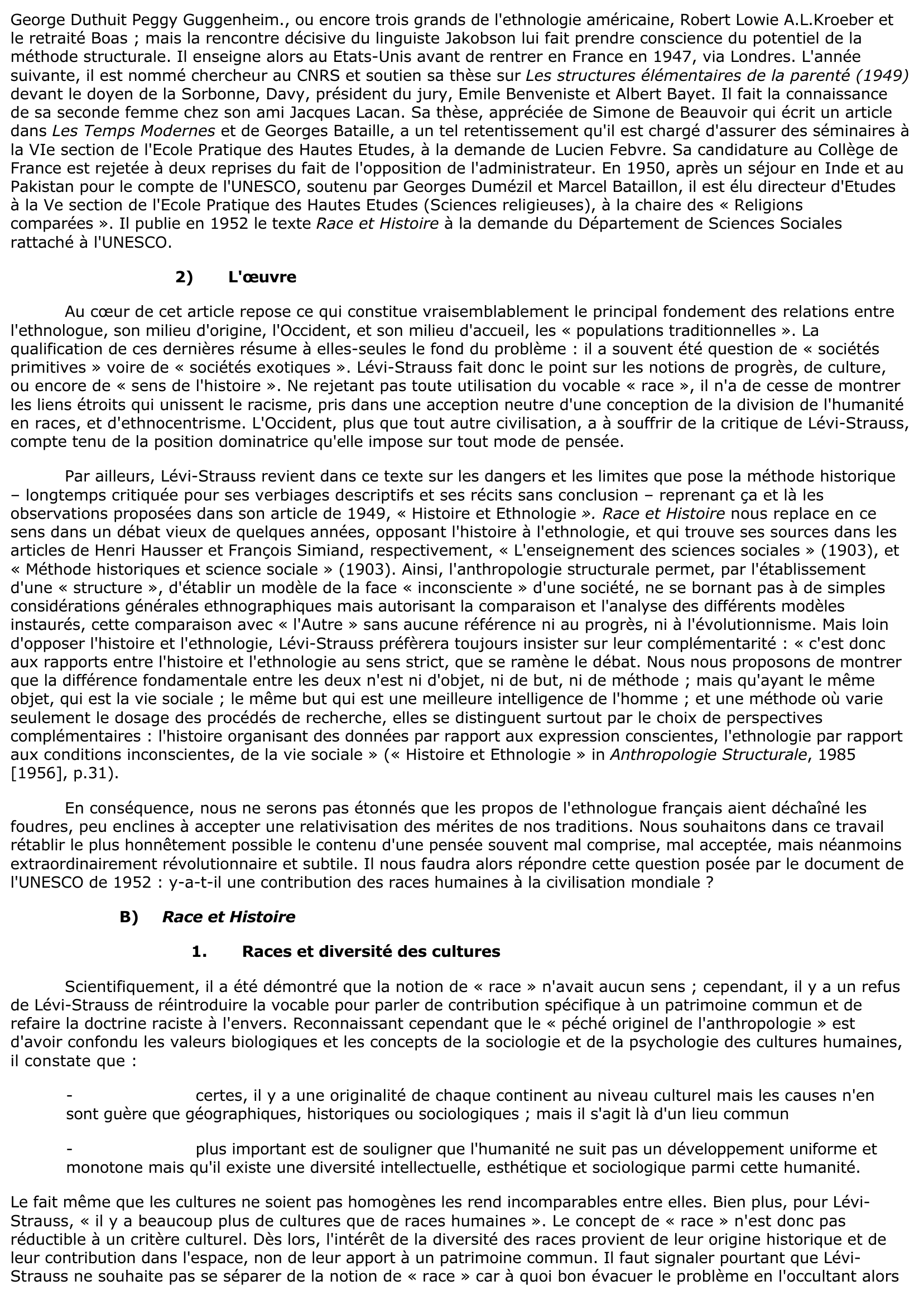A) Circonstances de production de l’œuvre
1) La vie de l’auteur
Fils d’un artiste peintre portraitiste, Claude Lévi-Strauss naît à Bruxelles le 28 novembre 1908. Il accomplit son second cycle universitaire au lycée parisien Janson de Sailly, avant d’entrer en hypokhâgne littéraire au lycée Condorcet (1926) où il suit le cours de philosophie d’André Cresson. Connaissant quelques difficultés en grec, il renonce à continuer en khâgne. Il ne passera alors les portes de la rue d’Ulm qu’en temps que secrétaire du « Groupe d’études socialiste des cinq Ecoles Normales Supérieures «. Fasciné par Marx, militant pour la SFIO, il choisit un double cursus de droit et de philosophie à la Sorbonne. Sous la direction de Célestin Bouglé, il valide son mémoire d’études supérieures, intitulé « Les postulats philosophiques du matérialisme historique « en même temps que sa licence de droit. En 1928, il prépare son agrégation de philosophie, au côté de Merleau-Ponty et Simone de Beauvoir, qu’il valide l’année suivante en compagnie de Ferdinand Alquié et Simone Weil. Sa rencontre avec Paul Nizan (marié à une de ses petites cousines) l’encourage sur le chemin de l’ethnologie ; la lecture du livre de Robert H. Lowie, Primitive Society (1920), lui fait définitivement franchir le pas. C’est ainsi qu’en 1934, après avoir accompli son service militaire, travaillé au ministère de la Guerre, professé au lycée de Mont-de-Marsan et abandonné toute carrière politique, il accepte la proposition de Célestin Bouglé, alors directeur de l’ENS, de postuler pour une chaire de sociologie à l’université de São Paulo, au Brésil. Il y enseigne durant trois ans jusqu’en 1938 ; jugé trop peu comtien et durkheimien par ses collègues, il lui faut l’appui de Pierre Monbeig et Fernand Braudel, membres de la mission française, pour se maintenir à son poste. Puis il effectue avec sa femme, Dina Dreyfus, une recherche pour le Musée de l’Homme qui le conduit dans le Mato Grosso à la rencontre des indiens Bororo et Caduveo, dont les conclusions seront soigneusement archivées dans ses Tristes Tropiques (1955). Nul enseignement universitaire ne lui confère son titre d’ethnologue, autre que ces articles (attirant notamment l’attention de Robert Lowie), ses collections exposées au Musée de l’Homme et l’aval de Lévy-Bruhl, Mauss et Rivet.
Il lève de nouveaux crédits auprès du Musée de l’Homme et de la Recherche scientifique qui lui permettent de lancer une nouvelle expédition au Brésil, à l’Ouest du Mato Grosso, entre Cuiabá et le Rio Madeira, le conduisant sur les terres des Nambikwara, séjour qu’il retrace dans son article « La vie familiale et sociale des Indiens Nambikwara «. De retour en France, la seconde guerre mondiale ne tarde pas à éclater : mobilisé puis démobilisé pour retourner dans l’Education nationale, il est miraculeusement aidé par un fonctionnaire de Vichy qui refuse de l’envoyer au lycée Henri IV où il a reçu un poste, en zone occupée. Il se voit refusé un visa pour le Brésil mais, avec le soutien de la fondation Rockefeller notamment, il est accueilli aux Etats-Unis, à New York, où il retrouve André Breton et Alfred Métraux, et fait la connaissance de Yves Tanguy, Marcel Duschamp, Max Ernst, Pierre Lazareff, George Duthuit Peggy Guggenheim., ou encore trois grands de l’ethnologie américaine, Robert Lowie A.L.Kroeber et le retraité Boas ; mais la rencontre décisive du linguiste Jakobson lui fait prendre conscience du potentiel de la méthode structurale. Il enseigne alors au Etats-Unis avant de rentrer en France en 1947, via Londres. L’année suivante, il est nommé chercheur au CNRS et soutien sa thèse sur Les structures élémentaires de la parenté (1949) devant le doyen de la Sorbonne, Davy, président du jury, Emile Benveniste et Albert Bayet. Il fait la connaissance de sa seconde femme chez son ami Jacques Lacan. Sa thèse, appréciée de Simone de Beauvoir qui écrit un article dans Les Temps Modernes et de Georges Bataille, a un tel retentissement qu’il est chargé d’assurer des séminaires à la VIe section de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, à la demande de Lucien Febvre. Sa candidature au Collège de France est rejetée à deux reprises du fait de l’opposition de l’administrateur. En 1950, après un séjour en Inde et au Pakistan pour le compte de l’UNESCO, soutenu par Georges Dumézil et Marcel Bataillon, il est élu directeur d’Etudes à la Ve section de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (Sciences religieuses), à la chaire des « Religions comparées «. Il publie en 1952 le texte Race et Histoire à la demande du Département de Sciences Sociales rattaché à l’UNESCO.
2) L’œuvre
Au cœur de cet article repose ce qui constitue vraisemblablement le principal fondement des relations entre l’ethnologue, son milieu d’origine, l’Occident, et son milieu d’accueil, les « populations traditionnelles «. La qualification de ces dernières résume à elles-seules le fond du problème : il a souvent été question de « sociétés primitives « voire de « sociétés exotiques «. Lévi-Strauss fait donc le point sur les notions de progrès, de culture, ou encore de « sens de l’histoire «. Ne rejetant pas toute utilisation du vocable « race «, il n’a de cesse de montrer les liens étroits qui unissent le racisme, pris dans une acception neutre d’une conception de la division de l’humanité en races, et d’ethnocentrisme. L’Occident, plus que tout autre civilisation, a à souffrir de la critique de Lévi-Strauss, compte tenu de la position dominatrice qu’elle impose sur tout mode de pensée.
Par ailleurs, Lévi-Strauss revient dans ce texte sur les dangers et les limites que pose la méthode historique – longtemps critiquée pour ses verbiages descriptifs et ses récits sans conclusion – reprenant ça et là les observations proposées dans son article de 1949, « Histoire et Ethnologie «. Race et Histoire nous replace en ce sens dans un débat vieux de quelques années, opposant l’histoire à l’ethnologie, et qui trouve ses sources dans les articles de Henri Hausser et François Simiand, respectivement, « L’enseignement des sciences sociales « (1903), et « Méthode historiques et science sociale « (1903). Ainsi, l’anthropologie structurale permet, par l’établissement d’une « structure «, d’établir un modèle de la face « inconsciente « d’une société, ne se bornant pas à de simples considérations générales ethnographiques mais autorisant la comparaison et l’analyse des différents modèles instaurés, cette comparaison avec « l’Autre « sans aucune référence ni au progrès, ni à l’évolutionnisme. Mais loin d’opposer l’histoire et l’ethnologie, Lévi-Strauss préfèrera toujours insister sur leur complémentarité : « c’est donc aux rapports entre l’histoire et l’ethnologie au sens strict, que se ramène le débat. Nous nous proposons de montrer que la différence fondamentale entre les deux n’est ni d’objet, ni de but, ni de méthode ; mais qu’ayant le même objet, qui est la vie sociale ; le même but qui est une meilleure intelligence de l’homme ; et une méthode où varie seulement le dosage des procédés de recherche, elles se distinguent surtout par le choix de perspectives complémentaires : l’histoire organisant des données par rapport aux expression conscientes, l’ethnologie par rapport aux conditions inconscientes, de la vie sociale « (« Histoire et Ethnologie « in Anthropologie Structurale, 1985 [1956], p.31).
En conséquence, nous ne serons pas étonnés que les propos de l’ethnologue français aient déchaîné les foudres, peu enclines à accepter une relativisation des mérites de nos traditions. Nous souhaitons dans ce travail rétablir le plus honnêtement possible le contenu d’une pensée souvent mal comprise, mal acceptée, mais néanmoins extraordinairement révolutionnaire et subtile. Il nous faudra alors répondre cette question posée par le document de l’UNESCO de 1952 : y-a-t-il une contribution des races humaines à la civilisation mondiale ?
B) Race et Histoire
1. Races et diversité des cultures
Scientifiquement, il a été démontré que la notion de « race « n’avait aucun sens ; cependant, il y a un refus de Lévi-Strauss de réintroduire la vocable pour parler de contribution spécifique à un patrimoine commun et de refaire la doctrine raciste à l’envers. Reconnaissant cependant que le « péché originel de l’anthropologie « est d’avoir confondu les valeurs biologiques et les concepts de la sociologie et de la psychologie des cultures humaines, il constate que :
- certes, il y a une originalité de chaque continent au niveau culturel mais les causes n’en sont guère que géographiques, historiques ou sociologiques ; mais il s’agit là d’un lieu commun
- plus important est de souligner que l’humanité ne suit pas un développement uniforme et monotone mais qu’il existe une diversité intellectuelle, esthétique et sociologique parmi cette humanité.
Le fait même que les cultures ne soient pas homogènes les rend incomparables entre elles. Bien plus, pour Lévi-Strauss, « il y a beaucoup plus de cultures que de races humaines «. Le concept de « race « n’est donc pas réductible à un critère culturel. Dès lors, l’intérêt de la diversité des races provient de leur origine historique et de leur contribution dans l’espace, non de leur apport à un patrimoine commun. Il faut signaler pourtant que Lévi-Strauss ne souhaite pas se séparer de la notion de « race « car à quoi bon évacuer le problème en l’occultant alors même que la question de l’inégal progrès des sociétés est couramment soulevée ; cela reviendrait à « jeter le bébé avec l’eau du bain «.
La diversité des cultures pose plus de problèmes encore que celle des races : elles ne sont pas juxtaposées dans l’espace, mais plus ou moins éloignées spatialement, parfois d’époque différente, certaines sans écriture. Ainsi, l’historien ne peut connaître la vie des sociétés que de façon indirecte le plus souvent, au travers d’écrits, de récits ou de monuments. L’absence d’écriture signifie que nous ne saurons jamais rien sur un grand nombre de sociétés.
L’historien, lui, se voit confronté dans cette diversité à plusieurs types de différences lors d’une comparaison entre deux sociétés :
- différence entre deux sociétés partant d’un tronc commun (Grande-Bretagne et Etats-Unis)
- différence entre deux sociétés sans rapport direct (empire Incas et Dahomey d’Afrique)
- des sociétés au contact récent qui paraissent provenir de la même civilisation.
Certaines sociétés au passé commun tendent à accentuer leur particularisme (par exemple par le biais de la langue : France et Angleterre) ; d’autres, aux origines divergentes se rapprochent (langues russe et turque, se différenciant d’autres langues slaves). Ce qui est valable pour la langue l’est aussi pour l’art, les institutions sociales, la religion. De cette observation, Lévi-Strauss, sans y répondre, pose la question de l’existence d’un « optimum de diversité «.
Mais le plus important ne repose pas sur ces quelques remarques : la diversité n’est pas un problème seulement bilatéral entre deux sociétés, mais proprement interne : elle s’entend par la création de groupes, de castes, de classes, de milieux, de professions…et cette diversification évolue lorsque évolue l’effectif social ; ainsi, l’hégémonie aryenne qui caractérise l’Inde ancienne en est-elle l’exemple. Aussi, la diversité des cultures n’est pas un phénomène statique : une société ne reste jamais cloîtrée très longtemps : si les deux Amériques sont coupées du monde et d’elles-mêmes durant 10 ou 20 000 ans, en leur sein, beaucoup de sociétés ont des contacts et cherchent à se différencier. La diversité des cultures est moins le fruit de l’isolement que du contact : combien de règles, de coutumes sont le résultat au sein d’une société de l’observation insoupçonnée d’autres cultures ?
2. Les différentes approches de l’histoire et du progrès
Cette diversité des cultures n’a pas souvent été perçue comme un « phénomène naturel, résultant des rapports directs ou indirects entre les sociétés « sinon comme un scandale : ces sociétés parlant des autres ont employé les vocables de « barbares «, « sauvages «, « mauvais «, « méchants « ou encore de « singes de terre «…L’Autre est rejeté hors de la culture, dans les entrailles de la nature. L’existence d’autrui est niée : les Indiens pourraient-ils avoir une âme ? Le procès de Valladolid tranche cette question. Mais loin de créer une ligne de démarcation entre les sociétés, cette volonté de discriminer crée une identification entre ces peuples qui agissent tous de la même manière.
Faut-il pour autant nier la différence ? Selon Lévi-Strauss, il ne faudrait pas faire l’amalgame différence biologique/différence culturelle : nier cette dernière conduit à considérer l’humanité comme une et unique et donc à y voir des stades d’évolution convergeant vers un but unique. De cela apparaît une « faux évolutionnisme «, un évolutionnisme social, répandu au cours du temps par des auteurs comme Vigo, Comte, Condorcet ou encore Spencer et Tylor, au risque de voir resurgir un système d’infériorité. Mais une hache ne donne pas naissance à une hache : où est l’évolution ici ?
Une société peut répartir les cultures en trois catégories :
- celles qui sont ses contemporaines, mais en un autre lieu géographique
- celles qui sont situées dans un même lieu géographique, mais l’ayant précédée dans le temps
- celles situées en un autre lieu, à une autre époque ; ceux sont les plus difficiles à cerner, surtout si ces sociétés ne possèdent pas d’écriture et sont sans archive (ce qui serait le cas de la moitié des terres peuplées, soit 90 à 99% des sociétés selon les régions, depuis le début de la civilisation).
- Pour la première catégorie, il y a une tendance des historiens ou des scientifiques à vouloir créer un « faux évolutionnisme « : l’Orient est comparé au Moyen-Age, le Pékin d’avant la seconde guerre mondiale au siècle des Lumières, les indigènes australiens aux hommes de l’âge de pierre. Il existe un risque incessant de voir un rapprochement entre deux coutumes, deux techniques primitives et de voir une généralisation abusive des comparaisons, plus simples à formuler qu’une bonne compréhension de la technologie de ces sociétés. Et que souhaite-t-on comparer : les peintures rupestres sont tout aussi éloignées de l’art magdalénien que de l’art européen. Ne faisons pas non plus de notre ignorance la base d’une classification excessive qui en viendrait à parler de « peuple sans histoire « alors que nous ne la connaissons, puisque l’évidence même est bien de reconnaître que chaque peuple en possède une (par définition).
La conception de la diversité des cultures nous fait aboutir à deux sortes d’histoires :
- une « histoire progressive, acquisitive « qui considère l’augmentation du patrimoine des trouvailles et des inventions au cours du temps
- une histoire réactive, avec tout autant de talents mais où manque le don synthétique (chaque innovation ne s’ajoute pas à la précédente, elle s’y dissout).
Pour la deuxième catégorie, l’idée de progrès est plus difficile à repousser : deux sociétés à deux époques différentes. Et pourtant, ne nous y trompons pas, notre vision d’une histoire divisée en phases est empiriquement erronée : pour seul exemple, il est aisé de remarquer la coexistence, et non la séparation, des trois périodes préhistoriques que sont les paléolithiques inférieur, moyen et supérieur. Aisé de vérifier aussi que certaines techniques, tel le Levalloisien, ne sont pas reproductibles aujourd’hui. Aisé enfin de se souvenir que l’homme de Neandertal n’a pas précédé l’Homo sapiens, mais lui a été contemporain. En effet, le développement des connaissances tend à répartir dans l’espace ce que nous avons étaler dans le temps. Le progrès n’est ainsi ni nécessaire, ni continu : il y a mutationnisme, bonds, sauts, voire changements d’orientation, à l’image du cavalier aux échec. L’histoire n’est cumulative que de temps à autres, lorsque des combinaisons favorables s’opèrent. Et cette histoire ne reste pas l’apanage d’une civilisation et d’une période donnée : des Amériques, nous avons hérité de l’arboriculture, de la domestication des végétaux, de la perfection du tissage, de la céramique ou des métaux précieux ; de l’Ancien Monde, de la pomme de terre, du caoutchouc, du tabac ou de la coca (qui est à la base de l’anesthésie moderne) ; le maïs et l’arachide ont transité par l’Afrique avant de rejoindre l’Europe. Faut-il rappeler encore que le zéro était connu des Mayas 500 ans avant sa découverte par les Indiens qui l’ont transmis aux Arabes, puis aux Européens. De la même façon, les exemples politiques abondent : le système socialiste ou le système totalitaire ne sont-ils pas des « legs « de l’empire Inca.
3. Du rejet de l’ethnocentrisme au relativisme culturel
Parler d’histoire cumulative lorsqu’une société semble avoir apporté quelque chose au patrimoine commun ne correspond ni plus ni moins qu’à de l’ethnocentrisme car ce patrimoine et cet apport sont définis comme étant ceux dont se sert la société qui juge. Or il existe aussi en sciences sociales une loi de la relativité, mais renversée par rapport à celle qui caractérise la physique : les systèmes évoluant dans le même sens que le sien paraissent plus actifs, les autres semblent statiques. Dans le cas des sciences sociales, la vitesse correspond à l’information, à la signification : il y a une relation entre la notion physique de « mouvement apparent « et celle sociologique de « quantité d’informations «.
Ainsi, si les Etats-Unis nous paraissent les plus développés, c’est que nous choisissons comme critère le PIB par habitant (dominant dans nos sociétés) ; or il est possible de s’intéresser à nombre d’autres critères : le langage, les techniques, l’art, la connaissance scientifique, les croyances religieuses, l’organisation sociale, politique ou économique. L’immobilisme apparent de certaines sociétés résulte essentiellement de l’ignorance de leurs intérêts véritables. La culture d’une société ne consiste pas en son apport propre (écriture pour les Phéniciens, poudre à canon pour les Chinois, verre et acier pour les Indiens) mais dans la manière dont chacune groupe ces éléments, les retient ou les exclut. La civilisation mondiale n’est pas l’habit d’Arlequin : chaque société doit résoudre les mêmes problèmes humains ; l’originalité de chacune se trouve dans leur mise en perspective, dans la façon originale de les résoudre.
Est-il encore possible alors de porter un jugement vrai sur une autre société que la sienne ? Il suffit de remarquer que toutes les civilisations reconnaissent, l’une après l’autre, la supériorité de l’une d’entre elle : la civilisation occidentale. Pourtant, loin de récupérer son héritage, son infrastructure, elles se contentent d’en copier la superstructure. Cette adhésion au « modèle « n’est donc pas spontanée : la civilisation occidentale, en imposant ses comptoirs et son mode de pensée, a cassé les structures de ces sociétés, sans jamais rien y remplacer ; dès lors, l’adhésion se réalise par l’absence de tout autre choix. Si ce n’est le consentement, seule la plus grande énergie de la civilisation occidentale a pu conduire à sa supériorité ?En fait, ce phénomène objectivable, comme nous l’avons déjà dit, ne repose que sur deux valeurs qu’elle a su imposer : l’augmentation de la production disponible par tête et celle de l’espérance de vie. Et lorsque l’on rappelle que les découvertes les plus importantes sont le fruit des sociétés les plus archaïques – la révolution néolithique ayant débouchée sur le feu, l’agriculture, le tissage, l’élevage et la poterie – il est souvent rétorqué que ces découvertes sont les jeux du hasard, jamais du mérite ; l’effort de création intellectuelle est réservé à nos sociétés.
Loin de nier la part de hasard qui conduit aux grandes trouvailles, les découvertes préhistoriques ne sauraient être la seule résultante de la bonne fortune : la poterie nécessite par exemple de connaître la particularité des combustibles, la forme du foyer, le type de chaleur et la durée de cuisson…un travail d’expérimentation continue. Il n’y avait certainement pas moins de Pasteur dans ces civilisations ; aussi, si la révolution industrielle n’était pas née en Europe Occidentale, elle l’aurait été ailleurs, quelques années plus tard. Les Mexicains connaissaient la roue (présente sur des jouets d’enfants), les Chinois les rudiments de la poudre à canon : peu de choses ont séparé les premiers du chariot, les seconds des armes de guerre. Par ailleurs, la chronologie géographique des découvertes n’a pas de sens, elles sont souvent simultanées, sinon inéluctables partout. A l’échelle de l’humanité, nous ne pouvons retenir que deux grandes vagues d’innovations : les révolutions néolithique et industrielle.
La distinction histoire stationnaire/histoire cumulative n’a ainsi aucun sens, elle dépend de nos intérêts propres et ne parvient jamais à être assez nette : dans le cas des inventions techniques, aucune période, aucune culture n’est absolument stationnaire. Tous les peuples possèdent transforment, améliorent, oublient, sinon ils disparaîtraient. Toute histoire est cumulative, à des degrés différents. Ce degré de différence relève des probabilités : à un jeu de roulette, si un observateur veut recenser toutes les suites de 9 chiffres, il n’en verra jamais aucune et ne conclura qu’à un chaos des événements ; si un observateur cherche une loi gérant l’alternance rouge/noir ou pair/impair, il trouvera de l’ordre dans cette apparence de chaos. « L’humanité n’évolue pas dans un sens unique. Et si sur un certain plan, elle semble stationnaire, même régressive, cela ne signifie pas que d’un autre point de vue, elle n’est pas le siège d’importantes transformations « (pp.67-68).
4. La collaboration et le progrès : une question de probabilités ?
Rares seraient les joueurs qui pourraient se prévaloir de rassembler une longue série, observée lors d’un jeu de roulette. Mais, dès lors qu’il associe ses efforts avec ceux d’autres joueurs postés à d’autres roulettes, il voit ses chances de remplir sa séries décupler. L’un pourrait apporter le 1, le 2, le 6 ; un autre, le 7, le 9 et le 10 ; des autres encore, le 3 et le 8, le 4 et le 5. L’histoire cumulative diffère peu de cette suite de 10 chiffres : aucune civilisation ne peut se prétendre supérieure, elle est le fruit de coalitions de diverses cultures, de combinaisons plus ou moins volontaires (migrations, échanges, guerres). Cette histoire n’est pas le propre d’une civilisation, elle résulte d’une « manière d’être ensemble «, par opposition aux « sociétés solitaires «. Si les neuf dixièmes de l’histoire de l’humanité tendent plus vers l’histoire stationnaire, la raison peut être exprimée par un manque de contact entre les civilisations : une question de chance, de probabilité somme toute. Il a fallu attendre longtemps avant qu’une combinaison favorable ne sorte. Fort de cette analyse, il est possible de déduire que le danger pour une culture n’est pas de se frotter aux autres, bien au contraire, mais de se marginaliser : elle court alors à sa perte. De là, il vient que le concept de « civilisation mondiale « n’a aucun sens ; souvent employé afin de considérer l’ensemble des contributions de chaque culture à un patrimoine commun, contributions choisies selon des critères arbitraires et ethnocentriques, ce concept ne peut représenté qu’une coquille vide ou qu’un processus complexe de coalition des cultures : en ce cas, la notion perd tout son sens car chaque culture préserve son originalité, et l’unité cache un phénomène fondamentalement multiple.
Ainsi le progrès est-il conditionné par la coalition des culture. Cependant ce « jeu en commun « conduit inéluctablement à une « homogénéisation des ressources de chaque joueur «, donc à une diminution croissante des opportunités de gains. Deux solutions sont alors envisageables pour espérer une dynamique continue du progrès :
- un accroissement au sein de chaque culture des « écarts différentiels «, parallèlement à l’homogénéisation des cultures ; Lévi-Strauss explique de cette façon le développement des inégalités qui accompagne chaque révolution technique (par exemple la naissance du Prolétariat)
- un accroissement du nombre de partenaires dans l’échange ; Lévi-Strauss prend alors comme exemple le rôle de la colonisation ou du l’impérialisme.
Aussi conclue-t-il que « la tolérance n’est pas une position contemplative, dispensant les indulgences à ce qui fut ou qui est. C’est une attitude dynamique qui consiste à prévoir, à comprendre et à promouvoir ce qui veut être « (p.84).
C) Portée de l’œuvre
1) Diogène couché
Roger Caillois n’apprécié guère les facéties de Lévi-Strauss. Il exprime son sentiment, dans La nouvelle revue française en 1954, dénonçant l’« Illusion à rebours «. L’article fustige l’attrait idéologique pour les sociétés primitives jusqu’à la négation de toute idée de progrès et prône le rétablissement de la hiérarchie culturelle. La réponse de l’ethnologue français ne tarde pas. Elle est publiée dans les Temps Modernes (volume 10, n°110, 1955) sous le titre de « Diogène couché «. Sur un ton tout aussi virulent que les paroles de Caillois, Lévi-Strauss fait remarquer : « Diogène prouvait le mouvement en marchant. M.Caillois se couche pour ne pas le voir. Il est vrai que son maître avait recommandé que l’on l’enterrât à plein ventre, convaincu que le monde ne tarderait pas à se mettre à l’envers et donc à le rétablir à l’endroit « (p.1187). Il s’agit dans ce texte d’une véritable leçon de commentaire de texte que nous livre l’auteur, reprenant méthodiquement chacune des critiques formulées à son encontre, la rapprochant soigneusement du passage de Race et Histoire sur lequel elle porte et la faisant voler en éclat ; tous les thèmes sont abordés : l’idée de progrès, la diversité des cultures, l’évolution des techniques, la question du hasard…Puis, toujours dans une optique d’exemplarité scolastique, il se penche sur l’argumentation même de Caillois, mettant en lumière les contradictions et les inexactitudes. Et puisque l’existence du métier d’ethnologue tend à constituer pour ce dernier la preuve de la supériorité de la civilisation occidentale sur toute autre, Lévi-Strauss en profite pour répondre une bonne fois pour toutes à la critique de relativisme culturel qui lui est souvent adressée.
Ainsi, se donne-t-il l’occasion d’expliquer sa situation de déraciné, s’écartant d’autant plus de chez lui qu’il s’en rapproche, ne trouvant une trace de domiciliation que dans l’exil : « il [l’ethnologue] ne circule pas entre le pays des sauvages et celui des civilisés ; dans quelque sens qu’il aille, il retourne d’entre les morts « (p.1217). L’absurdité de la critique de Caillois semble le toucher au plus au point ; rarement a-t-on vu réponse aussi acerbe de sa part : « M.Caillois se livre à un exercice hybride qui commence par des bouffonneries de table d’hôte, se poursuit en déclamations de prédicateur pour se terminer par des lamentations de pénitent « (p.1202). Il n’aura de cesse de défendre les positions prises dans Race et Histoire au cours de ses ouvrages postérieurs ; du moins se bornera-t-il à dialoguer avec des interlocuteurs qui le satisferont pleinement, balayant d’un coup de main les critiques d’auteurs jugés indésirables : « nous ne lui [Roger Caillois] faisons pas de querelle et nous lui demandons rien sinon qu’il nous permette de travailler en paix. Et qu’il aille chercher ailleurs ses imago « (p.1220).
2) Sur la relation histoire/ethnologie
Il semble que sur point, la critique de Lévi-Strauss ait été très mal comprise : il s’agissait bien pour lui de dénoncer une vision téléologique et historiciste de la réalité, une histoire purement narrative ou encore une « Histoire « hypostasiée par certaines philosophies.
Race et Histoire montre clairement la difficulté que doit surmonter la discipline historique devant des sociétés sans écrits ; en ce cas, les irréductibles historiens auront à travailler à partir de documents accumulés dans le temps qui devront être passés au crible d’une critique rigoureuse et utilisés avec le recul nécessaire. Lévi-Strauss s’insurge donc contre toute histoire imaginaire qui comble par l’invention les lacunes de ses sources. L’ethnologue permet alors de faire accéder cette histoire à des terrains où ses matériaux de travail n’existe pas ; mais ce dernier, ayant pour objectif de rendre compte de la situation contemporaine d’une société, ne doit se priver d’aucune source, et certainement pas de l’appui historique, dès lors que toute donnée est vérifiable. S’il fallait encore convaincre quiconque de l’adhérence de Lévi-Strauss aux vertus de l’histoire, nous citerions l’auteur dans le texte : « on ne fait pas de bonne analyse structurale, si on ne fait pas d’abord une bonne analyse historique. Si nous ne faisons pas une bonne analyse historique dans le domaine des faits ethnographiques, ce n’est pas parce que nous la dédaignons, c’est parce que malheureusement elle nous échappe « [« Philosophie et Anthropologie «, Interview, Cahiers de Philosophie, n°1, janvier 1966].
Nous avons évoqué précédemment l’une des deux limites principales de l’histoire sur l’ethnologie dans le cadre de l’étude de telles sociétés : le problème des archives. Mais, un autre point ne semble pas moins primordial : les documents qui pourraient exister sur ces sociétés proviennent de représentants étrangers aux communautés indigènes ; ce sont des écrits de missionnaires, des récits d’explorateurs, ou encore des comptes rendus d’administrateurs et de colons. Autant de documents dont les prises de position sont ethnocentriques, ne voyant dans l’histoire de ces sociétés qu’un progrès tout factice : ce progrès dépend de normes occidentales que les colonisateurs n’ont cessé d’inculquer à ces sociétés pendant des siècles, confondant socialisation et idée de progrès. Pour reprendre une expression de Marcel Hénaff, « l’histoire narrée est celle des mutations provoquées par ces contacts «. L’historien doit se méfier non seulement du biais que son mode de pensée provoque, mais, de surcroît, de l’influence qu’il peut avoir sur la vie de ces indigènes. L’ethnocentrisme est alors une arme redoutable qui compromet toute bonne compréhension des civilisations et détourne les données disponibles du sens subjectif que les indigènes leur prêtent.
L’histoire, selon Lévi-Strauss, doit en tirer plusieurs enseignements. Il lui faut, en toute objectivité, accepter la diversité des races et des cultures, afin d’en finir avec l’histoire linéaire qui doit être envisagée comme multiple, comme un ensemble de séries discontinues. L’histoire doit être pensée en terme d’homologies et d’isomorphismes, non plus en terme de causalités. Nous soulignons ici le refus de l’auteur d’une histoire universelle, entendue comme valable pour toutes les sociétés ; reste alors à définir ce qui réalise l’unité de l’humanité. La réponse est à chercher dans les méandres de « l’esprit humain «, conçu comme faculté à créer et recréer la diversité culturelle qui oppose mais rassemble : « ce sont les différences qui se ressemblent « [Le totémisme aujourd’hui, PUF, Paris, 1962, p.115]. En ce sens, et contrairement au fonctionnalisme, l’histoire comme récit de la diversité, ne peut représenter une épine dans le pieds du structuralisme, mais une aide à l’édification d’une structure.
3) De la contre-attaque braudelienne au consensus d’André Burguière
Pourtant pensée de la réconciliation, l’œuvre de Lévi-Strauss a trop souvent été perçue comme une menace de la part des historiens, à l’instar desquels Fernand Braudel, bien convaincu à défendre les Annales et les apports aux sciences sociales de Marc Bloch et Lucien Febvre. La réponse de Braudel relève plutôt d’un argument d’autorité que d’une problématique construite : « nous avons vu naître, renaître et s’épanouir, depuis cinquante ans une série de sciences humaines impérialistes « affirme-t-il lors de son discours inaugural au Collège de France, repris dans ses Ecrits sur l’histoire, parus chez Armand Colin en 1969 (p.31) : l’histoire semble donc donner raison à l’histoire alors que l’ethnologie doit bien se méfier de son impertinente jeunesse.
Mais Braudel se garde bien de s’en prendre directement à Lévi-Strauss et à la contribution de l’ethnologie aux sciences humaines. Son message, à l’image de celui du chef de file des structuralistes français, n’en est pas moins un discours de l’unité des sciences de l’homme. Mais ce discours n’est-il pas double ? Dans son article « La longue durée «, F.Braudel tire les conclusions de l’avènement de l’anthropologie, à l’heure où l’engouement (idéologique ?) pour les mathématiques se fait clairement ressentir. Cette nouvelle discipline s’est montrée capable de s’attaquer aux structures les plus inconscientes, aux lois qui régissent tant les échanges de mots, que les échanges de biens ou de femmes, par le biais de l’utilisation de modèles, louant les mérites de la linguistique et de la théorie des jeux (Lévi-Strauss a lu et apprécié Von Neumann et Morgenstern). Et Braudel de se servir de cette mouvance pour en tirer la promotion de sa discipline : il réfute l’histoire événementielle pour souligner les mérites de l’histoire diachronique, car même « la prohibition de l’inceste est une réalité de longue durée «. L’histoire est alors reconsidérée, rétablie dans sa position prépondérante. François Dosse, dans son Histoire (p.51, 2000 [1999], Paris, Armand Colin) va jusqu’à prétendre que « Braudel, contre Lévi-Strauss, renverse la conception linéaire du temps qui progresse vers un perfectionnement continu, [qu’] il lui substitue un temps quasi stationnaire où passé, présent et avenir ne diffèrent plus et se reproduisent sans discontinuité. Seul l’ordre de la répétition est possible, il privilégie les invariants et rend illusoire la notion d’événements «. Mais n’est-ce pas là reconnaître la crise de l’histoire et le triomphe du structuralisme car il s’agit bien de la thèse exposée par Lévi-Strauss dans Race et Histoire lorsqu’il souhaite rompre avec l’idée de progrès et préconise l’étude de l’histoire en série et non en continu.
Nous n’essayerons pas de chercher lequel de ces deux auteurs a vaincu les diverses joutes verbales ; remarquons simplement que notre dernière affirmation permet d’entrevoir un consensus relatif entre les deux pensées, une convergence certaine des opinions. Ce sera le rôle d’André Burguière de le réaliser. Il fait paraître en 1971 dans la revue des Annales de mai-août (n°3-4) un article intitulé « Histoire et Structure « dans lequel il exprime son ambition d’une histoire s’attaquant elle-aussi aux structures inconscientes, non pas contre mais au côté de l’anthropologie, rejetant la singularité des événements pris pour eux-même, recherchant les caractères universels et persistants que nous offre le temps. Et n’est-ce pas un comble, à l’heure où le structuralisme se meurt au sein de la sociologie et de l’anthropologie de voir les historiens le louer et le défendre, des historiographes ayant trouvé un sujet d’étude essentiel dans la figure de l’Autre aux historiens des Annales. Pour Bruguière, « un peu de structuralisme éloigne de l’histoire, beaucoup de structuralisme y ramène « (p.VII). Et Emmanuel Le Roy Ladurie de surenchérir en intitulant son discours inaugural au Collège de France : « L’Histoire immobile «. Par delà l’homologation des outils structuraux par les historiens, c’est toute l’œuvre de Lévi-Strauss qui est appréciée, idéalisée voire vénérée, jusque dans les débats qu’elle a su susciter.
Bibliographie indicative
DOSSE, François, L’histoire, janvier 2000 [1999], Armand Colin, collection Cursus.
HENAFF, Marcel, Claude Lévi-Strauss et l’anthropologie structurale, novembre 2000 [1991, Belfond], Agora, collection Pocket.
LEVI-STRAUSS, Claude, Anthropologie structurale 1, septembre 1985 [1958, Plon], Agora, collection Pocket.
LEVI-STRAUSS, Claude, Anthropologie structurale 2, août 1997 [1973, Plon], Agora, collection Pocket ; dont « Race et Histoire « (pp.377-422)
LEVI-STRAUSS, Claude, Race et Histoire, 1999 [1952, UNESCO ; 1972, Plon], Seuil, collection Point.