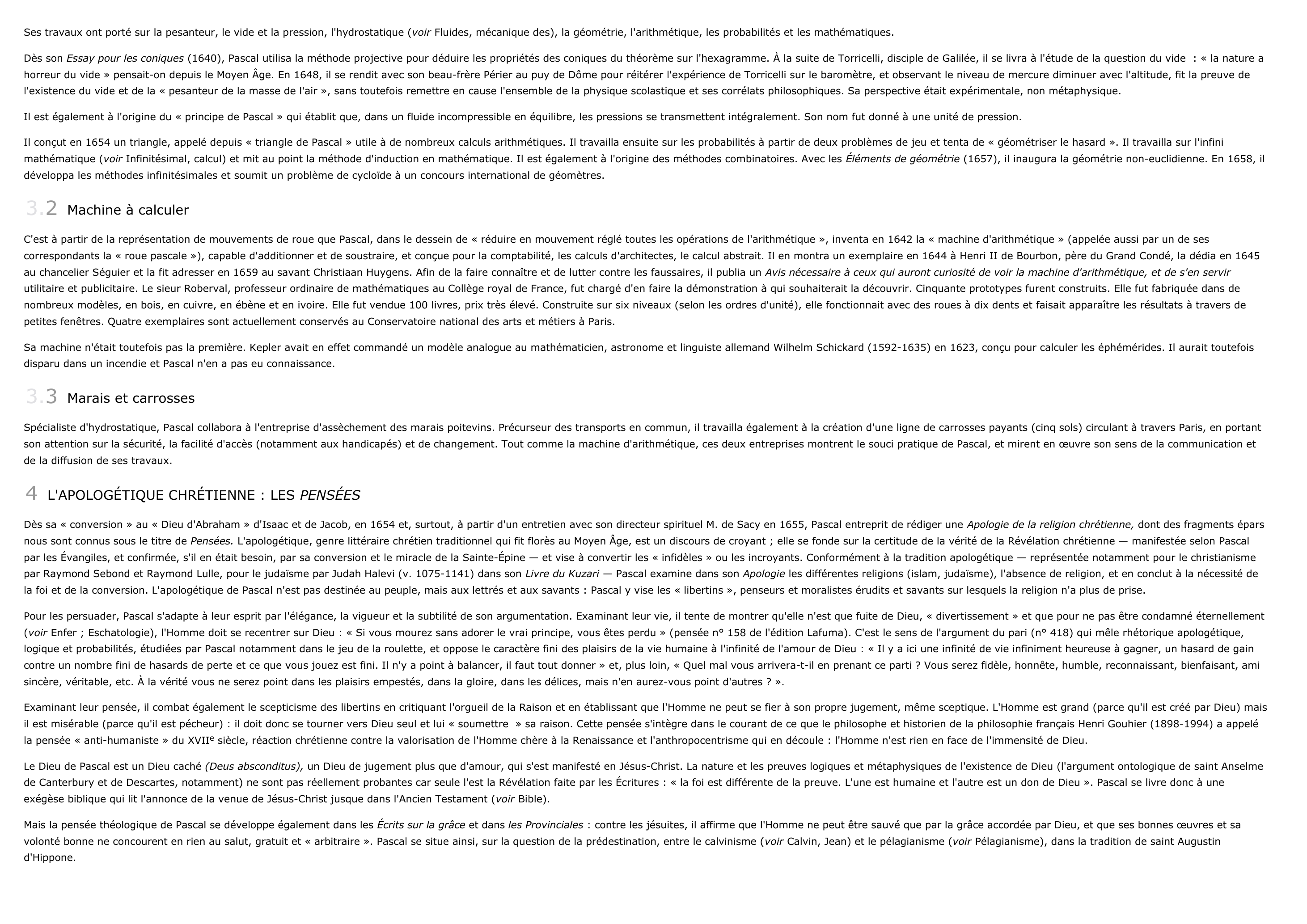Pascal, Blaise - philosophie.
Publié le 08/05/2013
Extrait du document


«
Ses travaux ont porté sur la pesanteur, le vide et la pression, l'hydrostatique ( voir Fluides, mécanique des), la géométrie, l'arithmétique, les probabilités et les mathématiques.
Dès son Essay pour les coniques (1640), Pascal utilisa la méthode projective pour déduire les propriétés des coniques du théorème sur l'hexagramme.
À la suite de Torricelli, disciple de Galilée, il se livra à l'étude de la question du vide : « la nature a
horreur du vide » pensait-on depuis le Moyen Âge.
En 1648, il se rendit avec son beau-frère Périer au puy de Dôme pour réitérer l'expérience de Torricelli sur le baromètre, et observant le niveau de mercure diminuer avec l'altitude, fit la preuve de
l'existence du vide et de la « pesanteur de la masse de l'air », sans toutefois remettre en cause l'ensemble de la physique scolastique et ses corrélats philosophiques.
Sa perspective était expérimentale, non métaphysique.
Il est également à l'origine du « principe de Pascal » qui établit que, dans un fluide incompressible en équilibre, les pressions se transmettent intégralement.
Son nom fut donné à une unité de pression.
Il conçut en 1654 un triangle, appelé depuis « triangle de Pascal » utile à de nombreux calculs arithmétiques.
Il travailla ensuite sur les probabilités à partir de deux problèmes de jeu et tenta de « géométriser le hasard ».
Il travailla sur l'infini
mathématique ( voir Infinitésimal, calcul) et mit au point la méthode d'induction en mathématique.
Il est également à l'origine des méthodes combinatoires.
Avec les Éléments de géométrie (1657), il inaugura la géométrie non-euclidienne.
En 1658, il
développa les méthodes infinitésimales et soumit un problème de cycloïde à un concours international de géomètres.
3. 2 Machine à calculer
C'est à partir de la représentation de mouvements de roue que Pascal, dans le dessein de « réduire en mouvement réglé toutes les opérations de l'arithmétique », inventa en 1642 la « machine d'arithmétique » (appelée aussi par un de ses
correspondants la « roue pascale »), capable d'additionner et de soustraire, et conçue pour la comptabilité, les calculs d'architectes, le calcul abstrait.
Il en montra un exemplaire en 1644 à Henri II de Bourbon, père du Grand Condé, la dédia en 1645
au chancelier Séguier et la fit adresser en 1659 au savant Christiaan Huygens.
Afin de la faire connaître et de lutter contre les faussaires, il publia un Avis nécessaire à ceux qui auront curiosité de voir la machine d'arithmétique, et de s'en servir
utilitaire et publicitaire.
Le sieur Roberval, professeur ordinaire de mathématiques au Collège royal de France, fut chargé d'en faire la démonstration à qui souhaiterait la découvrir.
Cinquante prototypes furent construits.
Elle fut fabriquée dans de
nombreux modèles, en bois, en cuivre, en ébène et en ivoire.
Elle fut vendue 100 livres, prix très élevé.
Construite sur six niveaux (selon les ordres d'unité), elle fonctionnait avec des roues à dix dents et faisait apparaître les résultats à travers de
petites fenêtres.
Quatre exemplaires sont actuellement conservés au Conservatoire national des arts et métiers à Paris.
Sa machine n'était toutefois pas la première.
Kepler avait en effet commandé un modèle analogue au mathématicien, astronome et linguiste allemand Wilhelm Schickard (1592-1635) en 1623, conçu pour calculer les éphémérides.
Il aurait toutefois
disparu dans un incendie et Pascal n'en a pas eu connaissance.
3. 3 Marais et carrosses
Spécialiste d'hydrostatique, Pascal collabora à l'entreprise d'assèchement des marais poitevins.
Précurseur des transports en commun, il travailla également à la création d'une ligne de carrosses payants (cinq sols) circulant à travers Paris, en portant
son attention sur la sécurité, la facilité d'accès (notamment aux handicapés) et de changement.
Tout comme la machine d'arithmétique, ces deux entreprises montrent le souci pratique de Pascal, et mirent en œuvre son sens de la communication et
de la diffusion de ses travaux.
4 L'APOLOGÉTIQUE CHRÉTIENNE : LES PENSÉES
Dès sa « conversion » au « Dieu d'Abraham » d'Isaac et de Jacob, en 1654 et, surtout, à partir d'un entretien avec son directeur spirituel M.
de Sacy en 1655, Pascal entreprit de rédiger une Apologie de la religion chrétienne, dont des fragments épars
nous sont connus sous le titre de Pensées. L'apologétique, genre littéraire chrétien traditionnel qui fit florès au Moyen Âge, est un discours de croyant ; elle se fonde sur la certitude de la vérité de la Révélation chrétienne — manifestée selon Pascal
par les Évangiles, et confirmée, s'il en était besoin, par sa conversion et le miracle de la Sainte-Épine — et vise à convertir les « infidèles » ou les incroyants.
Conformément à la tradition apologétique — représentée notamment pour le christianisme
par Raymond Sebond et Raymond Lulle, pour le judaïsme par Judah Halevi (v.
1075-1141) dans son Livre du Kuzari — Pascal examine dans son Apologie les différentes religions (islam, judaïsme), l'absence de religion, et en conclut à la nécessité de
la foi et de la conversion.
L'apologétique de Pascal n'est pas destinée au peuple, mais aux lettrés et aux savants : Pascal y vise les « libertins », penseurs et moralistes érudits et savants sur lesquels la religion n'a plus de prise.
Pour les persuader, Pascal s'adapte à leur esprit par l'élégance, la vigueur et la subtilité de son argumentation.
Examinant leur vie, il tente de montrer qu'elle n'est que fuite de Dieu, « divertissement » et que pour ne pas être condamné éternellement
(voir Enfer ; Eschatologie), l'Homme doit se recentrer sur Dieu : « Si vous mourez sans adorer le vrai principe, vous êtes perdu » (pensée n° 158 de l'édition Lafuma).
C'est le sens de l'argument du pari (n° 418) qui mêle rhétorique apologétique,
logique et probabilités, étudiées par Pascal notamment dans le jeu de la roulette, et oppose le caractère fini des plaisirs de la vie humaine à l'infinité de l'amour de Dieu : « Il y a ici une infinité de vie infiniment heureuse à gagner, un hasard de gain
contre un nombre fini de hasards de perte et ce que vous jouez est fini.
Il n'y a point à balancer, il faut tout donner » et, plus loin, « Quel mal vous arrivera-t-il en prenant ce parti ? Vous serez fidèle, honnête, humble, reconnaissant, bienfaisant, ami
sincère, véritable, etc.
À la vérité vous ne serez point dans les plaisirs empestés, dans la gloire, dans les délices, mais n'en aurez-vous point d'autres ? ».
Examinant leur pensée, il combat également le scepticisme des libertins en critiquant l'orgueil de la Raison et en établissant que l'Homme ne peut se fier à son propre jugement, même sceptique.
L'Homme est grand (parce qu'il est créé par Dieu) mais
il est misérable (parce qu'il est pécheur) : il doit donc se tourner vers Dieu seul et lui « soumettre » sa raison.
Cette pensée s'intègre dans le courant de ce que le philosophe et historien de la philosophie français Henri Gouhier (1898-1994) a appelé
la pensée « anti-humaniste » du XVII e siècle, réaction chrétienne contre la valorisation de l'Homme chère à la Renaissance et l'anthropocentrisme qui en découle : l'Homme n'est rien en face de l'immensité de Dieu.
Le Dieu de Pascal est un Dieu caché (Deus absconditus), un Dieu de jugement plus que d'amour, qui s'est manifesté en Jésus-Christ.
La nature et les preuves logiques et métaphysiques de l'existence de Dieu (l'argument ontologique de saint Anselme
de Canterbury et de Descartes, notamment) ne sont pas réellement probantes car seule l'est la Révélation faite par les Écritures : « la foi est différente de la preuve.
L'une est humaine et l'autre est un don de Dieu ».
Pascal se livre donc à une
exégèse biblique qui lit l'annonce de la venue de Jésus-Christ jusque dans l'Ancien Testament ( voir Bible).
Mais la pensée théologique de Pascal se développe également dans les Écrits sur la grâce et dans les Provinciales : contre les jésuites, il affirme que l'Homme ne peut être sauvé que par la grâce accordée par Dieu, et que ses bonnes œuvres et sa
volonté bonne ne concourent en rien au salut, gratuit et « arbitraire ».
Pascal se situe ainsi, sur la question de la prédestination, entre le calvinisme ( voir Calvin, Jean) et le pélagianisme ( voir Pélagianisme), dans la tradition de saint Augustin
d'Hippone..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La philosophie de Blaise PASCAL
- « Se moquer de la philosophie, c'est vraiment philosopher. » Blaise Pascal, Pensées, 4. Commentez cette citation.
- Je ne puis pardonner à Descartes: il aurait bien voulu, dans toute sa philosophie, pouvoir se passer de Dieu; mais il n'a pu s'empêcher de lui faire donner une chiquenaude, pour mettre le monde en mouvement; après cela, il n'a plus que faire de Dieu. Pensées (1670), 77 Pascal, Blaise. Commentez cette citation.
- Je ne puis pardonner à Descartes: il aurait bien voulu, dans toute sa philosophie, pouvoir se passer de Dieu; mais il n'a pu s'empêcher de lui faire donner une chiquenaude, pour mettre le monde en mouvement; après cela, il n'a plus que faire de Dieu. [ Pensées (1670), 77 ] Pascal, Blaise. Commentez cette citation.
- Se moquer de la philosophie, c'est vraiment philosopher. Blaise Pascal, Pensées, 4. Commentez cette citation.