PANTAGRUEL DE RABELAIS, CHAPITRE 10 - Comment Rabelais, dans ce texte, cherche-t-il à transmettre les idées humanistes ?
Publié le 23/11/2010
Extrait du document
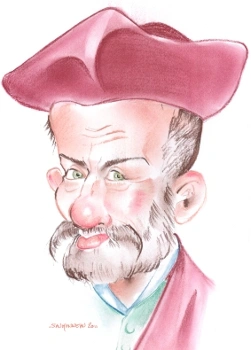
I : Une satire virulente du système politique hérité du Moyen Age.
Pantagruel regarde le droit qu’on lui présente avec les yeux d’un humaniste. Il en décèle tout de suite le ridicule et l’absurdité. Il le critique au nom des valeurs humanistes.
1) Une satire de la tradition du commentaire (par opposition au retour aux sources prôné par les humanistes).
a) La forme du procès, on préfère lire d’énormes dossiers que de laisser parler les gens, procédure lourde. Lourdeur illustrée par comparaison humoristique « ânes couillards « exprimée à travers le champ lexical du papier. Attitude critique de Pantagruel qui apparaît dans un vocabulaire péjoratif « ce fatras « + questions rhétoriques lignes 1 et 2 qui affirment implicitement l’absurdité de cette procédure.
b) Une démarche inefficace : lourds et vains, inefficace, improductif, on préfère la quantité à la qualité lignes 6-7, antithèse limpide/obscurcie, obscurcie les faits. Vocabulaire péjoratif, inepte + oxymore « déraisonnable raison «, absurdité, non sens de manière humoristique.
c) Une démarche nocive. Arguments déformés qui déforment les lois, allusion à Cépola ligne 4. Champ lexical de la tromperie et du vice.
2) La satire de l’ignorance
a) L’ignorance de « ce qui est nécessaire à l’intelligence des lois « ligne 13 (la compréhension). Le grec et le latin dans lesquels sont rédigés les textes de lois, ils ne peuvent pas comprendre par eux-mêmes, s’appuient sur des commentaires faits par les juristes du Moyen Age, énumération lignes 9-10. Ils ignorent aussi la philosophie morale et naturelle qui permet de comprendre les lois.
b) Satire des juristes à l’aide de procédés : souligner leur limite lignes 14-15, négation, il utilise des injures à leur égard. Dévalorisation sociale et intellectuelle à travers comparaisons ligne 23-24. Déshumanisation à travers comparaison avec des animaux, comparaison avec mule ligne 27 et à un crapaud lignes 29-30 + antiphrase (ironie).
Après avoir fait toutes ces critiques, Pantagruel en tire les conséquences. Dans le dernier paragraphe, il impose une ligne de conduite à ceux qu’il impose, affirmation de ses convictions humanistes : impératif (ordre) + adverbe « aussi « : conséquence.
Il critique la tradition du Moyen Age car elle s’oppose en tout point à la pensée humaniste dans laquelle il a été éduqué et dont il est l’incarnation.
II : Pantagruel : L’incarnation d’un idéal humaniste
1) Un savoir étendu
a) Un érudit, se réfère à ses nombreux auteurs, énumération, auteurs antiques mais aussi du Moyen Age, grande science. Emaille son texte de mots latins, maîtrise de nombreuses langues anciennes, capable de juger du style des différents auteurs, il admire les auteurs antiques.
b) Assurance qui apparaît dans de nombreuses formules, « c’est certain « ligne 14, « je suis sur « ligne 5, il se sent capable d’écrire un livre ligne 31, aspect humaniste : savant qui cherche à transmettre sa pensée.
2) Une éloquence persuasive
a) Maîtrise des procédés rhétoriques : questions rhétoriques dans les paragraphes 1, 2, 3, argumentation implicite qui oblige l’auditeur à réfléchir. Forte implication du locuteur, ponctuation forte, « je «, jurons, implication de l’auditeur avec « vous « qui interpelle ceux qui l’écoutent. Expressions de jugements de valeur très forts et très nombreux avec ton violent et méprisant qui a recours à un vocabulaire familier. Cette arrogance est peut-être volontaire. Pantagruel veut choquer, réveiller ces intellectuels endormis dans cette tradition.
b) Discours structuré et clair. Nombreux connecteurs logiques : progression rigoureuse dans la pensée, paragraphes, conclusion. Force de conviction, Pantagruel bien formé, brillant contradicteur, orateur comme l’avais avancé les sages.
3) L’appel au bon sens, au naturel
Malgré la violence et la virulence de son discours, côté provocateur, Pantagruel fait valoir ses idées auprès des savants qui suivent ses ordres parce que sa décision fait appel au bon sens, à un idéal de naturel, cher à l’humanisme, il refuse tout les commentaires, toutes les gloses lorsqu’il demande la comparution directe des plaignants. Refus des détours lorsqu’il affirme sa volonté de franchise, lignes 35-36.
Liens utiles
- « On a souvent vu en Rabelais le représentant typique de la Renaissance française [...]. L'accord exceptionnel d'un tempérament et d'une époque explique sans doute en partie la réussite de Rabelais, dont la pensée et l'œuvre sont étroitement liées aux milieux très divers qu'il a connus, à ses expériences multiples tirées d'un vaste savoir et d'une vie très riche. Attentif à l'actualité, il a été sensible à tous les mouvements intellectuels de son temps. Esprit lucide et généreux, tout
- Séquence I L’humanisme. Texte 1 : Rabelais, Tiers Livre, chapitre 51, « L’éloge du Pantagruélion ».
- PANTAGRUEL CHAPITRE 8 lettre à son fils RABELAIS.
- Commentaire composé d'un passage du chapitre XXXII du Pantagruel de Rabelais : « Ce pendent, je, qui vous fais ces tant véritables contes […] parce qu'ilz demourent en la gorge de mon maistre Pantagruel »
- Lecture analytique d'un extrait de la « Lettre de Gargantua à son fils Pantagruel », chapitre VIII de Pantagruel (1532) de François Rabelais. Etude à partir de « Et quant à la connaissance » à « mais la parole de Dieu demeure éternellement »































