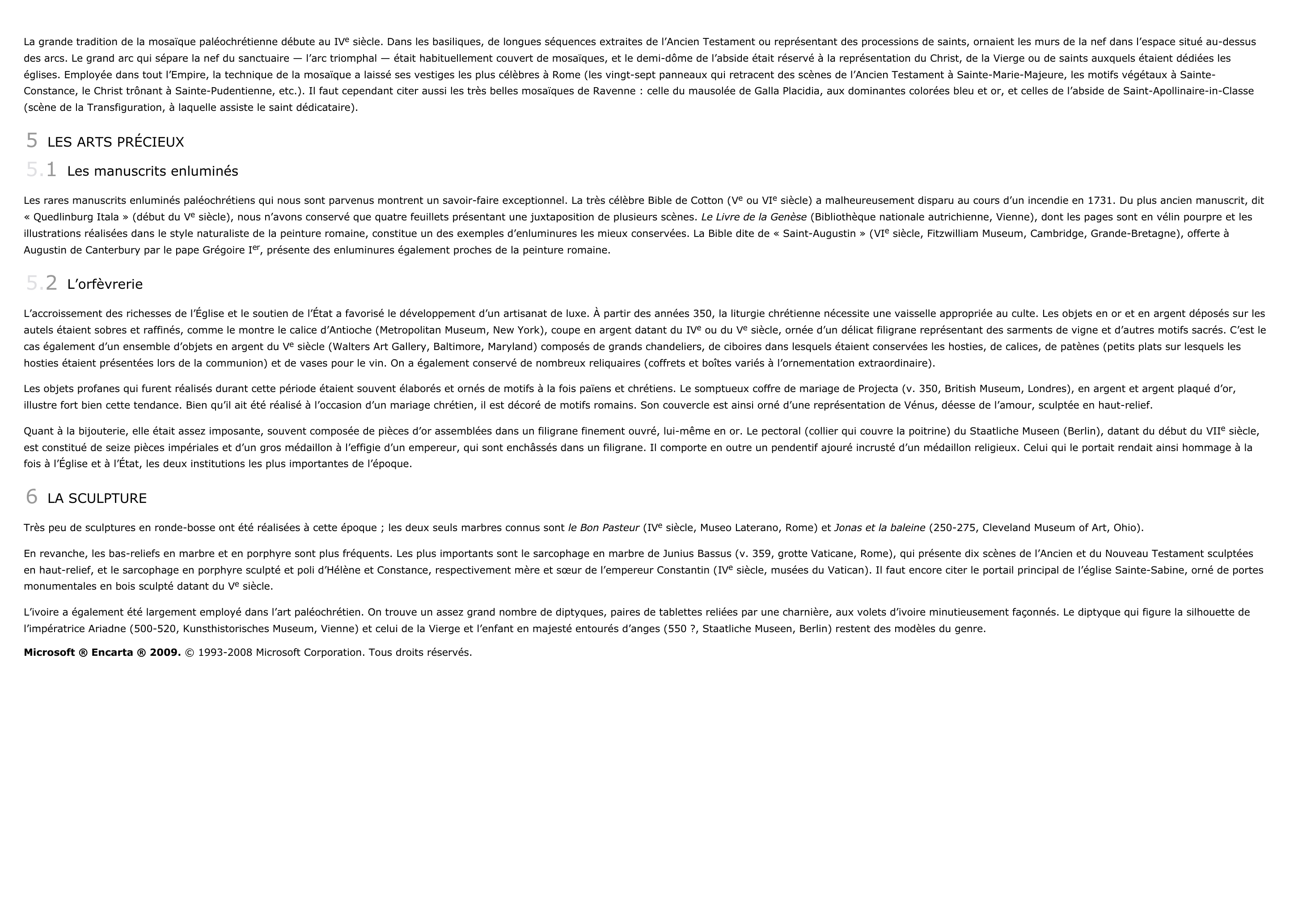paléochrétien, art - sculpture.
Publié le 15/05/2013
Extrait du document
«
La grande tradition de la mosaïque paléochrétienne débute au IVe siècle.
Dans les basiliques, de longues séquences extraites de l’Ancien Testament ou représentant des processions de saints, ornaient les murs de la nef dans l’espace situé au-dessus
des arcs.
Le grand arc qui sépare la nef du sanctuaire — l’arc triomphal — était habituellement couvert de mosaïques, et le demi-dôme de l’abside était réservé à la représentation du Christ, de la Vierge ou de saints auxquels étaient dédiées les
églises.
Employée dans tout l’Empire, la technique de la mosaïque a laissé ses vestiges les plus célèbres à Rome (les vingt-sept panneaux qui retracent des scènes de l’Ancien Testament à Sainte-Marie-Majeure, les motifs végétaux à Sainte-
Constance, le Christ trônant à Sainte-Pudentienne, etc.).
Il faut cependant citer aussi les très belles mosaïques de Ravenne : celle du mausolée de Galla Placidia, aux dominantes colorées bleu et or, et celles de l’abside de Saint-Apollinaire-in-Classe
(scène de la Transfiguration, à laquelle assiste le saint dédicataire).
5 LES ARTS PRÉCIEUX
5. 1 Les manuscrits enluminés
Les rares manuscrits enluminés paléochrétiens qui nous sont parvenus montrent un savoir-faire exceptionnel.
La très célèbre Bible de Cotton ( Ve ou VIe siècle) a malheureusement disparu au cours d’un incendie en 1731.
Du plus ancien manuscrit, dit
« Quedlinburg Itala » (début du Ve siècle), nous n’avons conservé que quatre feuillets présentant une juxtaposition de plusieurs scènes.
Le Livre de la Genèse (Bibliothèque nationale autrichienne, Vienne), dont les pages sont en vélin pourpre et les
illustrations réalisées dans le style naturaliste de la peinture romaine, constitue un des exemples d’enluminures les mieux conservées.
La Bible dite de « Saint-Augustin » ( VIe siècle, Fitzwilliam Museum, Cambridge, Grande-Bretagne), offerte à
Augustin de Canterbury par le pape Grégoire I er, présente des enluminures également proches de la peinture romaine.
5. 2 L’orfèvrerie
L’accroissement des richesses de l’Église et le soutien de l’État a favorisé le développement d’un artisanat de luxe.
À partir des années 350, la liturgie chrétienne nécessite une vaisselle appropriée au culte.
Les objets en or et en argent déposés sur les
autels étaient sobres et raffinés, comme le montre le calice d’Antioche (Metropolitan Museum, New York), coupe en argent datant du IVe ou du Ve siècle, ornée d’un délicat filigrane représentant des sarments de vigne et d’autres motifs sacrés.
C’est le
cas également d’un ensemble d’objets en argent du Ve siècle (Walters Art Gallery, Baltimore, Maryland) composés de grands chandeliers, de ciboires dans lesquels étaient conservées les hosties, de calices, de patènes (petits plats sur lesquels les
hosties étaient présentées lors de la communion) et de vases pour le vin.
On a également conservé de nombreux reliquaires (coffrets et boîtes variés à l’ornementation extraordinaire).
Les objets profanes qui furent réalisés durant cette période étaient souvent élaborés et ornés de motifs à la fois païens et chrétiens.
Le somptueux coffre de mariage de Projecta (v.
350, British Museum, Londres), en argent et argent plaqué d’or,
illustre fort bien cette tendance.
Bien qu’il ait été réalisé à l’occasion d’un mariage chrétien, il est décoré de motifs romains.
Son couvercle est ainsi orné d’une représentation de Vénus, déesse de l’amour, sculptée en haut-relief.
Quant à la bijouterie, elle était assez imposante, souvent composée de pièces d’or assemblées dans un filigrane finement ouvré, lui-même en or.
Le pectoral (collier qui couvre la poitrine) du Staatliche Museen (Berlin), datant du début du VII e siècle,
est constitué de seize pièces impériales et d’un gros médaillon à l’effigie d’un empereur, qui sont enchâssés dans un filigrane.
Il comporte en outre un pendentif ajouré incrusté d’un médaillon religieux.
Celui qui le portait rendait ainsi hommage à la
fois à l’Église et à l’État, les deux institutions les plus importantes de l’époque.
6 LA SCULPTURE
Très peu de sculptures en ronde-bosse ont été réalisées à cette époque ; les deux seuls marbres connus sont le Bon Pasteur (IVe siècle, Museo Laterano, Rome) et Jonas et la baleine (250-275, Cleveland Museum of Art, Ohio).
En revanche, les bas-reliefs en marbre et en porphyre sont plus fréquents.
Les plus importants sont le sarcophage en marbre de Junius Bassus (v.
359, grotte Vaticane, Rome), qui présente dix scènes de l’Ancien et du Nouveau Testament sculptées
en haut-relief, et le sarcophage en porphyre sculpté et poli d’Hélène et Constance, respectivement mère et sœur de l’empereur Constantin ( IVe siècle, musées du Vatican).
Il faut encore citer le portail principal de l’église Sainte-Sabine, orné de portes
monumentales en bois sculpté datant du Ve siècle.
L’ivoire a également été largement employé dans l’art paléochrétien.
On trouve un assez grand nombre de diptyques, paires de tablettes reliées par une charnière, aux volets d’ivoire minutieusement façonnés.
Le diptyque qui figure la silhouette de
l’impératrice Ariadne (500-520, Kunsthistorisches Museum, Vienne) et celui de la Vierge et l’enfant en majesté entourés d’anges (550 ?, Staatliche Museen, Berlin) restent des modèles du genre.
Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation.
Tous droits réservés..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La sculpture copte, un art original
- La sculpture moderne (Exposé – Art & Littérature – Collège/Lycée)
- La sculpture copte, un art original
- L'art néolithique : A L'ORIGINE DE LA PEINTURE ET DE LA SCULPTURE
- l'art de la sculpture