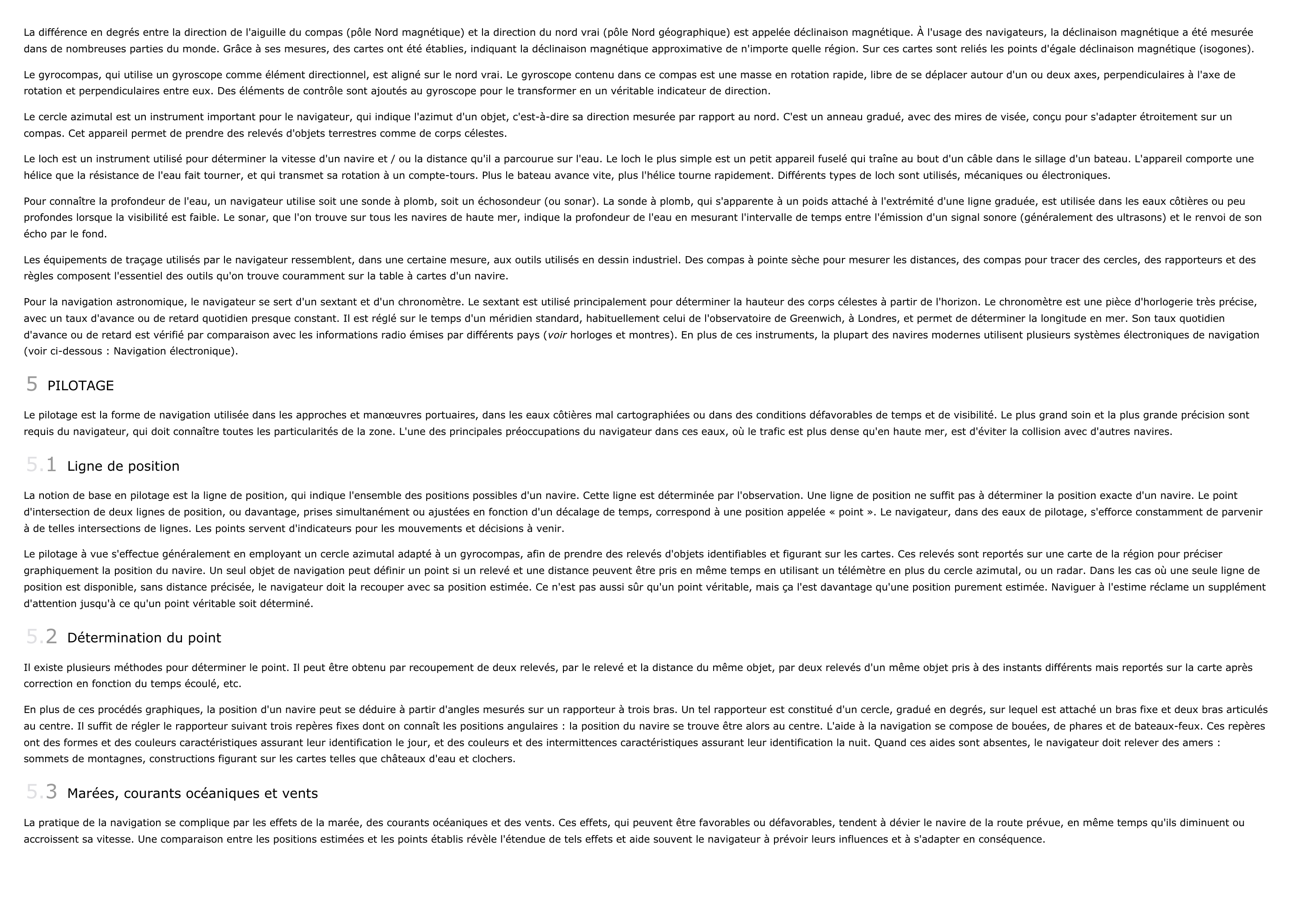navigation.
Publié le 26/04/2013
Extrait du document
«
La différence en degrés entre la direction de l'aiguille du compas (pôle Nord magnétique) et la direction du nord vrai (pôle Nord géographique) est appelée déclinaison magnétique.
À l'usage des navigateurs, la déclinaison magnétique a été mesurée
dans de nombreuses parties du monde.
Grâce à ses mesures, des cartes ont été établies, indiquant la déclinaison magnétique approximative de n'importe quelle région.
Sur ces cartes sont reliés les points d'égale déclinaison magnétique (isogones).
Le gyrocompas, qui utilise un gyroscope comme élément directionnel, est aligné sur le nord vrai.
Le gyroscope contenu dans ce compas est une masse en rotation rapide, libre de se déplacer autour d'un ou deux axes, perpendiculaires à l'axe de
rotation et perpendiculaires entre eux.
Des éléments de contrôle sont ajoutés au gyroscope pour le transformer en un véritable indicateur de direction.
Le cercle azimutal est un instrument important pour le navigateur, qui indique l'azimut d'un objet, c'est-à-dire sa direction mesurée par rapport au nord.
C'est un anneau gradué, avec des mires de visée, conçu pour s'adapter étroitement sur un
compas.
Cet appareil permet de prendre des relevés d'objets terrestres comme de corps célestes.
Le loch est un instrument utilisé pour déterminer la vitesse d'un navire et / ou la distance qu'il a parcourue sur l'eau.
Le loch le plus simple est un petit appareil fuselé qui traîne au bout d'un câble dans le sillage d'un bateau.
L'appareil comporte une
hélice que la résistance de l'eau fait tourner, et qui transmet sa rotation à un compte-tours.
Plus le bateau avance vite, plus l'hélice tourne rapidement.
Différents types de loch sont utilisés, mécaniques ou électroniques.
Pour connaître la profondeur de l'eau, un navigateur utilise soit une sonde à plomb, soit un échosondeur (ou sonar).
La sonde à plomb, qui s'apparente à un poids attaché à l'extrémité d'une ligne graduée, est utilisée dans les eaux côtières ou peu
profondes lorsque la visibilité est faible.
Le sonar, que l'on trouve sur tous les navires de haute mer, indique la profondeur de l'eau en mesurant l'intervalle de temps entre l'émission d'un signal sonore (généralement des ultrasons) et le renvoi de son
écho par le fond.
Les équipements de traçage utilisés par le navigateur ressemblent, dans une certaine mesure, aux outils utilisés en dessin industriel.
Des compas à pointe sèche pour mesurer les distances, des compas pour tracer des cercles, des rapporteurs et des
règles composent l'essentiel des outils qu'on trouve couramment sur la table à cartes d'un navire.
Pour la navigation astronomique, le navigateur se sert d'un sextant et d'un chronomètre.
Le sextant est utilisé principalement pour déterminer la hauteur des corps célestes à partir de l'horizon.
Le chronomètre est une pièce d'horlogerie très précise,
avec un taux d'avance ou de retard quotidien presque constant.
Il est réglé sur le temps d'un méridien standard, habituellement celui de l'observatoire de Greenwich, à Londres, et permet de déterminer la longitude en mer.
Son taux quotidien
d'avance ou de retard est vérifié par comparaison avec les informations radio émises par différents pays ( voir horloges et montres).
En plus de ces instruments, la plupart des navires modernes utilisent plusieurs systèmes électroniques de navigation
(voir ci-dessous : Navigation électronique).
5 PILOTAGE
Le pilotage est la forme de navigation utilisée dans les approches et manœuvres portuaires, dans les eaux côtières mal cartographiées ou dans des conditions défavorables de temps et de visibilité.
Le plus grand soin et la plus grande précision sont
requis du navigateur, qui doit connaître toutes les particularités de la zone.
L'une des principales préoccupations du navigateur dans ces eaux, où le trafic est plus dense qu'en haute mer, est d'éviter la collision avec d'autres navires.
5. 1 Ligne de position
La notion de base en pilotage est la ligne de position, qui indique l'ensemble des positions possibles d'un navire.
Cette ligne est déterminée par l'observation.
Une ligne de position ne suffit pas à déterminer la position exacte d'un navire.
Le point
d'intersection de deux lignes de position, ou davantage, prises simultanément ou ajustées en fonction d'un décalage de temps, correspond à une position appelée « point ».
Le navigateur, dans des eaux de pilotage, s'efforce constamment de parvenir
à de telles intersections de lignes.
Les points servent d'indicateurs pour les mouvements et décisions à venir.
Le pilotage à vue s'effectue généralement en employant un cercle azimutal adapté à un gyrocompas, afin de prendre des relevés d'objets identifiables et figurant sur les cartes.
Ces relevés sont reportés sur une carte de la région pour préciser
graphiquement la position du navire.
Un seul objet de navigation peut définir un point si un relevé et une distance peuvent être pris en même temps en utilisant un télémètre en plus du cercle azimutal, ou un radar.
Dans les cas où une seule ligne de
position est disponible, sans distance précisée, le navigateur doit la recouper avec sa position estimée.
Ce n'est pas aussi sûr qu'un point véritable, mais ça l'est davantage qu'une position purement estimée.
Naviguer à l'estime réclame un supplément
d'attention jusqu'à ce qu'un point véritable soit déterminé.
5. 2 Détermination du point
Il existe plusieurs méthodes pour déterminer le point.
Il peut être obtenu par recoupement de deux relevés, par le relevé et la distance du même objet, par deux relevés d'un même objet pris à des instants différents mais reportés sur la carte après
correction en fonction du temps écoulé, etc.
En plus de ces procédés graphiques, la position d'un navire peut se déduire à partir d'angles mesurés sur un rapporteur à trois bras.
Un tel rapporteur est constitué d'un cercle, gradué en degrés, sur lequel est attaché un bras fixe et deux bras articulés
au centre.
Il suffit de régler le rapporteur suivant trois repères fixes dont on connaît les positions angulaires : la position du navire se trouve être alors au centre.
L'aide à la navigation se compose de bouées, de phares et de bateaux-feux.
Ces repères
ont des formes et des couleurs caractéristiques assurant leur identification le jour, et des couleurs et des intermittences caractéristiques assurant leur identification la nuit.
Quand ces aides sont absentes, le navigateur doit relever des amers :
sommets de montagnes, constructions figurant sur les cartes telles que châteaux d'eau et clochers.
5. 3 Marées, courants océaniques et vents
La pratique de la navigation se complique par les effets de la marée, des courants océaniques et des vents.
Ces effets, qui peuvent être favorables ou défavorables, tendent à dévier le navire de la route prévue, en même temps qu'ils diminuent ou
accroissent sa vitesse.
Une comparaison entre les positions estimées et les points établis révèle l'étendue de tels effets et aide souvent le navigateur à prévoir leurs influences et à s'adapter en conséquence..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Comment l’astronomie, la navigation et le calcul bancaire sont-ils à l’origine de l’invention des logarithmes ?
- CARTE DE LA NAVIGATION PITTORESQUE (La) (résumé & analyse)
- NAVIGATION NOCTURNE Rafael Maya (résumé et analyse)
- NAVIGATION DE SAINT BRANDAN (La )
- Liée à l'essor des civilisations en même temps qu'aux progrès scientifiques et techniques, la navigation à voile connut son âge d'or au XIXe siècle, avec les fameux clippers de la marine de commerce britannique.