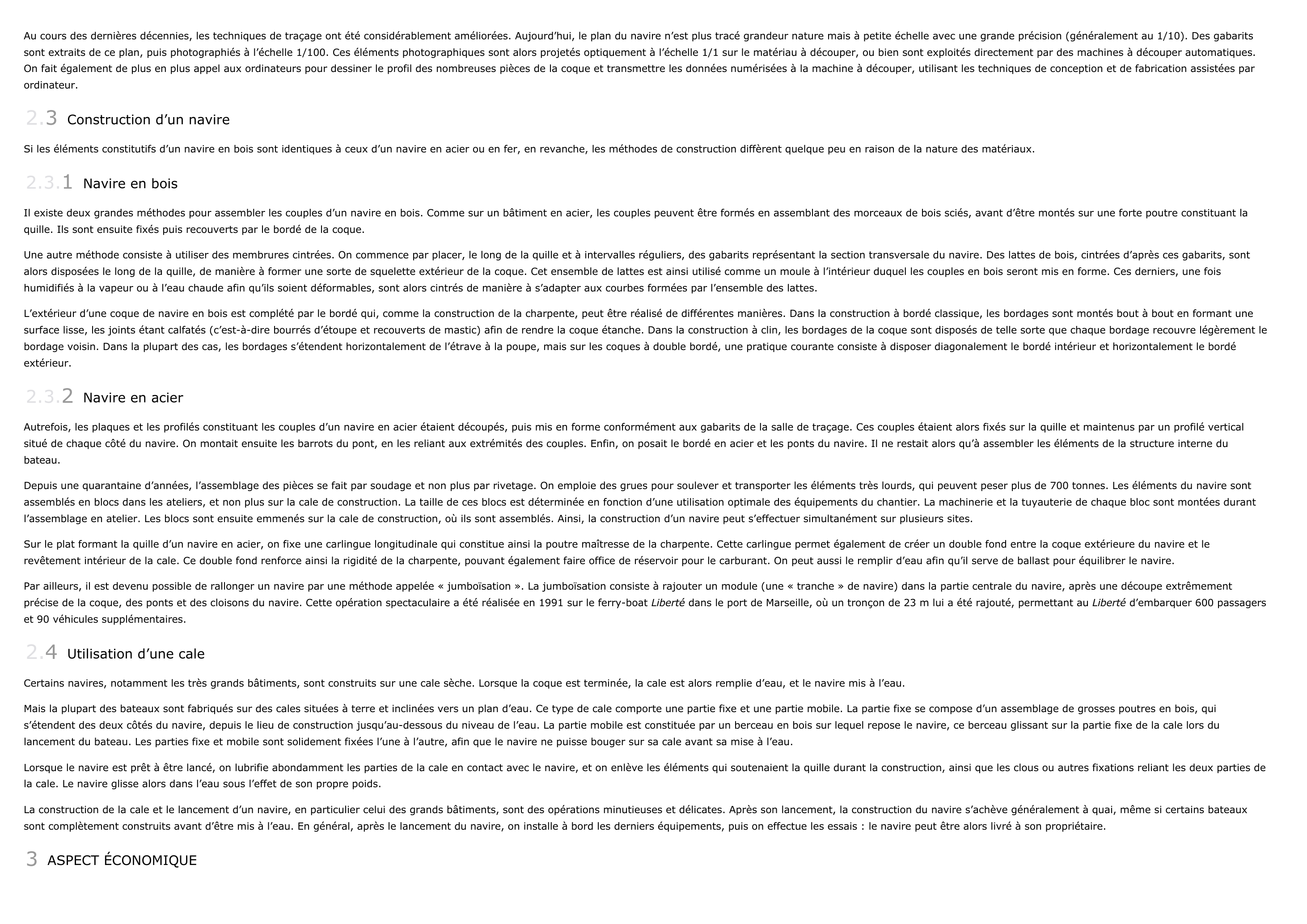navale, construction.
Publié le 26/04/2013
Extrait du document
«
Au cours des dernières décennies, les techniques de traçage ont été considérablement améliorées.
Aujourd’hui, le plan du navire n’est plus tracé grandeur nature mais à petite échelle avec une grande précision (généralement au 1/10).
Des gabarits
sont extraits de ce plan, puis photographiés à l’échelle 1/100.
Ces éléments photographiques sont alors projetés optiquement à l’échelle 1/1 sur le matériau à découper, ou bien sont exploités directement par des machines à découper automatiques.
On fait également de plus en plus appel aux ordinateurs pour dessiner le profil des nombreuses pièces de la coque et transmettre les données numérisées à la machine à découper, utilisant les techniques de conception et de fabrication assistées par
ordinateur.
2. 3 Construction d’un navire
Si les éléments constitutifs d’un navire en bois sont identiques à ceux d’un navire en acier ou en fer, en revanche, les méthodes de construction diffèrent quelque peu en raison de la nature des matériaux.
2.3. 1 Navire en bois
Il existe deux grandes méthodes pour assembler les couples d’un navire en bois.
Comme sur un bâtiment en acier, les couples peuvent être formés en assemblant des morceaux de bois sciés, avant d’être montés sur une forte poutre constituant la
quille.
Ils sont ensuite fixés puis recouverts par le bordé de la coque.
Une autre méthode consiste à utiliser des membrures cintrées.
On commence par placer, le long de la quille et à intervalles réguliers, des gabarits représentant la section transversale du navire.
Des lattes de bois, cintrées d’après ces gabarits, sont
alors disposées le long de la quille, de manière à former une sorte de squelette extérieur de la coque.
Cet ensemble de lattes est ainsi utilisé comme un moule à l’intérieur duquel les couples en bois seront mis en forme.
Ces derniers, une fois
humidifiés à la vapeur ou à l’eau chaude afin qu’ils soient déformables, sont alors cintrés de manière à s’adapter aux courbes formées par l’ensemble des lattes.
L’extérieur d’une coque de navire en bois est complété par le bordé qui, comme la construction de la charpente, peut être réalisé de différentes manières.
Dans la construction à bordé classique, les bordages sont montés bout à bout en formant une
surface lisse, les joints étant calfatés (c’est-à-dire bourrés d’étoupe et recouverts de mastic) afin de rendre la coque étanche.
Dans la construction à clin, les bordages de la coque sont disposés de telle sorte que chaque bordage recouvre légèrement le
bordage voisin.
Dans la plupart des cas, les bordages s’étendent horizontalement de l’étrave à la poupe, mais sur les coques à double bordé, une pratique courante consiste à disposer diagonalement le bordé intérieur et horizontalement le bordé
extérieur.
2.3. 2 Navire en acier
Autrefois, les plaques et les profilés constituant les couples d’un navire en acier étaient découpés, puis mis en forme conformément aux gabarits de la salle de traçage.
Ces couples étaient alors fixés sur la quille et maintenus par un profilé vertical
situé de chaque côté du navire.
On montait ensuite les barrots du pont, en les reliant aux extrémités des couples.
Enfin, on posait le bordé en acier et les ponts du navire.
Il ne restait alors qu’à assembler les éléments de la structure interne du
bateau.
Depuis une quarantaine d’années, l’assemblage des pièces se fait par soudage et non plus par rivetage.
On emploie des grues pour soulever et transporter les éléments très lourds, qui peuvent peser plus de 700 tonnes.
Les éléments du navire sont
assemblés en blocs dans les ateliers, et non plus sur la cale de construction.
La taille de ces blocs est déterminée en fonction d’une utilisation optimale des équipements du chantier.
La machinerie et la tuyauterie de chaque bloc sont montées durant
l’assemblage en atelier.
Les blocs sont ensuite emmenés sur la cale de construction, où ils sont assemblés.
Ainsi, la construction d’un navire peut s’effectuer simultanément sur plusieurs sites.
Sur le plat formant la quille d’un navire en acier, on fixe une carlingue longitudinale qui constitue ainsi la poutre maîtresse de la charpente.
Cette carlingue permet également de créer un double fond entre la coque extérieure du navire et le
revêtement intérieur de la cale.
Ce double fond renforce ainsi la rigidité de la charpente, pouvant également faire office de réservoir pour le carburant.
On peut aussi le remplir d’eau afin qu’il serve de ballast pour équilibrer le navire.
Par ailleurs, il est devenu possible de rallonger un navire par une méthode appelée « jumboïsation ».
La jumboïsation consiste à rajouter un module (une « tranche » de navire) dans la partie centrale du navire, après une découpe extrêmement
précise de la coque, des ponts et des cloisons du navire.
Cette opération spectaculaire a été réalisée en 1991 sur le ferry-boat Liberté dans le port de Marseille, où un tronçon de 23 m lui a été rajouté, permettant au Liberté d’embarquer 600 passagers
et 90 véhicules supplémentaires.
2. 4 Utilisation d’une cale
Certains navires, notamment les très grands bâtiments, sont construits sur une cale sèche.
Lorsque la coque est terminée, la cale est alors remplie d’eau, et le navire mis à l’eau.
Mais la plupart des bateaux sont fabriqués sur des cales situées à terre et inclinées vers un plan d’eau.
Ce type de cale comporte une partie fixe et une partie mobile.
La partie fixe se compose d’un assemblage de grosses poutres en bois, qui
s’étendent des deux côtés du navire, depuis le lieu de construction jusqu’au-dessous du niveau de l’eau.
La partie mobile est constituée par un berceau en bois sur lequel repose le navire, ce berceau glissant sur la partie fixe de la cale lors du
lancement du bateau.
Les parties fixe et mobile sont solidement fixées l’une à l’autre, afin que le navire ne puisse bouger sur sa cale avant sa mise à l’eau.
Lorsque le navire est prêt à être lancé, on lubrifie abondamment les parties de la cale en contact avec le navire, et on enlève les éléments qui soutenaient la quille durant la construction, ainsi que les clous ou autres fixations reliant les deux parties de
la cale.
Le navire glisse alors dans l’eau sous l’effet de son propre poids.
La construction de la cale et le lancement d’un navire, en particulier celui des grands bâtiments, sont des opérations minutieuses et délicates.
Après son lancement, la construction du navire s’achève généralement à quai, même si certains bateaux
sont complètement construits avant d’être mis à l’eau.
En général, après le lancement du navire, on installe à bord les derniers équipements, puis on effectue les essais : le navire peut être alors livré à son propriétaire.
3 ASPECT ÉCONOMIQUE.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Construction navale au Canada (histoire de la seconde guerre mondiale).
- Construction navale au Canada
- L'EUROPE DE L'OUEST EN CONSTRUCTION JUSQU'A LA FIN DES ANNÉES 1980
- En quoi la littérature et le cinéma participent-ils à la construction de la mémoire de la Shoah ? (exemple du journal d'Hélène Berr)
- La construction de la personnalité