Manon Lescaut, Une Tragédie ?
Publié le 16/10/2010
Extrait du document
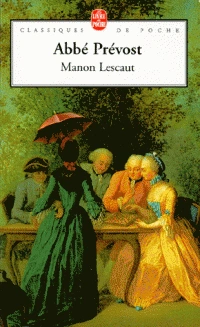
I. Manon Lescaut peut être considérée comme une tragédie classique
1. Des personnages tragiques prit dans une crise amoureuse passionnelle
* Aspect théâtral
Entrées en scène (l’archer puis la vieille femme p. 30-31) // de nombreux dialogues au discours direct
1. Le caractère théâtral de Manon Lescaut : Les scènes puis les caractères ; les comportements excessifs, hypocrites (ethymologie), les talents d’acteur de des Grieux.
De nombreux dialogues (paroles + gestes) ; des scènes (entrées en scène et sorties de personnages) ; un nombre restreint de personnages ; une intrigue centrale ; des personnages types mais pas seulement (+ des adjuvants et opposants) ; un message à faire passer au spectateur ; un grand nombre de décors (la maison familiale, l’appartement à Paris, celui de Chaillot, l’hôtellerie de Chaillot, les prisons de St-Lazare et du Châtelet, La Salpêtrière, l’Amérique (village puis désert), la maison de GMfils, les différents et nombreux lieux de voyages durant les transports/changements de villégiatures, etc … ; peinture de la réalité (Instruire le public (« l’auteur vise une finalité morale «), en le divertissant (instruire en amusant !) : plaisir pris à l’émotion
* Structure et style Excès du langage tragique
Structure : Eventuelle composition en cinq actes : quatre premiers = montrant les ravages de la passion ; le dernier = la sanction salutaire (Manon punie par la mort, DG par la solitude après la mort de sa bien-aimée). La « justice du Ciel « l’emporte sur l’obstination des réfractaires et ne se satisfait de leur tardif repentir => Un enseignement !
Comme ces tragédies raciniennes que Prévost se désignaient comme modèles, son roman est bien composé : pas de division en chapitres : donner l’impression d’un récit unique, un bloc. Texte divisé en deux parties de longueur inégale, pause justifiée par la fatigue du narrateur mais =/ une rupture dans la chaîne des épisodes car l’arrêt est très court. Les péripéties des héros ne sont pas monotones grâce aux brutaux et nombreux renversements de situation. Le bonheur des deux héros est éphémère et toujours menacé, l’aboutissement est une séparation définitive, l’intrigue, comme leur destin, est une ligne irrégulière. Désordre : roman picaresque, en ce sens adapté au goût du public de la régence (aventures extraordinaires ou sanglantes, mouvement/imprévu)
Les divers épisodes : durées inégales, récit en accélérations et coups de frein.
Style qui reste sobre, dépouillé, précis : il vise au naturel. Classique par sa discrétion, la densité et la pudeur des moyens d’expression (pas de détails inutiles). AP « Mon style je le verrais coulant, simple, expressif « ; phrases sont brèves, peu chargées de mots, toujours précises et pleines de naturel = il n’y a pas dans la phrase des éléments qui donneraient une image trop crue de la réalité = pudeur bien classique. AP use de la litote (=Racine) : « Je m’aperçus qu’on ne l’avait point désespérée par un excès de rigueur « = laideurs et horreurs effacées : arrestation pour délit de droit commun devient « une disgrâce «, débauche devient « un désordre «, meurtre « une affaire « = bienséance dans le langage toujours ! Sinon, style : aisance et tenue ML : récit ; vérité des sentiments, précision des détails vécus et sobriété du pathétique. Pas de débordement de sensibilité (hum !) : l’analyse empreinte d’une réserve et d’une lucidité toute classiques. Parfaite limpidité de la prose : rythme contribue à traduire l’émotion du héros.
Langage racinien = si noble, harmonieux, sobre traduit avec efficacité inégalable la violence des sentiments ; langue pauvre (vocabulaire très restreint mais effets étonnant : importance de chaque mot, chaque silence, etc…
Excès du langage tragique : Mais dans les scènes fortes, après une trahison, une catastrophe, le chevalier exprime toute sa souffrance, le vocabulaire change de registre ; devient tragique, excessif (hyperboles) quand il est hors de lui : ses propos pleins de menaces délirantes (a lescaut qui l’a trompé : « Traître, c’est fait de ta vie « + veut tuer B et Manon plus brûler) excessif dans son amour et dans sa haine (jalousie) : « perfide Manon ! « « ingrate et parjure maîtresse «
Rythme travaillé de la prose exprime l’émotion des personnages
Ex : Scène de la rencontre p. 36 : accélération, rythme saccadé et binaire = émotions de Des Grieux rythme de plus en plus ample // vocabulaire excessif de la passion : Grieux est « transport[é] «.
Ex : Euphémisme : p. 36 : « je lui parlais d’une telle manière « = façon pour le narrateur de garder son intimité et sa dignité face à son locuteur.
On retrouve par ailleurs dans les discours emportés du chevalier le langage excessif de la tragédie (passion !)
* Un héros face au dilemme cornélien
Le drame qui déchire Des Grieux puis Manon = le classique conflit entre l’instinct amoureux (les passions) et les différentes formes de devoirs. Héros en proie à un dilemne cornélien : la famille et la femme aimée ? L’honneur ou l’amour ??
* Le rôle central de la passion dans un amour plus fort que tout jalousie
Corneille : l’amour est une passion « chargée de faiblesse « =/ Ses chefs-d’œuvre mais = DG
Pas de description extérieure des personnages ou tant que ça des lieux : AP (comme Racine) néglige l’extérieure et se préoccupe surtout des âmes. Ce sont les caractères qui sont étudiés. L’essentiel est l’étude des âmes.
Dans la tragédie classique, à la différence du drame romantique, on ne trouve pas de confusion entre action et spectacle ; ns ne vibrons pas au spectacle d’évènements extérieurs, mais devant leur répercussion dans l’âme des personnages « = Manon Lescaut
Œuvre dont le but reste classique : la passion y est analysée : but = constater lucidemment son pouvoir redoutable et ses ravages sur une âme faible.
Ni la foi, ni la raison, ni le respect ne parviennent à venir à bout de cette passion : les discours moralisateurs ne parviennent pas à leur but et ne sont pas écoutés (résultat inverse même, discours de Des Grieux p. 97).
Tragédie racinienne : tragédie de « famille « : « met aux prises « des parents, des alliés, des intimes = ML ; « Les passions qui fermentent ainsi en vase clos sont portées à leur paroxysme « ; l’atmosphère peut devenir presque irrespirable.
La passion : dans la tragédie racinienne, l’amour est la passion tragique par excellence. Lorsque des personnes sont victimes et aveuglés par cette passion, et encore plus sous l’effet de la jalousie, elles sont poussées à des actions insensées qui peuvent être criminelles. Des Grieux, lorsqu’il apprend que Manon lui est infidèle, dans un accès de rage et de désespoir, est prêt à « brûler vifs « la maîtresse infidèle et son amant. La jalousie liée à son amour passionné pour Manon éveille en lui des pulsions de mort lorsqu’il apprend que sa maîtresse ne lui appartient pas. L’amour est irrésistible. Fureur jalouse : « la jalousie rend le héros impitoyable pour son rival et pour l’être aimé comme pour lui-même. Il veut faire souffrir autant qu’il souffre «
La raison et la volonté ne peuvent rien contre l’amour qui éclate en coup de foudre = ML ce que Des Grieux ressent la première fois qu’il voit Manon (charmante, l’effet qu’elle fait sur le chevalier est immédiat) = Phèdre vs Hippolyte première rencontre : « Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue ; / Un trouble s’éleva dans mon âme éperdue ; / Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler ; / Je sentis tout mon corps et transir et brûler «. S’oppose cependant à des G. dont la passion déchaîne l’éloquence scolastique et qui se retrouve à parler d’amour avec une parfaite inconnue, lui si sage, timide et réservé. La passion le transforme. Naissance de l’amour chez Corneille : inclination mystérieuse, un « charme « au sens plein du mot (= Manon, « charmante « = séduisante, irrésistible). Il n’y a pas de devoir qui soit en mesure de résister à la passion : Roxane, Phèdre et Néron oublient la fidélité conjugale, Oreste trahit ses devoirs d’ambassadeur. DG, quant à lui, habite avec une jeune femme sans l’avoir épousée et abandonne ses devoirs de bon fils et d’étudiant brillant -> L’amour passionnée plus fort que la raison. Impuissance de DG à triompher de la passion : n’est pas sans rappeler les héros raciniens : Combattre la passion serait tenter de changer la nature = impossible. On peut éventuellement voir dans ML une oeuvre d’inspiration janséniste : la Providence interviendrait dans l’action puis des Grieux condamné à demeurer toujours insatisfait. Passion dévorante et dévastatrice : dans la tragédie racinienne, on tue et on meurt par amour. Les héros raciniens : êtres faibles en proie à des passions violentes : ni volonté, ni énergie morale. Jouet de leur passion et n’agissent que sous son impulsion tyrannique : alors prêt à tout (tous les crimes notamment), impuissant à dominer leurs sentiments = Des Grieux ! Centrée sur une histoire d’amour qui finit tragiquement (mort de l’héroïne et un
* Un héros marginalisé mais toutefois lucide
Ex : « C’est l’amour, vous le savez, qui a causé toutes mes fautes « (p. 157-160).
Un héros rendu marginal par sa passion : sa passion isole le héros de la société, il brave pour elle lois et principes moraux : pour elle, il triche, vole, tut, sombre dans le vice.
A la manière des personnages classiques, le protagoniste analyse ses « crises de conscience « : soit dans des monologues intérieurs, soit au cours des conversations avec les représentants de l’ordre social et religieux (discours moralisateurs de Tiberge et du père ??)
Lucidité de DG : envoûté mais lucide malgré tout, il se rend parfaitement compte des périls que lui fait courir son amour + sait qu’il joue un personnage d’hypocrite et vicieux (« Quoiqu’à mes propres yeux, cette action fût une véritable friponnerie, ce n’était pas la plus injuste que je crusse avoir à me reprocher « = a conscience des fautes qu’il accepte de commettre et juge ses actes à leur juste valeur ; « Je vais perdre … je le vois bien… « p. 65 « même lorsqu’il se révolte contre la fortune, le héros racinien sent bien qu’il est l’artisan de son propre malheur « = lucidité de DG. Lucidité et aveuglement : héros de Racine aveuglés par leur passion. « La lucidité avec laquelle ils s’analysent n’a pas de prise sur leur conduite : ne leur permet pas de trouver une solution et bien au contraire ne fait qu’accroître leurs souffrances, leur désarroi et le sentiment de leur responsabilité, alors que la passion leur ôte toute liberté = leur volonté ne peut s’exercer mais parfaitement conscient de ce qu’ils font (DG ?). Entre cette lucidité et cet aveuglement, la tension est telle que la seule issue est la mort ou la folie (Oreste).
2. Des héros soumis à la fatalité de leur histoire
* Fatalité dès la première scène : coup de foudre
Ex : amour fatal = avis de Manon et Grieux (différents) sur le destin p. 36
La fatalité : fatalité incarnée par Manon ( ?) peinture de la passion excessive, invincible. Manon n’incarne pas l’amour tragique => l’élu et le maudit de la passion c’est DG dès la première rencontre : passion impétueuse qui l’envahit. Coup de foudre ! ne réfléchit pas aux conséquences de son acte : il rompt avec sa famille, son passé et ses principes. Couple fatal pris dans un engrenage qui l’entraîne à sa perte. L’amour engendre à la fois le mal et le malheur, fait d’une aventure sentimentale une tragédie qui s’achève dans les larmes et le sang. Les coupables sont châtiés au moment même où ils reviennent à la vertu. Un des personnages meurt. Mais avant cela il y a une progression, des Grieux court à sa perte et le lecteur suit cette descente dans le vice et la malheur avec effroi parce qu’il sait les conséquences terribles de la passion de des Grieux pour Manon (grâce aux fréquentes prolepses faites par le narrateur). La fin digne d’une tragédie classique (mort de l’un, « suicide « de l’autre) et Manon qui meurt pour ne pas avoir à quitter son amant = de catin devient une héroïne pitoyable
* Une issue tragique
Centrée sur une histoire d’amour qui finit tragiquement (mort de l’héroïne et un héros « perdu « [de réputation + plus envie de vivre, pas de but) « Issue sanglante de la crise car la fatalité des passions conduit les personnages à leur perte « (Racine !!).
* Progression de dramatique de Des Grieux : vers le vice pour préserver Manon.
La passion le pousse au vice pour préserver son amour.
Lucidité de DG : envoûté mais lucide malgré tout, il se rend parfaitement compte des périls que lui fait courir son amour + sait qu’il joue un personnage d’hypocrite et vicieux (« Quoiqu’à mes propres yeux, cette action fût une véritable friponnerie, ce n’était pas la plus injuste que je crusse avoir à me reprocher « = a conscience des fautes qu’il accepte de commettre et juge ses actes à leur juste valeur ; « Je vais perdre … je le vois bien… « p. 65 « même lorsqu’il se révolte contre la fortune, le héros racinien sent bien qu’il est l’artisan de son propre malheur « = lucidité de DG. Lucidité et aveuglement : héros de Racine aveuglés par leur passion. « La lucidité avec laquelle ils s’analysent n’a pas de prise sur leur conduite : ne leur permet pas de trouver une solution et bien au contraire ne fait qu’accroître leurs souffrances, leur désarroi et le sentiment de leur responsabilité, alors que la passion leur ôte toute liberté = leur volonté ne peut s’exercer mais parfaitement conscient de ce qu’ils font (DG ?). Entre cette lucidité et cet aveuglement, la tension est telle que la seule issue est la mort ou la folie (oreste).
Même les analyses du héros lors de ses crises de conscience ne servent à rien.
* Les discours moralisateurs ne sont pas non plus écoutés. Ni foi ni raison ni respect ne viennent à bout de cette passion = de cette fatalité.
Pessimisme janséniste de Racine : ne croît pas en l’homme : dès l’instant où la passion envahit un être celui-ci est perdu. L’amour qui charme les cœurs est en réalité un fléau ; « il ne laisse à ses victimes aucun répit, aucune liberté, aucun refuge, si ce n’est dans la mort -> Misère de la condition humaine + homme qui a besoin de la providence : s’il est abandonné par Dieu, l’homme ne peut rien, par ses propres forces, pour sauver son âme ; tragédies bibliques (=/ chrétiennes comme Corneille) son Dieu est le Dieu vengeur plutôt que le Dieu qui pardonne «
Ex : Discours de Grieux à Tiberge p. 98 : « Dieu me pardonne, reprit Tiberge, je pense que voici encore un de nos jansénistes «
Ex : Grieux court à sa perte car il n’écoute pas = tragique des avertissements pouvant changer son chemin = p. 74-75 (Le discours moralisateur de Tiberge)
3. Un récit voué à la catharsis
* La catharsis de l’auteur qui s’est sans doute grandement inspiré de sa propre vie.
* Susciter la crainte devant cette passion dévastatrice
Catharsis : passions peintes pour montrer « tout le désordre dont elles sont la cause « ; vice « peint partout avec des couleurs qui en font connaître et haïr la difformité « mais vices interessent tellement qu’ils plaisent par leur difformité ; un enseignement moral clair : « exemple terrible de la force des passions «. L’exemple de la mauvaise conduite des personnages peut être utile ; le romancier, reprenant la tradition racinienne, montre les excès de la passion pour en inspirer la crainte = roman édifiant, comporte donc une leçon de morale. « Exciter la terreur et la pitié par le spectacle des passions humaines et des catastrophes qui en sont la fatale conséquence « ; « Conflit des hommes entre eux mais surtout de l’homme avec lui-même et ses passions «. Par leur exemple + par la leçon qui peut être tirée de leur malheur, les deux amants servent à illuster le « problème moral « : la passion = pouvoir destructeur que la foi (religion !), la raison et le respect de soi doivent chercher à combattre.
* Inspirer la pitié pour le héros, victime de sa passion
Dans la tragédie (classique), la pitié que ressent le spectateur pour le personnage malheureux est causé par le sentiment d’horreur qu’inspire la situation terrible (cruelle) dans laquelle se trouve le personnage sur scène. Le spectateur se sent concerné, il compatit (« cumpatio « : littéralement « souffre avec «). Ce qui se passe sur la scène éveille, chez celui qui est le témoin de l’action qui se déroule sans pitié et dont l’issue est fatale et inévitable, de sentiments très forts. C’est parce qu’il s’est senti directement interpellé par l’action qu’il la suivie avec son cœur, qu’elle peut le toucher et donc le porter à réfléchir. C’est ce qui s’est passé sur la scène a été une sorte de contre-exemple pour le spectateur. Il a été le témoin d’une catastrophe et se sent ainsi mis en garde. Il pourra ensuite appliquer dans sa vie personnelle les leçons tirées de la tragédie vue au théâtre : les passions sont dangereuses. Elles mènent celui qui est animé par elles à sa perte, inévitablement. Il faut contrôler ses passions et rechercher un idéal de modération dans ses sentiments propres.
La vieille femme, notamment, fait une entrée en scène très théâtrale : « une vieille femme qui sortait de l’hôtellerie en joignant les mains, et criant que c’était une chose barbare, une chose qui faisait horreur et compassion «.
* Le spectateur/lecteur s’identifie aux personnages le pousse à expier ses passions en voyant d’autres le faire + le pousse à se contrôler et à se modérer. Grieux : un contre-exemple dans ses actes.
L’intensité du tragique s’accroît lorsque le spectateur s’identifie au personnage. Dans le cas de Manon Lescaut, cela était favorisé par le contexte socioculturel de l’époque. L’Abbé Prévost a publié ce roman dans la première partie du XVIIIème siècle, c’est-à-dire sous la Régence. C’est dans un contexte de relâchement des mœurs que ce roman a été lu pour la première fois. Il est donc aisé de s’imaginer que beaucoup de gens, ou en tout cas un plus grand nombre que si le roman était paru un siècle avant, ont pu se reconnaître dans les aventures libertines du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut.
Ex : Pitié = Scène de la découverte de G+M par Renoncout vieille femme
* Pour susciter la pitié, l’auteur montre le point culminant de l’histoire (p. 30-31).
Ex : Horreur = But = remuer le spectateur, pour ne pas qu’il enfreigne les règles de la société, faire peur pour faire revenir sur le droit chemin. (même scène p. 30-31)
+ ex p. 188 : « mon âme semble reculer d’horreur « : le narrateur juge son acte avec horreur, le lecteur doit faire de même.
CONCLUSION : AP : a donné à son oeuvre la profondeur psychologique, la valeur morale et la dignité d’un ouvrage classique.
Voltaire : « Je n’ai jamais parlé de L’Abbé Prévost que pour le plaindre d’avoir manqué de fortune. Si j’ai ajouté quelque chose sur ce que j’ai lu de lui, c’est apparemment que j’ai souhaité qu’il eût fait des tragédies, car il me paraît que la langue des passions est sa langue naturelle «.
II. Manon Lescaut ne peut pas être considérée comme une tragédie classique
Manon Lescaut =/ une tragédie classique, qu’il s’agisse de la forme ou du contenu
1. Les règles fondamentales non respectées
* Règle des trois unités
La règle des Trois unités n’est pas respectée : ni unité de temps, ni unité de lieux, règle de bienséance non respectée (des meurtres), « débordements de langage et d’imagination « non « canalisés «, style non noble, prose bien sûr, tellement de lieux que le public (le lecteur) s’émeut mais se perd également. =/ Bienséances : à St Lazare saute à la gorge de son ennemi qui se vante d’avoir fait incarcérer Manon. Bienséances : les personnages ne sont pas nobles ou illustres (des Grieux si mais non Manon et certains autres) : rois, reines, etc comme l’exigerait les bienséances de la tragédie classique : constamment empreinte de dignité, grandeur et même de noblesse (=/ des Grieux libertin, dépravé, vicieux et pathétique) + pas de mots crus ou trop familiers + dignité = ne pas tomber dans le mélodramatique ou le pathétique voire le grotesque : ce que peine à faire le récit de des Grieux ?? « Si violent que soit le conflit, la dignité extérieure est toujours sauvegardée « =/ DG ; pas de hurlements/ contorsions : « Si les héros raciniens ne peuvent maîtriser leurs passions, ils maîtrisent leur langage et leurs attitudes « = majesté tragique. Hermione décrivant Pyrrhus : « Charmant, fidèle enfin, rien ne manque à sa gloire « (III, 3) =/ Manon l’infidèle (charmante aussi !) =/ noble, glorieuse, héroïne tragique + sur le théâtre, contraire aux Bienséances de représenter combats, duels ou suicides. Sincérité de DG quand il exprime sa souffrance : une âme mise à nu (mais sensibilité démesurée : des cris, des larmes ; des insultes, des gestes désespérés, etc)
Unité d’action = une seule intrigue. L’attention ne se disperse pas : elle est concentrée sur un problème unique. L’unité d’action entraîne l’unité de ton : tout mélange des genres est exclus. Par ailleurs, dans la tragédie classique l’intrigue est très simple ce qui se trouve à l’opposé d’une intrigue comme celle de Manon Lescaut où les rebondissent ne cessent de s’accumuler. Règles de la tragédie classique basées sur la vraisemblance et la raison : vraisemblance, vérité, réalisme psychologique des personnages = ne pas faire des scènes bouffonnes !
Idéal dramatique de Racine : « Une action simple, chargée de peu de matière, telle que doit être une action qui se passe en un seul jour, et qui, s’avançant par degrés vers sa fin, n’est soutenue que par les intérêts, les sentiments et les passions des personnages. « l’action doit être simple = une tragédie de Racine peut être résumée en quelques phrases.
* Pas de bienséance en ce qui concerne les meurtres
Si Manon Lescaut était mis en scène, il y aurait à de nombreuses reprises des scènes de ce genre : lorsque des Grieux tue un portier pour s’enfuir de St Lazare, lorsqu’il croit tuer Synnelet et duel, à la fin de l’épisode de l’Amérique, etc du sang serait donc répandu sur la scène ce qui est inconcevable dans une tragédie.
Cependant, les moments d’intimité entre Grieux et Manon sont toujours rapportés dans des sommaires rapides = respect de la bienséance dignité du couple préservée.
* Style et structure inadéquats
Composition de la tragédie classique : claire et rigoureuse (5 actes) =/ Manon Lescaut ?? 2 épisodes de taille à peu près égale mais encore ??
* Une intrigue ni mythologique ni historique contexte « contemporain «
Sujet emprunté ni à la fable (mythologie), ni à l’Histoire (romaine/antique) // Régence
* Pas de pudeur révèle des mœurs jusque là taboues
André Gide : admirait la tragédie classique, cet « art de pudeur et de modestie « et sa « qualité la plus exquise : la réserve « =/ Manon Lescaut !!!
* Tragédie = action grand // ML = vols, machinations, illégalités
Préface de Bérénice : « Ce n’est point une nécessité qu’il y ait du sang et des morts dans une tragédie : il suffit que l’action en soit grande, que les acteurs en soient héroïques, que les passions y soient excitées, et que tout s’y ressente de cette tristesse majestueuse qui fait tout le plaisir de la tragédie « =/ ML !! definitely not ex : le pouvoir de l’argent p. 72-74 : Grieux dans le monde de la friponnerie
2. Des personnages non tragiques
* Héros ni forts ni élevés = une catin et un vicieux
* L’honneur ne passe pas avant tout dans ML
* Grieux, un héros manquant d’orgueil
Corneille : attiré par les âmes fortes, personnalités puissantes, non médiocres (DG), triomphe de leur tendance dominante. Rodrigue = héros de l’honneur familial et féodal ; opposition frappante entre héros et médiocres ; « gloire « = forme passionnée de l’honneur chez les héros cornéliens ; être « bien-nés « (=/ Manon) ; âmes fières ; surtout pour le héros : ne pas déchoir à ses propres yeux ; honneur ! Rodrigue prêt à tout pour l’honneur (tuer le père de la femme qu’il aime et donc lui faire, leur faire du mal), honneur avant tout =/ des Grieux. Héros cornélien fait sien ce code de l’honneur par l’adhésion de sa raison : décision, volonté libre et souveraine. Mais obligé de faire des choix, mis à l’épreuve (= DG honneur ou amour, famille ou amour, etc) + un moment où l’émotion du héros ne peut plus se contenir (« Hélas ! « = DG). Héros raciniens : orgueilleux =/ DG
Entre l’amour et l’honneur, Grieux choisit l’amour // héros cornéliens qui choisissent l’honneur sont assez forts pour choisir la vertu et résister aux passions
* Le héros tragique ne doit jamais oublier sa dignité pas Manon ou Grieux
Titus, même lorsqu’il soupire et pleure par amour pour Bérénice ne perd rien aux yeux du spectateur de sa dignité souveraine =/ DG pathétique, oder ?
* Grieux, un héros qui ne maîtrise pas toujours son langage et ses attitudes
* L’amour tragique n’est habituellement pas partagé Manon aime en retour
D’ordinaire, la passion racinienne n’est pas partagée + « la passion, aveugle et fatale, semble aboutir nécessairement à une impasse « =/ Manon Lescaut ou la passion semble être réciproque, partagée donc mais où effectivement elle aboutit sur un drame.
* Le héros tragique ne s’éprend pas d’une inférieure
« Les héros cornéliens ont le cœur trop haut pour que leur inclination puisse les asservir à un être indigne d’eux (honneur !). S’il ne naît pas d’une démarche rationnelle, l’amour est pourtant fondé en raison. Le cœur a comme une intuition de la valeur de l’être auquel il va s’attacher « =/ Des Grieux en tombant amoureux de Manon qui n’est pas noble !
* Le héros tragique ne peut pas se sacrifier Grieux et Manon abandonne tout l’un pour l’autre (scène du pardon)
Amour chez Racine : égoïsme de la passion : « les héros de Racine ne peuvent pas se sacrifier pour sauver l’être aimé ou pour assurer son bonheur « =/ dG donnerait sa vie pour Manon à la fin
* L’amour dans la tragédie est toujours ancien le coup de foudre de ML est rapporté en scène
Les faits se déroulant sous les yeux des spectateurs sont réduits au minimum ; tragédie de Racine nous peint une crise passionnelle. Les passions qui provoqueront l’issue fatale remontent assez loin dans le temps : « Racine commence sa pièce au moment où les passions longtemps contenues vont déchaîner leur fureur « =/ rencontre amoureuse dans ML et naissance de l’amour et de la passion devant les yeux des spectateurs/lecteurs, au début du récit du chevalier.
3. Une fatalité différente de la fatalité tragique, inspirant des sentiments différents
* Un dénouement non tragique car pas assez catégorique + prolepses qui détruisent l’illusion d’une issue possible
Chez Racine, c’est clair et fatal : les héros doivent mourir. Dans ML, c’est plus en nuances : DG va pouvoir effectuer un retour vers la vertu, une fois Manon morte. Il va également, par son récit au second narrateur le marquis de Renoncourt, avoir la possibilité de prendre du recul par rapport à sa conduite d’alors et peut-être essayer de porter un regard plus éclairé pour comprendre.
+ « avançant par degrés vers sa fin « : le spectateur pressent le dénouement tout en gardant l’illusion que l’issue tragique pourra être évitée =/ ML avec les nombreuses prolepses du narrateur
* Grieux, un héros qui n’est pas prisonnier de son destin : des issues (discours moralisateurs)
On aurait pu éviter la catastrophe, le personnage n’est pas entièrement prisonnier de sa destinée (arbitraire), il a une certaine marge de manoeuvre : la preuve, il éprouve des regrets de ne pas avoir tout fait pour sauver Manon, ou du moins d’avoir agi trop tard. Il aurait eu la possibilité d’agir autrement et le destin des deux protagonistes aurait dans ce cas eu une issue différente et vraisemblablement moins tragique.
* Grieux, victime d’une seule des trois formes de fatalité tragique
La fatalité : « l’essence même du tragique racinien réside dans l’inutile combat de l’homme contre son destin. 3 formes de l’invincible fatalité : destin hostile, malédiction héréditaire et l’impulsion irrésistible de la passion « =/ DG pour lequel il n’y a que le pouvoir (auto)destructeur de la passion =/ fatalité antique (héros racinien = « être marqué, maudit, victime de la haine des dieux «)
* Un héros ayant une position non tragique face à son destin : au lieu de se battre contre celui-ci, comme s’il était libre, Grieux l’utilise pour se décharger de sa responsabilité
Héros racinien pas libre mais qui se débat comme s’il l’était + se juge responsable de ses actes = humain, nous émeut en cela =/ DG qui nous énerve (en s’excusant)
Pas une tragédie non plus dans la mesure où le héros tragique va droit devant, directement à la perte, sans remords. // Grieux : interrogations aurait-il pu faire autrement ?
* Une œuvre n’inspirant pas une « tristesse majestueuse « : l’ironie et le cynisme du narrateur enlève cette distance que l’on trouve entre la scène où se joue du théâtre classique te son public Il n’inspire pas de sentiments si profonds.
Ex : Ironie sur les sentiments : « L’mour me rendait déjà si éclairé « recul ironique p. 36
Ex : Satire du genre romanesque p. 36 : le beau rôle que se donne Grieux (sauveur de la belle)
Ex : Ironie du père à la deuxième rencontre (p. 157-160) : « grâce au scandale «, « avantage «
Ex : Des scènes bouffonnes qui sont toujours prescrites des tragédies Ex de la scène satirique du « jeu libertin « où les talents d’acteurs de Des Grieux tirent toute la scène au ridicule : p. 84-85
+ non respect du classicisme : Des Grieux ose même parodier des vers de Racine p. 131, cf dossier p. 228
III. Manon Lescaut, une œuvre au-dessus de simples questions de forme
Un mix de tragédie classique, de drame et de romanesque pour un résultat « optimal « : l’Abbé Prévost n’a pas eu besoin de se plier à des règles strictes pour parvenir à « plaire et toucher « : un roman a réussi là où des tragédies médiocres avaient échoué (préface de Bérénice : « La principale règle est de plaire et de toucher. Toutes les autres ne sont faites que pour parvenir à cette première «).
1. Un roman d’apprentissage témoignant des mœurs de son époque
* Les aspects faisant de Manon Lescaut un roman de toute évidence
L’abbé Prévost n’a pas eu pour intention d’écrire une pièce de théâtre (pour la forme). ML n’est ni une tragédie ni un drame.
* Un personnage central auquel on s’identifie par la focalisation interne
* Un personnage cumulant les erreurs et nous livrant ses impressions et sentiments au fur et à mesure
+ un personnage qui progresse : il gagne en confiance en lui s’interroge sans cesse, doute // prend le pouvoir dans le dialogue avec Tiberge p. 96-98, affirme sa supériorité dans l’argumentation.
Un personnage ayant maints semblables parmi ses contemporains = roman de mœurs
* Réalisme : le contexte clair de la Régence
AP a un souci de vraisemblance : il situe toujours avec soin chaque épisode.
Ex : Réalisme : détails (« qui s’appelait Tiberge «) + lieux réels (« Arras «) p. 36
* Un sujet d’actualité jusque là tabou porté au grand jour : le libertinage.
L’auteur ne veut pas déformer la réalité de son époque. C’est pourquoi son narrateur, Renoncourt, explique même avoir voulu une fidélité maximale : rien d’ajouté par celui-ci qui n’y a même pas réfléchi afin de ne pas se donner l’occasion de déformer les propos de Grieux, pas de recul.
2. Un roman édifiant
* But = montrer « un exemple terrible de la force des passions «
* Le but est d’instruire le lecteur par un contre-exemple
* L’Abbé veut édifier son lecteur en lui montrant les dangers menaçant la vie d’un jeune homme non aguerri un roman écrit dans un but précis : roman édifiant
* Pas de morale à la fin le lecteur doit trouver la leçon lui-même = but didactique affiché mais proche des moralistes, pas moralisateurs
Ex : Deuxième rencontre avec le père (p. 157-160) nouvel exemple de la force des passions, filiales cette fois il faut se distancier de ses sentiments, en montrant de façon exagérée au lecteur où ceux-ci peuvent mener (erreur du père de vouloir aider son fils dans sa fuite) il faut contrôler ses pulsions sentimentales
Comme les moralistes français : peinture fidèle de la réalité psychologique = meilleur enseignement moral que puisse donner la littérature
Elans de piété, moments de repentir, discours édifiants => mêlés au libertinage des mœurs = enseignement
Cette intention explique aussi le fait que de nombreux aspects de la tragédie classique ne sont pas utilisés par l’Abbé Prévost dans son œuvre : comme l’explique Des Grieux p. 189, c’est « l’exemple terrible de la force des passions « qui est important, la fin n’a pas d’importance selon le jugement du héros.
« L’ouvrage entier est un traité de morale, réduit agréablement en exercice. «
3. Un roman touchant
* Des héros imparfaits : trop romantiques, naïfs, ou sans repères
* Descriptions des passions avec une justesse rare : pas seulement une mise en garde contre les passions, mais aussi une apologie de celles-ci
Ex : A la fois critique + apologie de la passions = scène du jeu libertin p. 84-85 : Le récit semble plus encourager à un libertinage intelligent qu’au renoncement à celui-ci, qui est présenté comme n’étant simplement pas fait pour les acteurs amateurs ce qui témoigne justement d’un certain respect pour le libertinage
* Un libre semant des questions sur les personnages plus qu’il ne livre de réponses
* Un message double (apologie/mise en garde) ne nécessitant ni règles ni genre fixe pour « plaire et toucher « « le plaisir d’une lecture agréable « p. 26
* Le destinataire n’est pas oublié, il faut plaire au lecteur (préface) longueur réduite pour avoir plus de succès
* Un roman qui a plu et qui a acquis une grande notoriété, ayant perduré de siècle en siècle, encore après la disparition du libertinage
* Un récit efficace : double narrateur intradiégétique + récit rétrospectif (retour en arrière) + récit psychologique pour établir un lien avec le lecteur = confession + implication du lecteur : distanciation regard d’observateur objectif nécessité d’un rôle actif du lecteur (pour juger ces observations)
Ex : Implication du lecteur qui doit juger, départager les jugements (scène p. 30-31)
* Le lecteur voit, observe un spectacle = théâtre : « Entrez, regardez vous-même «
* Les deux personnages principaux Manon et Grieux sont découverts par le lecteur en même temps que ne le fait le narrateur + via des jugements (parfois contraires) de personnages extérieurs peu importants but = donner une vue d’ensemble plutôt objective, afin que le lecteur se forge sa propre opinion (choix de l’auteur = en faisant parler d’abord des personnages objectifs, pas directement Manon ou Grieux) MAIS l’influence du narrateur qui lui, est immédiatement bien prédisposé aux personnages.
+ thème romantique : expression des sentiments, importance de l’amour. « Un roman d’une grande intelligence « (Goethe)
Liens utiles
- la tragédie dans les romans au siècle des lumières : deux exemples, Manon Lescaut et Les Liaisons Dangereuses
- Commentaire Manon Lescaut
- Analyse de texte : L’abbé Prévost, Manon Lescaut
- Abbé Prévost - Manon Lescaut: Qu’en est-il du discours rapporté ?
- fiche de lecture manon lescaut
