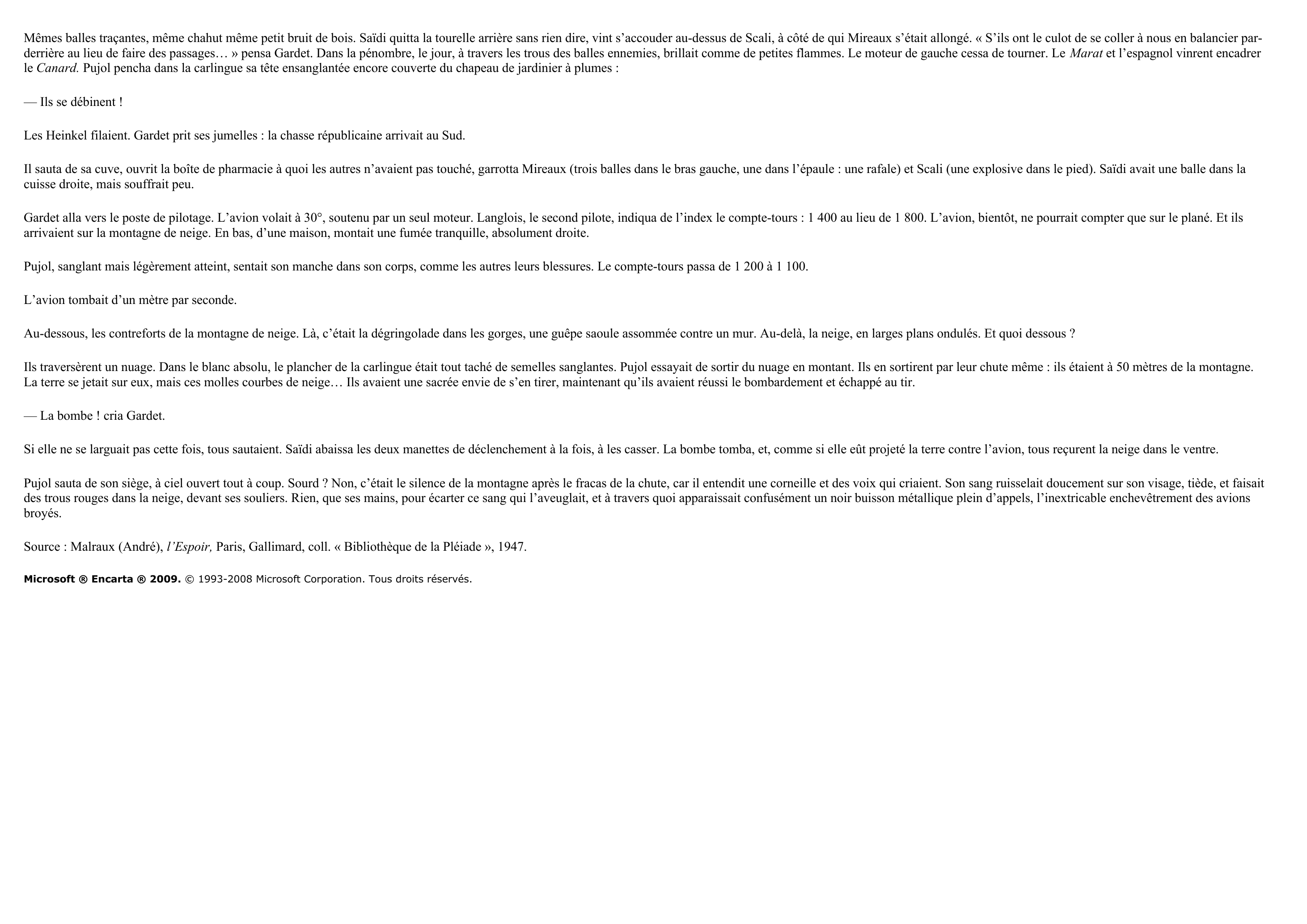Malraux, l'Espoir (extrait).
Publié le 07/05/2013
Extrait du document
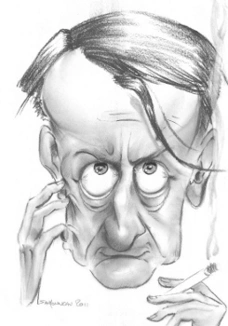
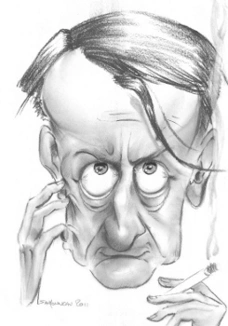
«
Mêmes balles traçantes, même chahut même petit bruit de bois.
Saïdi quitta la tourelle arrière sans rien dire, vint s’accouder au-dessus de Scali, à côté de qui Mireaux s’était allongé.
« S’ils ont le culot de se coller à nous en balancier par-
derrière au lieu de faire des passages… » pensa Gardet.
Dans la pénombre, le jour, à travers les trous des balles ennemies, brillait comme de petites flammes.
Le moteur de gauche cessa de tourner.
Le Marat et l’espagnol vinrent encadrer
le Canard. Pujol pencha dans la carlingue sa tête ensanglantée encore couverte du chapeau de jardinier à plumes :
— Ils se débinent !
Les Heinkel filaient.
Gardet prit ses jumelles : la chasse républicaine arrivait au Sud.
Il sauta de sa cuve, ouvrit la boîte de pharmacie à quoi les autres n’avaient pas touché, garrotta Mireaux (trois balles dans le bras gauche, une dans l’épaule : une rafale) et Scali (une explosive dans le pied).
Saïdi avait une balle dans la
cuisse droite, mais souffrait peu.
Gardet alla vers le poste de pilotage.
L’avion volait à 30°, soutenu par un seul moteur.
Langlois, le second pilote, indiqua de l’index le compte-tours : 1 400 au lieu de 1 800.
L’avion, bientôt, ne pourrait compter que sur le plané.
Et ils
arrivaient sur la montagne de neige.
En bas, d’une maison, montait une fumée tranquille, absolument droite.
Pujol, sanglant mais légèrement atteint, sentait son manche dans son corps, comme les autres leurs blessures.
Le compte-tours passa de 1 200 à 1 100.
L’avion tombait d’un mètre par seconde.
Au-dessous, les contreforts de la montagne de neige.
Là, c’était la dégringolade dans les gorges, une guêpe saoule assommée contre un mur.
Au-delà, la neige, en larges plans ondulés.
Et quoi dessous ?
Ils traversèrent un nuage.
Dans le blanc absolu, le plancher de la carlingue était tout taché de semelles sanglantes.
Pujol essayait de sortir du nuage en montant.
Ils en sortirent par leur chute même : ils étaient à 50 mètres de la montagne.
La terre se jetait sur eux, mais ces molles courbes de neige… Ils avaient une sacrée envie de s’en tirer, maintenant qu’ils avaient réussi le bombardement et échappé au tir.
— La bombe ! cria Gardet.
Si elle ne se larguait pas cette fois, tous sautaient.
Saïdi abaissa les deux manettes de déclenchement à la fois, à les casser.
La bombe tomba, et, comme si elle eût projeté la terre contre l’avion, tous reçurent la neige dans le ventre.
Pujol sauta de son siège, à ciel ouvert tout à coup.
Sourd ? Non, c’était le silence de la montagne après le fracas de la chute, car il entendit une corneille et des voix qui criaient.
Son sang ruisselait doucement sur son visage, tiède, et faisait
des trous rouges dans la neige, devant ses souliers.
Rien, que ses mains, pour écarter ce sang qui l’aveuglait, et à travers quoi apparaissait confusément un noir buisson métallique plein d’appels, l’inextricable enchevêtrement des avions
broyés.
Source : Malraux (André), l’Espoir, Paris, Gallimard, coll.
« Bibliothèque de la Pléiade », 1947.
Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation.
Tous droits réservés..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Malraux, l'Espoir (extrait).
- Malraux, l'Espoir (extrait)
- Vous ferez de ce texte de Malraux, extrait de l'Espoir, un commentaire composé, en insistant sur les différents thèmes mis en œuvre par l'auteur.
- Malraux: L'espoir (résumé & analyse)
- ESPOIR (L'), roman d'André Malraux