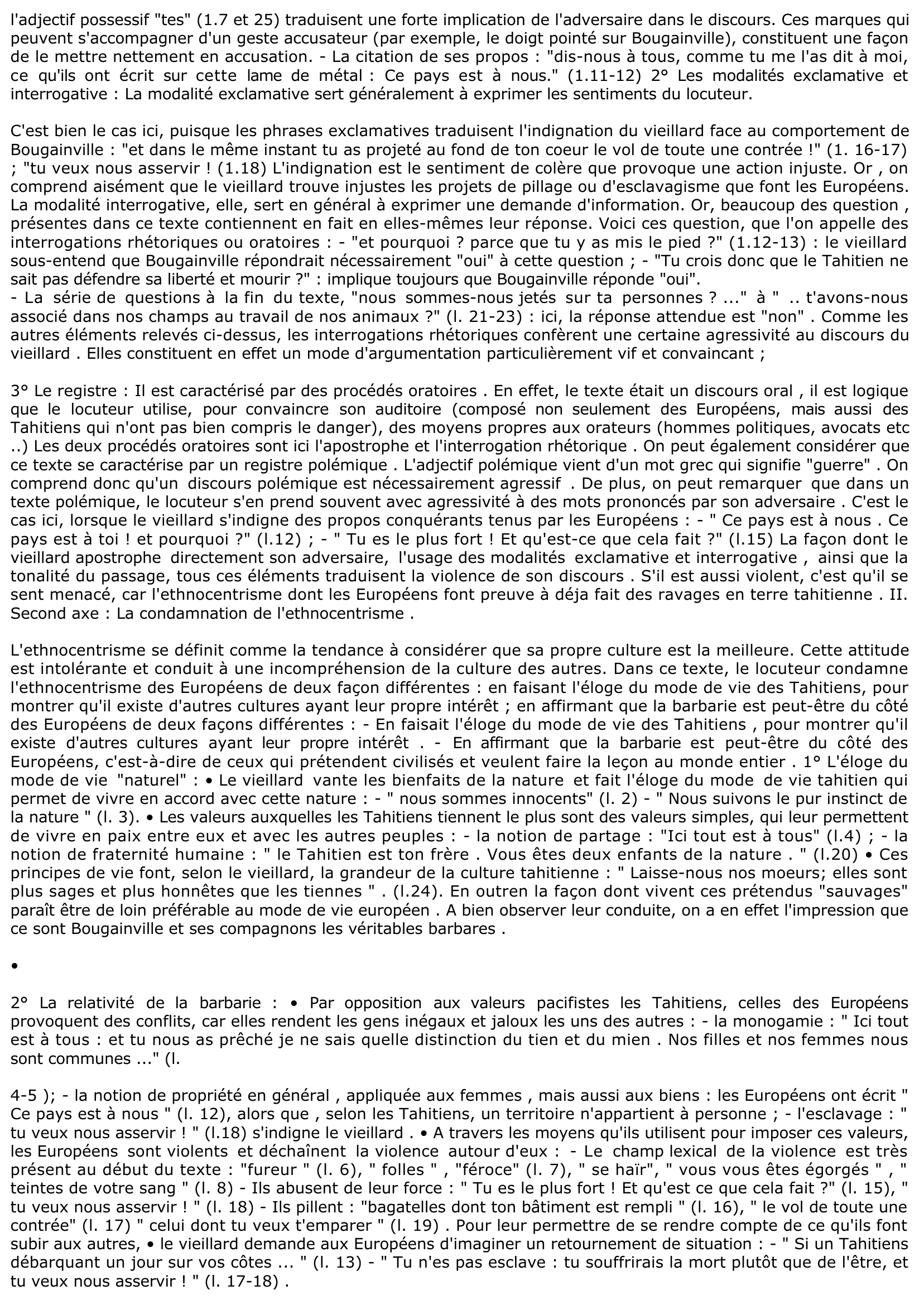LE MOUVEMENT LITTERAIRE ET CULTUREL : LES LUMIERES
Publié le 30/07/2010
Extrait du document
GROUPEMENT DE TEXTES : LE COMBAT DES PHILOSOPHES CONTRE L'INTOLERANCE Texte n° 5 : Diderot, Supplément au Voyage de Bougainville (1772) [Le supplément au voyage de Bougainville fait suite au récit publié en 1771 par le naivigateur Bougainville, à l'issue de son tour du monde . Bougainville avait ramené avec lui un Tahitien, Aotourou qu'il " promena" dans tout Paris . Diderot trouva dans le récit du voyageur et les témoignages du Tahitien l'occasion de réfléchir au problème de la colonisation et à la relativité des coutumes . Il imagine ici les propos d'un vieillard qui figurait dans le récit du navigateur . Au moment de départ des Européens - que les tahitiens déplorent , le vieillard s'adresse d'abord à ses semblables, à qui il dépeint les dangers de la civilisation occidentale . Il s'en rend ensuite aux Européens eux-mêmes .] Puis s'adressant à Bougainville, il ajouta : " Et toi, chef des brigands qui t'obéissent, écarte promptement ton vaisseau de notre rive : nous sommes innocents, nous sommes heureux ; et tu ne peux que nuire à notre bonheur. Nous suivons le pur instinct de la nature ; et tu as tenté d'effacer de nos âmes son caractère. Ici tout est à tous et tu nous as prêché je ne sais quelle distinction du tien et du mien. Nos filles et nos femmes nous sont communes ; tu as partagé ce privilège avec nous ; et tu es venu allumer en elles des fureurs inconnues. Elles sont devenues folles dans tes bras ; tu es devenu féroce entre les leurs. Elles ont commencé à se haïr ; vous vous êtes égorgés pour elles ; et elles nous sont revenues teintes de votre sang. Nous sommes libres ; et voilà que tu as enfoui dans notre terre le titre de notre futur esclavage. Tu n'es ni un dieu, ni un démon qui es-tu donc, pour faire des esclaves ? Orou ! toi qui entends la langue de ces hommes là, dis nous à tous, comme tu me l'as dit à moi-même, ce qu'ils ont écrit sur cette lame de métal : Ce pays est a nous. Ce pays est à toi ! et pourquoi ? parce que tu y as mis le pied ? Si un Tahitien débarquait un jour sur vos côtes, et qu'il gravât sur une de vos pierres ou sur l'écorce d'un de vos arbres. Ce pays est aux habitants de Tahiti, qu'en penserais-tu ? Tu es le plus fort ! Et qu'est-ce que cela fait ? Lorsqu'on t'a enlevé une des méprisables bagatelles dont ton bâtiment est rempli , tu t'es récrié, tu t'es vengé ; et dans le même instant tu as projeté au fond de ton coeur le vol de toute une contrée ! Tu n'es pas esclave : tu souffrirais plutôt la mort que de l'être, et tu veux nous asservir ! Tu crois donc que le Tahitien ne sait pas défendre sa liberté et mourir ? Celui dont tu veux t'emparer comme de la brute, le Tahitien est ton frère. Vous êtes deux enfants de la nature ; quel droit as-tu sur lui qu'il n'ait pas sur toi ? Tu es venu ; nous sommes-nous jetés sur ta personne ? avons-nous pillé ton vaisseau ? t'avons-nous saisi et exposé aux flèches de nos ennemis ? t'avons-nous associé dans nos champs au travail de nos animaux ? Nous avons respecté notre image en toi. Laisserons nos moeurs ; elles sont plus sages et plus honnêtes que les tiennes ; nous ne voulons point troquer ce que tu appelles notre ignorance, contre tes inutiles lumières " . Supplément au Voyage de Bougainville , deuxième partie, "Les adieux du vieillard" . Lecture analytique Introduction Présentation de l'auteur (voir recherche sur le XVIIIème siècle). Ce texte est extrait du Supplément au voyage de Bougainville de Diderot. Publiée en 1772, cette oeuvre est une suite imaginaire apportée par le célèbre philosophe des Lumières au récit de voyage qu'avait publié le navigateur de Bougainville en 1771 , après son tour du monde. Cette oeuvre de Diderot a été écrite dans un contexte particulier : en effet, il s'agit d'une époque de colonisation du monde par les Européens, colonisation qui constitue le thème central du texte. Dans cet extrait, Diderot fait parler un vieillard tahitien dont Bougainville mentionnait l'existence dans son livre. Mais les propos qu'il lui prête sont purement fictifs. Le passage se situe au moment où les Européens s'apprêtent a quitter l'île. Alors que les Tahitiens semblent affectés par ce départ, le vieillard, lui, s'en réjouit. Après avoir expliqué à ses semblables quels dangers représentaient les Européens, il tient un long discours aux colonisateurs. Dans un premier temps, nous étudierons l'invective qu'il adresse aux Européens, et la violence qui s'en dégage. Puis, notre second axe consistera à étudier la condamnation de l'ethnocentrisme qui est exprimée à travers les propos du vieillard. Lecture à voix haute de l'extrait I. Premier axe : l'invective adressée par le vieillard aux Européens L'invective est un discours violent tenu contre quelqu'un. Si on utilise ce terme pour caractériser le discours du vieillard, c'est parce que ses propos renferment en effet une grande violence. Celle-ci se traduit tout d'abord par la façon dont il met en cause explicitement son adversaire. 1° L'implication de l'adversaire dans le discours : Bougainville, le principal adversaire du vieillard, est présent de plusieurs façons : - l'apostrophe : "Et toi, chef des brigand qui t'obéissent..." (1. 1). Par cette apostrophe, caractéristique de la tonalité oratoire, le vieillard se montre agressif à l'égard de Bougainville. - Les pronoms personnels "tu", de nombreuses fois répété (1.3 à 7, 9, 10 , 13, 15 à 21, 25), "toi" (1. 12, 21,23), "t"' (1. 15 et 22), l'adjectif possessif "tes" (1.7 et 25) traduisent une forte implication de l'adversaire dans le discours. Ces marques qui peuvent s'accompagner d'un geste accusateur (par exemple, le doigt pointé sur Bougainville), constituent une façon de le mettre nettement en accusation. - La citation de ses propos : "dis-nous à tous, comme tu me l'as dit à moi, ce qu'ils ont écrit sur cette lame de métal : Ce pays est à nous." (1.11-12) 2° Les modalités exclamative et interrogative : La modalité exclamative sert généralement à exprimer les sentiments du locuteur. C'est bien le cas ici, puisque les phrases exclamatives traduisent l'indignation du vieillard face au comportement de Bougainville : "et dans le même instant tu as projeté au fond de ton coeur le vol de toute une contrée !" (1. 16-17) ; "tu veux nous asservir ! (1.18) L'indignation est le sentiment de colère que provoque une action injuste. Or , on comprend aisément que le vieillard trouve injustes les projets de pillage ou d'esclavagisme que font les Européens. La modalité interrogative, elle, sert en général à exprimer une demande d'information. Or, beaucoup des question , présentes dans ce texte contiennent en fait en elles-mêmes leur réponse. Voici ces question, que l'on appelle des interrogations rhétoriques ou oratoires : - "et pourquoi ? parce que tu y as mis le pied ?" (1.12-13) : le vieillard sous-entend que Bougainville répondrait nécessairement "oui" à cette question ; - "Tu crois donc que le Tahitien ne sait pas défendre sa liberté et mourir ?" : implique toujours que Bougainville réponde "oui". - La série de questions à la fin du texte, "nous sommes-nous jetés sur ta personnes ? ..." à " .. t'avons-nous associé dans nos champs au travail de nos animaux ?" (l. 21-23) : ici, la réponse attendue est "non" . Comme les autres éléments relevés ci-dessus, les interrogations rhétoriques confèrent une certaine agressivité au discours du vieillard . Elles constituent en effet un mode d'argumentation particulièrement vif et convaincant ; 3° Le registre : Il est caractérisé par des procédés oratoires . En effet, le texte était un discours oral , il est logique que le locuteur utilise, pour convaincre son auditoire (composé non seulement des Européens, mais aussi des Tahitiens qui n'ont pas bien compris le danger), des moyens propres aux orateurs (hommes politiques, avocats etc ..) Les deux procédés oratoires sont ici l'apostrophe et l'interrogation rhétorique . On peut également considérer que ce texte se caractérise par un registre polémique . L'adjectif polémique vient d'un mot grec qui signifie "guerre" . On comprend donc qu'un discours polémique est nécessairement agressif . De plus, on peut remarquer que dans un texte polémique, le locuteur s'en prend souvent avec agressivité à des mots prononcés par son adversaire . C'est le cas ici, lorsque le vieillard s'indigne des propos conquérants tenus par les Européens : - " Ce pays est à nous . Ce pays est à toi ! et pourquoi ?" (l.12) ; - " Tu es le plus fort ! Et qu'est-ce que cela fait ?" (l.15) La façon dont le vieillard apostrophe directement son adversaire, l'usage des modalités exclamative et interrogative , ainsi que la tonalité du passage, tous ces éléments traduisent la violence de son discours . S'il est aussi violent, c'est qu'il se sent menacé, car l'ethnocentrisme dont les Européens font preuve à déja fait des ravages en terre tahitienne . II. Second axe : La condamnation de l'ethnocentrisme . L'ethnocentrisme se définit comme la tendance à considérer que sa propre culture est la meilleure. Cette attitude est intolérante et conduit à une incompréhension de la culture des autres. Dans ce texte, le locuteur condamne l'ethnocentrisme des Européens de deux façon différentes : en faisant l'éloge du mode de vie des Tahitiens, pour montrer qu'il existe d'autres cultures ayant leur propre intérêt ; en affirmant que la barbarie est peut-être du côté des Européens de deux façons différentes : - En faisait l'éloge du mode de vie des Tahitiens , pour montrer qu'il existe d'autres cultures ayant leur propre intérêt . - En affirmant que la barbarie est peut-être du côté des Européens, c'est-à-dire de ceux qui prétendent civilisés et veulent faire la leçon au monde entier . 1° L'éloge du mode de vie "naturel" : • Le vieillard vante les bienfaits de la nature et fait l'éloge du mode de vie tahitien qui permet de vivre en accord avec cette nature : - " nous sommes innocents" (l. 2) - " Nous suivons le pur instinct de la nature " (l. 3). • Les valeurs auxquelles les Tahitiens tiennent le plus sont des valeurs simples, qui leur permettent de vivre en paix entre eux et avec les autres peuples : - la notion de partage : "Ici tout est à tous" (l.4) ; - la notion de fraternité humaine : " le Tahitien est ton frère . Vous êtes deux enfants de la nature . " (l.20) • Ces principes de vie font, selon le vieillard, la grandeur de la culture tahitienne : " Laisse-nous nos moeurs; elles sont plus sages et plus honnêtes que les tiennes " . (l.24). En outren la façon dont vivent ces prétendus "sauvages" paraît être de loin préférable au mode de vie européen . A bien observer leur conduite, on a en effet l'impression que ce sont Bougainville et ses compagnons les véritables barbares . • 2° La relativité de la barbarie : • Par opposition aux valeurs pacifistes les Tahitiens, celles des Européens provoquent des conflits, car elles rendent les gens inégaux et jaloux les uns des autres : - la monogamie : " Ici tout est à tous : et tu nous as prêché je ne sais quelle distinction du tien et du mien . Nos filles et nos femmes nous sont communes ..." (l. 4-5 ); - la notion de propriété en général , appliquée aux femmes , mais aussi aux biens : les Européens ont écrit " Ce pays est à nous " (l. 12), alors que , selon les Tahitiens, un territoire n'appartient à personne ; - l'esclavage : " tu veux nous asservir ! " (l.18) s'indigne le vieillard . • A travers les moyens qu'ils utilisent pour imposer ces valeurs, les Européens sont violents et déchaînent la violence autour d'eux : - Le champ lexical de la violence est très présent au début du texte : "fureur " (l. 6), " folles " , "féroce" (l. 7), " se haïr", " vous vous êtes égorgés " , " teintes de votre sang " (l. 8) - Ils abusent de leur force : " Tu es le plus fort ! Et qu'est ce que cela fait ?" (l. 15), " tu veux nous asservir ! " (l. 18) - Ils pillent : "bagatelles dont ton bâtiment est rempli " (l. 16), " le vol de toute une contrée" (l. 17) " celui dont tu veux t'emparer " (l. 19) . Pour leur permettre de se rendre compte de ce qu'ils font subir aux autres, • le vieillard demande aux Européens d'imaginer un retournement de situation : - " Si un Tahitiens débarquant un jour sur vos côtes ... " (l. 13) - " Tu n'es pas esclave : tu souffrirais la mort plutôt que de l'être, et tu veux nous asservir ! " (l. 17-18) . • Les Européens se permettent de juger le peuple tahitien comme, un peuple inférieur, sous-développé ( "brute", l.20 ; " ce que tu appelles notre ignorances" l. 25) . En fait, ce sont eux qui font preuve d'une grande barbarie, à travers ce qu'ils font subir à ce peuple accueillant et pacifiste . Conclusion : • La forme d'intolérance visée ici est celle qui est liée à l'ethnocentrisme : le sentiment de supériorité d'un peuple peut le conduire à rejeter et à maltraiter les autres peuples. L'intolérance des Européens vis-à-vis des Tahitiens revêt plusieurs aspects : - le mépris (les Européens considèrent que les Tahitiens sont stupide) - l'imposition de moeurs étrangères au pays visité (monogamie, propriété,etc.) - la violence (pillage,volonté de réduire en esclavage, etc.) Ce texte est un discours (et non pas un texte narratif), comme le prouvent les pronoms et les temps utilisés (pronoms de 1ère et 2ème personne, présent comme temps dominant). Il s'agit plus précisément d'un monologue, puisque seul le vieillard parle. La dénonciation de l'intolérance des Européens est explicite : il s'adresse directement à ses ennemis, et avance plusieurs arguments pour leur montrer qu'ils ont mal agi. • Diderot dénonce ici les pratiques dominatrices des Européens. - Il ne s'exprime pas en son nom propre , mais par la voix d'une victime de cette domination : le vieillard, qui est aussi le représentant d'une forme de sagesse que les Européens semblent avoir perdue. Faire dénoncer des excès par ceux qui en sont les victimes était déjà un procédé utilisé par Montesquieu dans De l'esprit des lois (1748) lorsqu'un auteur juif s'en prend à l'Inquisition (voir texte n°3). - Le discours du vieillard a un destinataire apparent, interne au récit (Bougainville et ses compagnons). Mais au-delà, ce sont bien les lecteurs français qu'il s'agit de toucher et de convaincre. A ceux qui admirent les navigateurs, leur explorations et les produits exotiques qu'ils rapportent de pays lointains, Diderot présente une facette de ces voyages beaucoup moins idéale.
«
l'adjectif possessif "tes" (1.7 et 25) traduisent une forte implication de l'adversaire dans le discours.
Ces marques quipeuvent s'accompagner d'un geste accusateur (par exemple, le doigt pointé sur Bougainville), constituent une façonde le mettre nettement en accusation.
- La citation de ses propos : "dis-nous à tous, comme tu me l'as dit à moi,ce qu'ils ont écrit sur cette lame de métal : Ce pays est à nous." (1.11-12) 2° Les modalités exclamative etinterrogative : La modalité exclamative sert généralement à exprimer les sentiments du locuteur.
C'est bien le cas ici, puisque les phrases exclamatives traduisent l'indignation du vieillard face au comportement deBougainville : "et dans le même instant tu as projeté au fond de ton coeur le vol de toute une contrée !" (1.
16-17); "tu veux nous asservir ! (1.18) L'indignation est le sentiment de colère que provoque une action injuste.
Or , oncomprend aisément que le vieillard trouve injustes les projets de pillage ou d'esclavagisme que font les Européens.La modalité interrogative, elle, sert en général à exprimer une demande d'information.
Or, beaucoup des question ,présentes dans ce texte contiennent en fait en elles-mêmes leur réponse.
Voici ces question, que l'on appelle desinterrogations rhétoriques ou oratoires : - "et pourquoi ? parce que tu y as mis le pied ?" (1.12-13) : le vieillardsous-entend que Bougainville répondrait nécessairement "oui" à cette question ; - "Tu crois donc que le Tahitien nesait pas défendre sa liberté et mourir ?" : implique toujours que Bougainville réponde "oui".- La série de questions à la fin du texte, "nous sommes-nous jetés sur ta personnes ? ..." à " ..
t'avons-nousassocié dans nos champs au travail de nos animaux ?" (l.
21-23) : ici, la réponse attendue est "non" .
Comme lesautres éléments relevés ci-dessus, les interrogations rhétoriques confèrent une certaine agressivité au discours duvieillard .
Elles constituent en effet un mode d'argumentation particulièrement vif et convaincant ;
3° Le registre : Il est caractérisé par des procédés oratoires .
En effet, le texte était un discours oral , il est logiqueque le locuteur utilise, pour convaincre son auditoire (composé non seulement des Européens, mais aussi desTahitiens qui n'ont pas bien compris le danger), des moyens propres aux orateurs (hommes politiques, avocats etc..) Les deux procédés oratoires sont ici l'apostrophe et l'interrogation rhétorique .
On peut également considérer quece texte se caractérise par un registre polémique .
L'adjectif polémique vient d'un mot grec qui signifie "guerre" .
Oncomprend donc qu'un discours polémique est nécessairement agressif .
De plus, on peut remarquer que dans untexte polémique, le locuteur s'en prend souvent avec agressivité à des mots prononcés par son adversaire .
C'est lecas ici, lorsque le vieillard s'indigne des propos conquérants tenus par les Européens : - " Ce pays est à nous .
Cepays est à toi ! et pourquoi ?" (l.12) ; - " Tu es le plus fort ! Et qu'est-ce que cela fait ?" (l.15) La façon dont levieillard apostrophe directement son adversaire, l'usage des modalités exclamative et interrogative , ainsi que latonalité du passage, tous ces éléments traduisent la violence de son discours .
S'il est aussi violent, c'est qu'il sesent menacé, car l'ethnocentrisme dont les Européens font preuve à déja fait des ravages en terre tahitienne .
II.Second axe : La condamnation de l'ethnocentrisme .
L'ethnocentrisme se définit comme la tendance à considérer que sa propre culture est la meilleure.
Cette attitudeest intolérante et conduit à une incompréhension de la culture des autres.
Dans ce texte, le locuteur condamnel'ethnocentrisme des Européens de deux façon différentes : en faisant l'éloge du mode de vie des Tahitiens, pourmontrer qu'il existe d'autres cultures ayant leur propre intérêt ; en affirmant que la barbarie est peut-être du côtédes Européens de deux façons différentes : - En faisait l'éloge du mode de vie des Tahitiens , pour montrer qu'ilexiste d'autres cultures ayant leur propre intérêt .
- En affirmant que la barbarie est peut-être du côté desEuropéens, c'est-à-dire de ceux qui prétendent civilisés et veulent faire la leçon au monde entier .
1° L'éloge dumode de vie "naturel" : • Le vieillard vante les bienfaits de la nature et fait l'éloge du mode de vie tahitien quipermet de vivre en accord avec cette nature : - " nous sommes innocents" (l.
2) - " Nous suivons le pur instinct dela nature " (l.
3).
• Les valeurs auxquelles les Tahitiens tiennent le plus sont des valeurs simples, qui leur permettentde vivre en paix entre eux et avec les autres peuples : - la notion de partage : "Ici tout est à tous" (l.4) ; - lanotion de fraternité humaine : " le Tahitien est ton frère .
Vous êtes deux enfants de la nature .
" (l.20) • Cesprincipes de vie font, selon le vieillard, la grandeur de la culture tahitienne : " Laisse-nous nos moeurs; elles sontplus sages et plus honnêtes que les tiennes " .
(l.24).
En outren la façon dont vivent ces prétendus "sauvages"paraît être de loin préférable au mode de vie européen .
A bien observer leur conduite, on a en effet l'impression quece sont Bougainville et ses compagnons les véritables barbares .
•
2° La relativité de la barbarie : • Par opposition aux valeurs pacifistes les Tahitiens, celles des Européensprovoquent des conflits, car elles rendent les gens inégaux et jaloux les uns des autres : - la monogamie : " Ici toutest à tous : et tu nous as prêché je ne sais quelle distinction du tien et du mien .
Nos filles et nos femmes noussont communes ..." (l.
4-5 ); - la notion de propriété en général , appliquée aux femmes , mais aussi aux biens : les Européens ont écrit "Ce pays est à nous " (l.
12), alors que , selon les Tahitiens, un territoire n'appartient à personne ; - l'esclavage : "tu veux nous asservir ! " (l.18) s'indigne le vieillard .
• A travers les moyens qu'ils utilisent pour imposer ces valeurs,les Européens sont violents et déchaînent la violence autour d'eux : - Le champ lexical de la violence est trèsprésent au début du texte : "fureur " (l.
6), " folles " , "féroce" (l.
7), " se haïr", " vous vous êtes égorgés " , "teintes de votre sang " (l.
8) - Ils abusent de leur force : " Tu es le plus fort ! Et qu'est ce que cela fait ?" (l.
15), "tu veux nous asservir ! " (l.
18) - Ils pillent : "bagatelles dont ton bâtiment est rempli " (l.
16), " le vol de toute unecontrée" (l.
17) " celui dont tu veux t'emparer " (l.
19) .
Pour leur permettre de se rendre compte de ce qu'ils fontsubir aux autres, • le vieillard demande aux Européens d'imaginer un retournement de situation : - " Si un Tahitiensdébarquant un jour sur vos côtes ...
" (l.
13) - " Tu n'es pas esclave : tu souffrirais la mort plutôt que de l'être, ettu veux nous asservir ! " (l.
17-18) ..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- LA2 : VOLTAIRE, Le Dictionnaire Philosophique, article Liberté de penser, 1764 Introduction : -18 ème s : Mouvement des Lumières, mouvement littéraire, culturel, intellectuel, philosophique.
- LE MOUVEMENT DES LUMIERES Fiche composée par sylvain sylvain.
- Un mouvement culturel et littéraire : l'Humanisme au XVIème siècle
- punk. >adj. et n.m., terme qui désigne un mouvement culturel
- Néogothique : mouvement culturel de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle fortement inspiré par l'époque médiévale, particulièrement dans le domaine architectural.