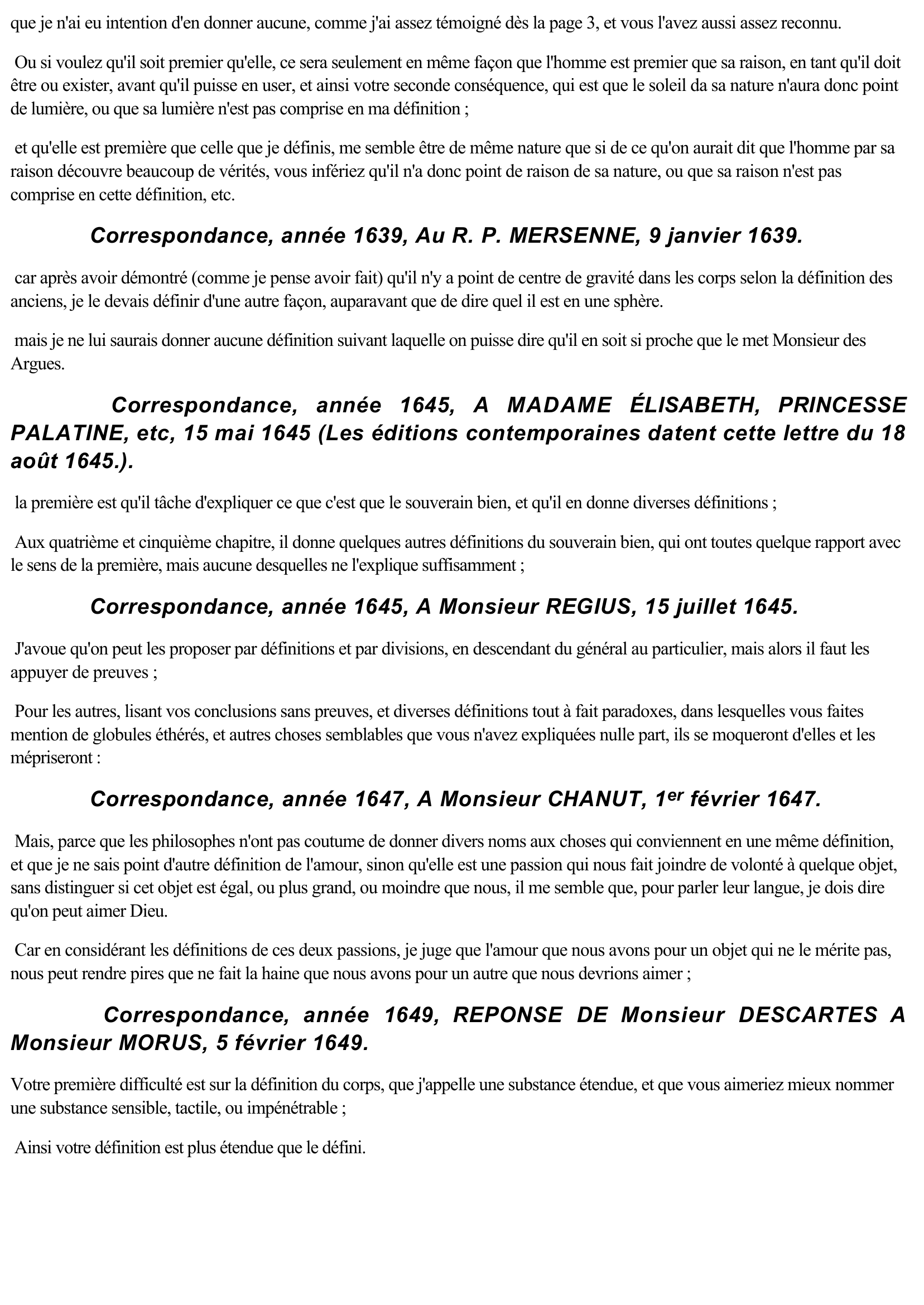Le mot "définition" dans l'oeuvre de DESCARTES
Publié le 06/08/2010
Extrait du document
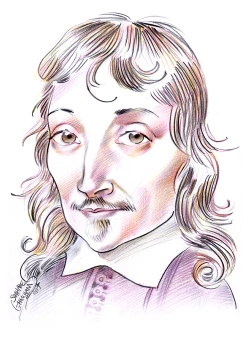
Règles pour la direction de l’esprit, Règle douzième.
On doit donc reconnaître qu’il ne faut jamais expliquer les choses de cette espèce par des définitions, de peur de prendre le simple pour le composé, mais seulement les distinguer les unes des autres, et les examiner attentivement selon les lumières de son esprit.
MEDITATIONS METAPHYSIQUES, REPONSES DE L’AUTEUR AUX SECONDES OBJECTIONS.
La synthèse, au contraire, par une voie toute différente, et comme en examinant les causes par leurs effets (bien que la preuve qu’elle contient soit souvent aussi des effets par les causes), démontre à la vérité clairement ce qui est contenu en ses conclusions, et se sert d’une longue suite de définitions, de demandes, d’axiomes, de théorèmes et de problèmes, afin que, si on lui nie quelques conséquences, elle fasse voir comment elles sont contenues dans les antécédents, et qu’elle arrache le consentement du lecteur, tant obstiné et opiniâtre qu’il puisse être ;
LES PASSIONS DE L’AME, PREMIERE PARTIE, ARTICLE 37.
Et parce que le semblable arrive en toutes les autres passions, à savoir, qu’elles sont principalement causées par les esprits qui sont contenus dans les cavités du cerveau, en tant qu’ils prennent leur cours vers les nerfs qui servent à élargir ou étrécir les orifices du coeur, ou à pousser diversement vers lui le sang qui est dans les autres parties, ou, en quelque autre façon que ce soit, à entretenir la même passion, on peut clairement entendre de ceci pourquoi j’ai mis ci-dessus en leur définition qu’elles sont causées par quelque mouvement particulier des esprits.
LES PASSIONS DE L’AME, PREMIERE PARTIE, ARTICLE 46.
Il y a une raison particulière qui empêche l’âme de pouvoir promptement changer ou arrêter ses passions, laquelle m’a donné sujet de mettre ci-dessus en leur définition qu’elles sont non seulement causées, mais aussi entretenues et fortifiées par quelque mouvement particulier des esprits.
LES PASSIONS DE L’AME, SECONDE PARTIE, ARTICLE 93.
et on voit de leurs définitions que la joie vient de l’opinion qu’on a de posséder quelque bien, et la tristesse, de l’opinion qu’on a d’avoir quelque mal ou quelque défaut.
LES PASSIONS DE L’AME, SECONDE PARTIE, ARTICLE 137.
Après avoir donné les définitions de l’amour, de la haine, du désir, de la joie, de la tristesse, et traité de tous les mouvements corporels qui les causent ou accompagnent, nous n’avons plus ici à considérer que leur usage.
Correspondance, année 1629, Au R. P. MERSENNE, 20 novembre 1629.
car de dire qu’il expliquera les pensées des anciens par les mots desquels ils se sont servis, en prenant chaque mot pour la vraie définition de la chose, c’est proprement dire qu’il expliquera les pensées des anciens en prenant leurs paroles en autre sens qu’ils ne les ont jamais prises, ce qui répugne ;
Correspondance, année 1638, AU R. P. MERSENNE, 27 mai 1638. (Les éditions contemporaines datent cette lettre du 17 mai 1638).
comme je pourrais démontrer que même la définition du centre de gravité qui a été démontrée par Archimède est fausse, et qu’il n’y a point de tel centre ;
Correspondance, année 1638, RÉPONSE DE Monsieur DESCARTES A Monsieur MORIN, 13 juillet 1638.
car, pour la matière, vous le fondez sur une définition de la lumière que vous supposez que j’ai donnée, bien qu’il soit très vrai que je n’ai eu intention d’en donner aucune, comme j’ai assez témoigné dès la page 3, et vous l’avez aussi assez reconnu.
Ou si voulez qu’il soit premier qu’elle, ce sera seulement en même façon que l’homme est premier que sa raison, en tant qu’il doit être ou exister, avant qu’il puisse en user, et ainsi votre seconde conséquence, qui est que le soleil da sa nature n’aura donc point de lumière, ou que sa lumière n’est pas comprise en ma définition ;
et qu’elle est première que celle que je définis, me semble être de même nature que si de ce qu’on aurait dit que l’homme par sa raison découvre beaucoup de vérités, vous infériez qu’il n’a donc point de raison de sa nature, ou que sa raison n’est pas comprise en cette définition, etc.
Correspondance, année 1639, Au R. P. MERSENNE, 9 janvier 1639.
car après avoir démontré (comme je pense avoir fait) qu’il n’y a point de centre de gravité dans les corps selon la définition des anciens, je le devais définir d’une autre façon, auparavant que de dire quel il est en une sphère.
mais je ne lui saurais donner aucune définition suivant laquelle on puisse dire qu’il en soit si proche que le met Monsieur des Argues.
Correspondance, année 1645, A MADAME ÉLISABETH, PRINCESSE PALATINE, etc, 15 mai 1645 (Les éditions contemporaines datent cette lettre du 18 août 1645.).
la première est qu’il tâche d’expliquer ce que c’est que le souverain bien, et qu’il en donne diverses définitions ;
Aux quatrième et cinquième chapitre, il donne quelques autres définitions du souverain bien, qui ont toutes quelque rapport avec le sens de la première, mais aucune desquelles ne l’explique suffisamment ;
Correspondance, année 1645, A Monsieur REGIUS, 15 juillet 1645.
J’avoue qu’on peut les proposer par définitions et par divisions, en descendant du général au particulier, mais alors il faut les appuyer de preuves ;
Pour les autres, lisant vos conclusions sans preuves, et diverses définitions tout à fait paradoxes, dans lesquelles vous faites mention de globules éthérés, et autres choses semblables que vous n’avez expliquées nulle part, ils se moqueront d’elles et les mépriseront :
Correspondance, année 1647, A Monsieur CHANUT, 1er février 1647.
Mais, parce que les philosophes n’ont pas coutume de donner divers noms aux choses qui conviennent en une même définition, et que je ne sais point d’autre définition de l’amour, sinon qu’elle est une passion qui nous fait joindre de volonté à quelque objet, sans distinguer si cet objet est égal, ou plus grand, ou moindre que nous, il me semble que, pour parler leur langue, je dois dire qu’on peut aimer Dieu.
Car en considérant les définitions de ces deux passions, je juge que l’amour que nous avons pour un objet qui ne le mérite pas, nous peut rendre pires que ne fait la haine que nous avons pour un autre que nous devrions aimer ;
Correspondance, année 1649, REPONSE DE Monsieur DESCARTES A Monsieur MORUS, 5 février 1649.
Votre première difficulté est sur la définition du corps, que j’appelle une substance étendue, et que vous aimeriez mieux nommer une substance sensible, tactile, ou impénétrable ;
Ainsi votre définition est plus étendue que le défini.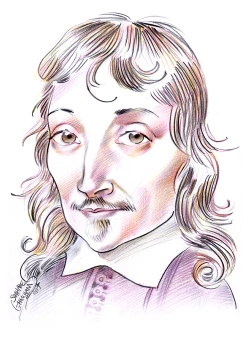
«
que je n'ai eu intention d'en donner aucune, comme j'ai assez témoigné dès la page 3, et vous l'avez aussi assez reconnu.
Ou si voulez qu'il soit premier qu'elle, ce sera seulement en même façon que l'homme est premier que sa raison, en tant qu'il doitêtre ou exister, avant qu'il puisse en user, et ainsi votre seconde conséquence, qui est que le soleil da sa nature n'aura donc pointde lumière, ou que sa lumière n'est pas comprise en ma définition ;
et qu'elle est première que celle que je définis, me semble être de même nature que si de ce qu'on aurait dit que l'homme par saraison découvre beaucoup de vérités, vous infériez qu'il n'a donc point de raison de sa nature, ou que sa raison n'est pascomprise en cette définition, etc.
Correspondance, année 1639, Au R.
P.
MERSENNE, 9 janvier 1639. car après avoir démontré (comme je pense avoir fait) qu'il n'y a point de centre de gravité dans les corps selon la définition desanciens, je le devais définir d'une autre façon, auparavant que de dire quel il est en une sphère. mais je ne lui saurais donner aucune définition suivant laquelle on puisse dire qu'il en soit si proche que le met Monsieur desArgues. Correspondance, année 1645, A MADAME ÉLISABETH, PRINCESSE PALATINE, etc, 15 mai 1645 (Les éditions contemporaines datent cette lettre du 18 août 1645.). la première est qu'il tâche d'expliquer ce que c'est que le souverain bien, et qu'il en donne diverses définitions ; Aux quatrième et cinquième chapitre, il donne quelques autres définitions du souverain bien, qui ont toutes quelque rapport avecle sens de la première, mais aucune desquelles ne l'explique suffisamment ; Correspondance, année 1645, A Monsieur REGIUS, 15 juillet 1645. J'avoue qu'on peut les proposer par définitions et par divisions, en descendant du général au particulier, mais alors il faut lesappuyer de preuves ; Pour les autres, lisant vos conclusions sans preuves, et diverses définitions tout à fait paradoxes, dans lesquelles vous faitesmention de globules éthérés, et autres choses semblables que vous n'avez expliquées nulle part, ils se moqueront d'elles et lesmépriseront : Correspondance, année 1647, A Monsieur CHANUT, 1 er février 1647. Mais, parce que les philosophes n'ont pas coutume de donner divers noms aux choses qui conviennent en une même définition,et que je ne sais point d'autre définition de l'amour, sinon qu'elle est une passion qui nous fait joindre de volonté à quelque objet,sans distinguer si cet objet est égal, ou plus grand, ou moindre que nous, il me semble que, pour parler leur langue, je dois direqu'on peut aimer Dieu. Car en considérant les définitions de ces deux passions, je juge que l'amour que nous avons pour un objet qui ne le mérite pas,nous peut rendre pires que ne fait la haine que nous avons pour un autre que nous devrions aimer ; Correspondance, année 1649, REPONSE DE Monsieur DESCARTES A Monsieur MORUS, 5 février 1649. Votre première difficulté est sur la définition du corps, que j'appelle une substance étendue, et que vous aimeriez mieux nommerune substance sensible, tactile, ou impénétrable ; Ainsi votre définition est plus étendue que le défini.. »
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- PASSIONS DE L’ÂME (LES) ou TRAITÉ DES PASSIONS, René Descartes - résumé de l'oeuvre
- LETTRES A LA PRINCESSE ÉLISABETH, de 1643 à 1649. René Descartes - résumé de l'oeuvre
- PRINCIPES DE LA PHILOSOPHIE (Les) René Descartes (résumé et analyse de l’oeuvre)
- DESCARTES René : sa vie et son oeuvre et fiches de lecture
- L'OEUVRE SCIENTIFIQUE DE DESCARTES