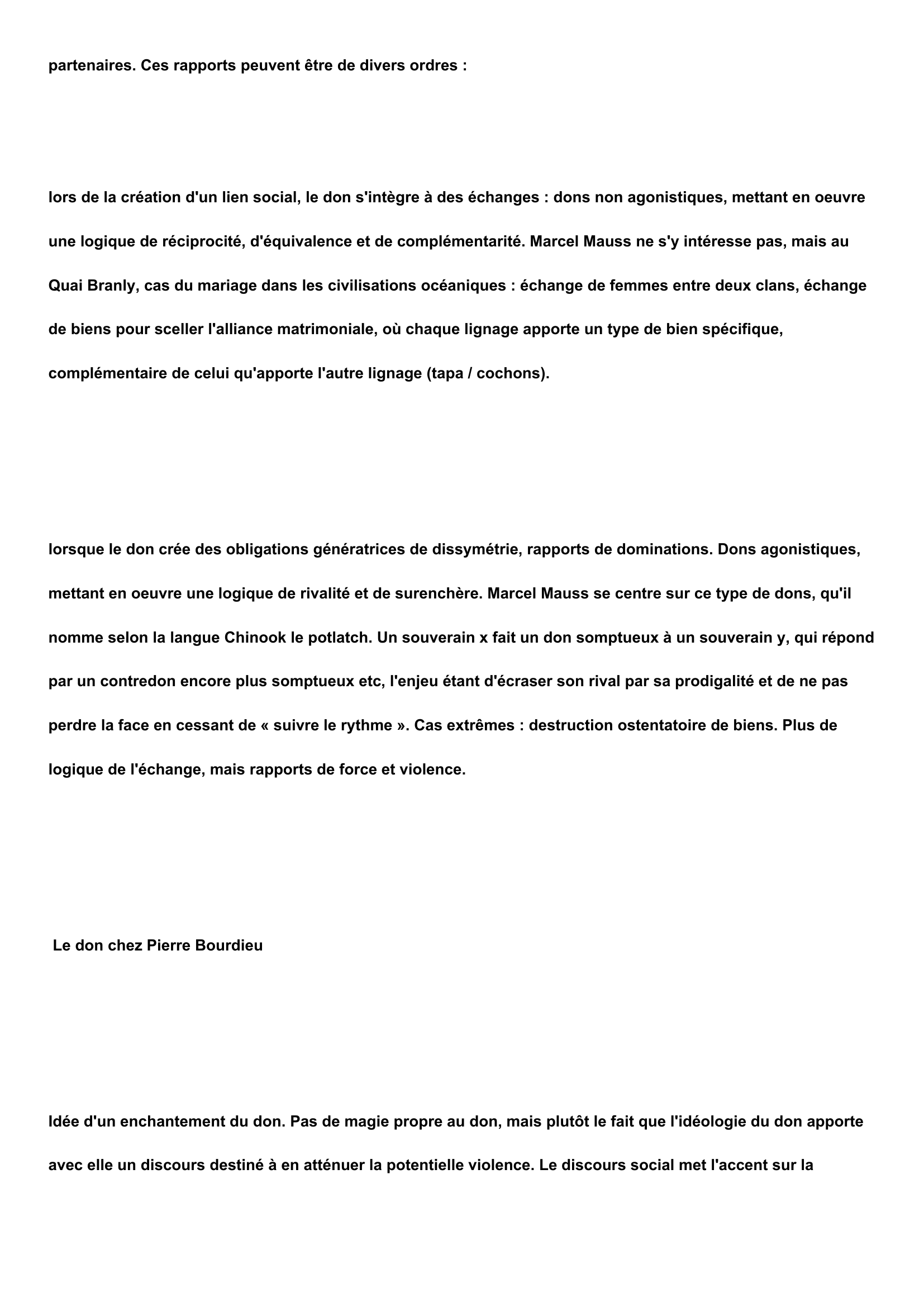Le don
Publié le 29/04/2013
Extrait du document


«
partenaires.
Ces rapports peuvent être de divers ordres :
lors de la création d'un lien social, le don s'intègre à des échanges : dons non agonistiques, mettant en oeuvre
une logique de réciprocité, d'équivalence et de complémentarité.
Marcel Mauss ne s'y intéresse pas, mais au
Quai Branly, cas du mariage dans les civilisations océaniques : échange de femmes entre deux clans, échange
de biens pour sceller l'alliance matrimoniale, où chaque lignage apporte un type de bien spécifique,
complémentaire de celui qu'apporte l'autre lignage (tapa / cochons).
lorsque le don crée des obligations génératrices de dissymétrie, rapports de dominations.
Dons agonistiques,
mettant en oeuvre une logique de rivalité et de surenchère.
Marcel Mauss se centre sur ce type de dons, qu'il
nomme selon la langue Chinook le potlatch.
Un souverain x fait un don somptueux à un souverain y, qui répond
par un contredon encore plus somptueux etc, l'enjeu étant d'écraser son rival par sa prodigalité et de ne pas
perdre la face en cessant de « suivre le rythme ».
Cas extrêmes : destruction ostentatoire de biens.
Plus de
logique de l'échange, mais rapports de force et violence.
Le don chez Pierre Bourdieu
Idée d'un enchantement du don.
Pas de magie propre au don, mais plutôt le fait que l'idéologie du don apporte
avec elle un discours destiné à en atténuer la potentielle violence.
Le discours social met l'accent sur la.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L’éloquence est elle un don ou le produit d’un apprentissage ?
- don/contre don et dette de Paul Fustier et de Marcel Mauss
- Aimer dans Don Juan
- Galilée lettre à don Benedetto Castelli (commentaire)
- Corrigé commentaire composé Don Juan Acte 1, Scène 2