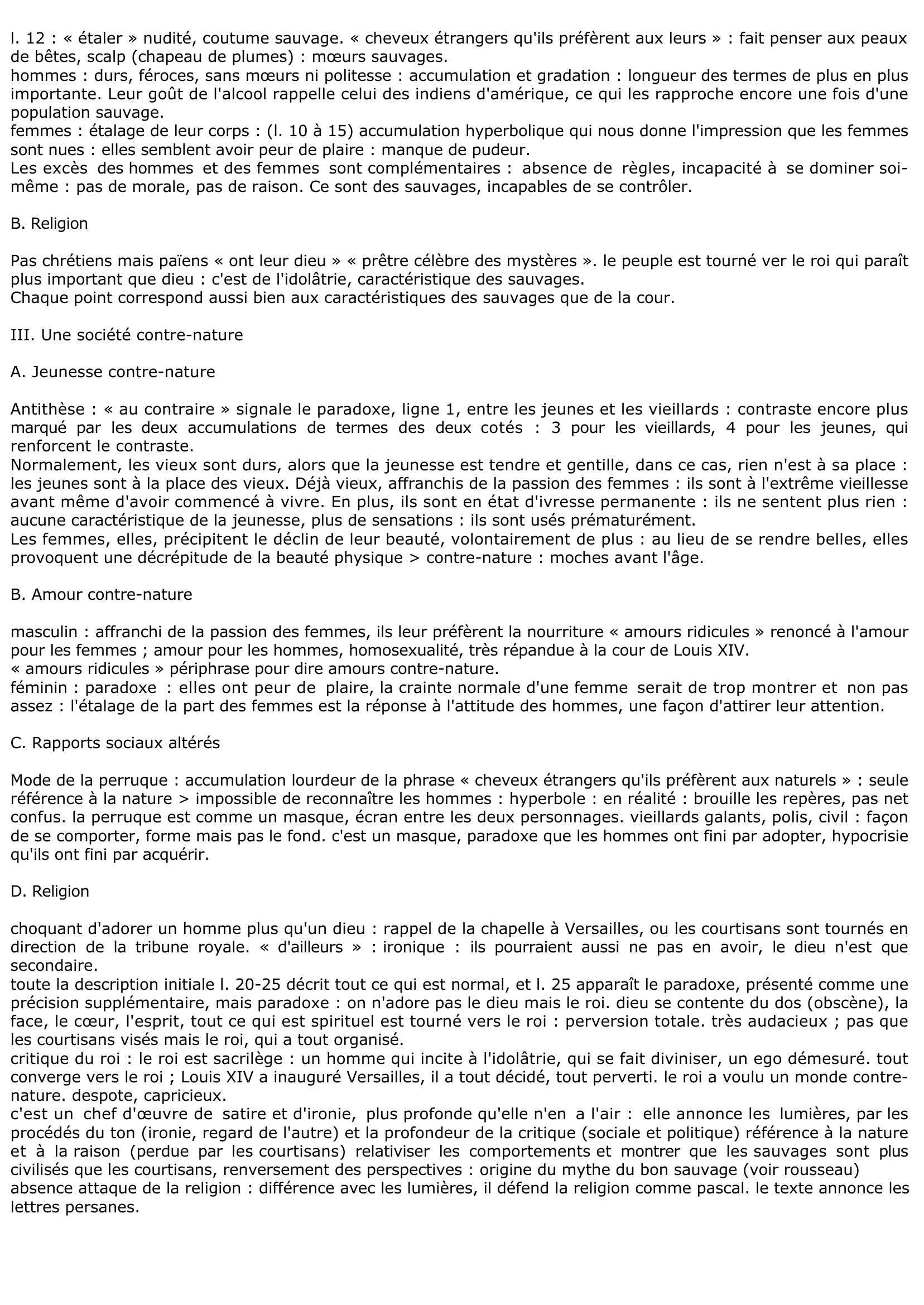LA BRUYERE: section 8, « De la cour »
Publié le 29/07/2010
Extrait du document
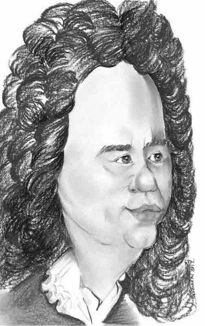
Dans cet extrait, la Bruyère décrit Versailles comme un pays sauvage et lointain alors qu’il s’agit de la cour de France, un lieu qui devrait être un sommet de civilisation. Il utilise le point de vue d’un étranger (repris par Montesquieu), il cherche à montrer les réalités proches par les yeux d’un étranger pour permettre au lecteur un jugement objectif. Procédé d’aliénation. Jean de la Bruyère (1645-1696) c’est un contemporain de Louis XIV, il compose une œuvre unique (sa seule œuvre) « Les caractères « (ou « Les Mœurs de ce Siècle «) première édition en 1688. imitation, reprise de Théophraste, disciple d’Aristote, qui avait cherché de faire un portrait de différents caractères humains. La Bruyère : imitateur de Théophraste, mais les portraits réalisés sont bien plus satiriques que le texte grec. Réflexion sur les types humains et leurs défauts. La Bruyère est un moraliste. Passages dédiés à la société, à la politique, à la religion. Le texte étudié appartient à la section 8, « De la cour « : traite du comportement des grands et critique le roi. I. Procédés de mise à distance A. Indéfini B. Relation d’un voyage C. Description du pays II. Pays de sauvages A. Habitudes scandaleuses B. Religion III. Une société contre-nature A. Jeunesse contre-nature B. Amour contre-nature C. Rapports sociaux altérés I. Procédés de mise à distance A. Indéfini Aucune réalité n’est nommée précisément dans le texte : le pays même n’a pas de nom : tout est très vague : ce pays, cette région « les gens du pays le nomment *** « : effet de mystère, on ne précise pas, on ne cite pas. On répète sans cesse « ce pays « sans jamais le nommer, donne l’impression de parler d’une région inconnue (chose parfaitement plausible à l’époque, il existait encore des régions inexplorées). Il utilise des démonstratifs et des possessifs qui accentuent la mise à distance : leur roi, leur dieu (parfaitement déplacé, étant donné que l’auteur est également catholique). Il utilise des périphrases qui changent la vision du lecteur, qui l’éloignent de ses repères habituels : il ne dit pas maquiller, il dit peindre. B. Le texte se présente comme une relation de voyage. Les récits de voyages sont très fréquents et populaires à l’époque, ils décrivent les contrées lointaines. Ici, pastiche de récit de voyage, on le voit au plan du texte : d’abord une description d’ordre général (pays, physionomie, coutumes) ; on procède par catégories de population (vieux, jeunes hommes, femmes) puis à partir de la ligne 19, deuxième partie, religions et institutions politiques. (roi, dieu peuple : hiérarchie insensée). A l’époque, ce type de texte tenait lieu d’images ; C. Description du pays Précision des chiffres, des termes techniques, on prend pour repère des lieux connus. Il y a un narrateur, présent partout, qui porte son regard sur un peuple étranger, surpris, étonné, choqué et très critique. Il prend sans cesse ses distances, car il se sent différent : déterminants et pronoms, leurs, eux. Il ne se contente pas de décrire, il ajoute des explications : il ne partage pas l’avis de la population. Interprétation > Jugement > Condamnation Il donne à la perruque un effet négatif car il interprète son utilisation de façon négative (ligne 16 à 19). Subordination du dieu au roi : absolument choquante : le narrateur se cache derrière les faits : il n’a même plus besoin de porter jugement. Mise à distance : « l’on parle d’une région « : on dirait qu’il n’y a pas été « Iroquois « : lointains, sauvages, déconnectés de la réalité du lecteur « deux mers « : deux fois plus loin : effet de mise a distance mais aussi ironie : deux fois plus loin mais la terre est ronde donc on revient très proche. II. Pays de sauvages A. Habitudes Scandaleuses l. 12 : « étaler « nudité, coutume sauvage. « cheveux étrangers qu’ils préfèrent aux leurs « : fait penser aux peaux de bêtes, scalp (chapeau de plumes) : mœurs sauvages. hommes : durs, féroces, sans mœurs ni politesse : accumulation et gradation : longueur des termes de plus en plus importante. Leur goût de l’alcool rappelle celui des indiens d’amérique, ce qui les rapproche encore une fois d’une population sauvage. femmes : étalage de leur corps : (l. 10 à 15) accumulation hyperbolique qui nous donne l’impression que les femmes sont nues : elles semblent avoir peur de plaire : manque de pudeur. Les excès des hommes et des femmes sont complémentaires : absence de règles, incapacité à se dominer soi-même : pas de morale, pas de raison. Ce sont des sauvages, incapables de se contrôler. B. Religion Pas chrétiens mais païens « ont leur dieu « « prêtre célèbre des mystères «. le peuple est tourné ver le roi qui paraît plus important que dieu : c’est de l’idolâtrie, caractéristique des sauvages. Chaque point correspond aussi bien aux caractéristiques des sauvages que de la cour. III. Une société contre-nature A. Jeunesse contre-nature Antithèse : « au contraire « signale le paradoxe, ligne 1, entre les jeunes et les vieillards : contraste encore plus marqué par les deux accumulations de termes des deux cotés : 3 pour les vieillards, 4 pour les jeunes, qui renforcent le contraste. Normalement, les vieux sont durs, alors que la jeunesse est tendre et gentille, dans ce cas, rien n’est à sa place : les jeunes sont à la place des vieux. Déjà vieux, affranchis de la passion des femmes : ils sont à l’extrême vieillesse avant même d’avoir commencé à vivre. En plus, ils sont en état d’ivresse permanente : ils ne sentent plus rien : aucune caractéristique de la jeunesse, plus de sensations : ils sont usés prématurément. Les femmes, elles, précipitent le déclin de leur beauté, volontairement de plus : au lieu de se rendre belles, elles provoquent une décrépitude de la beauté physique > contre-nature : moches avant l’âge. B. Amour contre-nature masculin : affranchi de la passion des femmes, ils leur préfèrent la nourriture « amours ridicules « renoncé à l’amour pour les femmes ; amour pour les hommes, homosexualité, très répandue à la cour de Louis XIV. « amours ridicules « périphrase pour dire amours contre-nature. féminin : paradoxe : elles ont peur de plaire, la crainte normale d’une femme serait de trop montrer et non pas assez : l’étalage de la part des femmes est la réponse à l’attitude des hommes, une façon d’attirer leur attention. C. Rapports sociaux altérés Mode de la perruque : accumulation lourdeur de la phrase « cheveux étrangers qu’ils préfèrent aux naturels « : seule référence à la nature > impossible de reconnaître les hommes : hyperbole : en réalité : brouille les repères, pas net confus. la perruque est comme un masque, écran entre les deux personnages. vieillards galants, polis, civil : façon de se comporter, forme mais pas le fond. c’est un masque, paradoxe que les hommes ont fini par adopter, hypocrisie qu’ils ont fini par acquérir. D. Religion choquant d’adorer un homme plus qu’un dieu : rappel de la chapelle à Versailles, ou les courtisans sont tournés en direction de la tribune royale. « d’ailleurs « : ironique : ils pourraient aussi ne pas en avoir, le dieu n’est que secondaire. toute la description initiale l. 20-25 décrit tout ce qui est normal, et l. 25 apparaît le paradoxe, présenté comme une précision supplémentaire, mais paradoxe : on n’adore pas le dieu mais le roi. dieu se contente du dos (obscène), la face, le cœur, l’esprit, tout ce qui est spirituel est tourné vers le roi : perversion totale. très audacieux ; pas que les courtisans visés mais le roi, qui a tout organisé. critique du roi : le roi est sacrilège : un homme qui incite à l’idolâtrie, qui se fait diviniser, un ego démesuré. tout converge vers le roi ; Louis XIV a inauguré Versailles, il a tout décidé, tout perverti. le roi a voulu un monde contre-nature. despote, capricieux. c’est un chef d’œuvre de satire et d’ironie, plus profonde qu’elle n’en a l’air : elle annonce les lumières, par les procédés du ton (ironie, regard de l’autre) et la profondeur de la critique (sociale et politique) référence à la nature et à la raison (perdue par les courtisans) relativiser les comportements et montrer que les sauvages sont plus civilisés que les courtisans, renversement des perspectives : origine du mythe du bon sauvage (voir rousseau) absence attaque de la religion : différence avec les lumières, il défend la religion comme pascal. le texte annonce les lettres persanes.
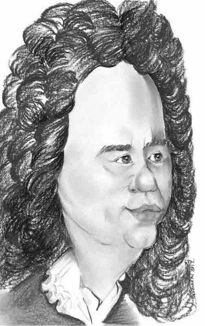
«
l.
12 : « étaler » nudité, coutume sauvage.
« cheveux étrangers qu'ils préfèrent aux leurs » : fait penser aux peauxde bêtes, scalp (chapeau de plumes) : mœurs sauvages.hommes : durs, féroces, sans mœurs ni politesse : accumulation et gradation : longueur des termes de plus en plusimportante.
Leur goût de l'alcool rappelle celui des indiens d'amérique, ce qui les rapproche encore une fois d'unepopulation sauvage.femmes : étalage de leur corps : (l.
10 à 15) accumulation hyperbolique qui nous donne l'impression que les femmessont nues : elles semblent avoir peur de plaire : manque de pudeur.Les excès des hommes et des femmes sont complémentaires : absence de règles, incapacité à se dominer soi-même : pas de morale, pas de raison.
Ce sont des sauvages, incapables de se contrôler.
B.
Religion
Pas chrétiens mais païens « ont leur dieu » « prêtre célèbre des mystères ».
le peuple est tourné ver le roi qui paraîtplus important que dieu : c'est de l'idolâtrie, caractéristique des sauvages.Chaque point correspond aussi bien aux caractéristiques des sauvages que de la cour.
III.
Une société contre-nature
A.
Jeunesse contre-nature
Antithèse : « au contraire » signale le paradoxe, ligne 1, entre les jeunes et les vieillards : contraste encore plusmarqué par les deux accumulations de termes des deux cotés : 3 pour les vieillards, 4 pour les jeunes, quirenforcent le contraste.Normalement, les vieux sont durs, alors que la jeunesse est tendre et gentille, dans ce cas, rien n'est à sa place :les jeunes sont à la place des vieux.
Déjà vieux, affranchis de la passion des femmes : ils sont à l'extrême vieillesseavant même d'avoir commencé à vivre.
En plus, ils sont en état d'ivresse permanente : ils ne sentent plus rien :aucune caractéristique de la jeunesse, plus de sensations : ils sont usés prématurément.Les femmes, elles, précipitent le déclin de leur beauté, volontairement de plus : au lieu de se rendre belles, ellesprovoquent une décrépitude de la beauté physique > contre-nature : moches avant l'âge.
B.
Amour contre-nature
masculin : affranchi de la passion des femmes, ils leur préfèrent la nourriture « amours ridicules » renoncé à l'amourpour les femmes ; amour pour les hommes, homosexualité, très répandue à la cour de Louis XIV.« amours ridicules » périphrase pour dire amours contre-nature.féminin : paradoxe : elles ont peur de plaire, la crainte normale d'une femme serait de trop montrer et non pasassez : l'étalage de la part des femmes est la réponse à l'attitude des hommes, une façon d'attirer leur attention.
C.
Rapports sociaux altérés
Mode de la perruque : accumulation lourdeur de la phrase « cheveux étrangers qu'ils préfèrent aux naturels » : seuleréférence à la nature > impossible de reconnaître les hommes : hyperbole : en réalité : brouille les repères, pas netconfus.
la perruque est comme un masque, écran entre les deux personnages.
vieillards galants, polis, civil : façonde se comporter, forme mais pas le fond.
c'est un masque, paradoxe que les hommes ont fini par adopter, hypocrisiequ'ils ont fini par acquérir.
D.
Religion
choquant d'adorer un homme plus qu'un dieu : rappel de la chapelle à Versailles, ou les courtisans sont tournés endirection de la tribune royale.
« d'ailleurs » : ironique : ils pourraient aussi ne pas en avoir, le dieu n'est quesecondaire.toute la description initiale l.
20-25 décrit tout ce qui est normal, et l.
25 apparaît le paradoxe, présenté comme uneprécision supplémentaire, mais paradoxe : on n'adore pas le dieu mais le roi.
dieu se contente du dos (obscène), laface, le cœur, l'esprit, tout ce qui est spirituel est tourné vers le roi : perversion totale.
très audacieux ; pas queles courtisans visés mais le roi, qui a tout organisé.critique du roi : le roi est sacrilège : un homme qui incite à l'idolâtrie, qui se fait diviniser, un ego démesuré.
toutconverge vers le roi ; Louis XIV a inauguré Versailles, il a tout décidé, tout perverti.
le roi a voulu un monde contre-nature.
despote, capricieux.c'est un chef d'œuvre de satire et d'ironie, plus profonde qu'elle n'en a l'air : elle annonce les lumières, par lesprocédés du ton (ironie, regard de l'autre) et la profondeur de la critique (sociale et politique) référence à la natureet à la raison (perdue par les courtisans) relativiser les comportements et montrer que les sauvages sont pluscivilisés que les courtisans, renversement des perspectives : origine du mythe du bon sauvage (voir rousseau)absence attaque de la religion : différence avec les lumières, il défend la religion comme pascal.
le texte annonce leslettres persanes..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- "La BRUYERE - De la Cour ", 74 (1re Édition)
- Résumé : "LES CARACTERES" (De la Cour - Des Grands) de LA BRUYERE
- commentaire: De la cour de La bruyère in les "Caractères"
- commentaire d'arrêt cour de cassation 12 novembre 2020
- commentaire La cour du lion