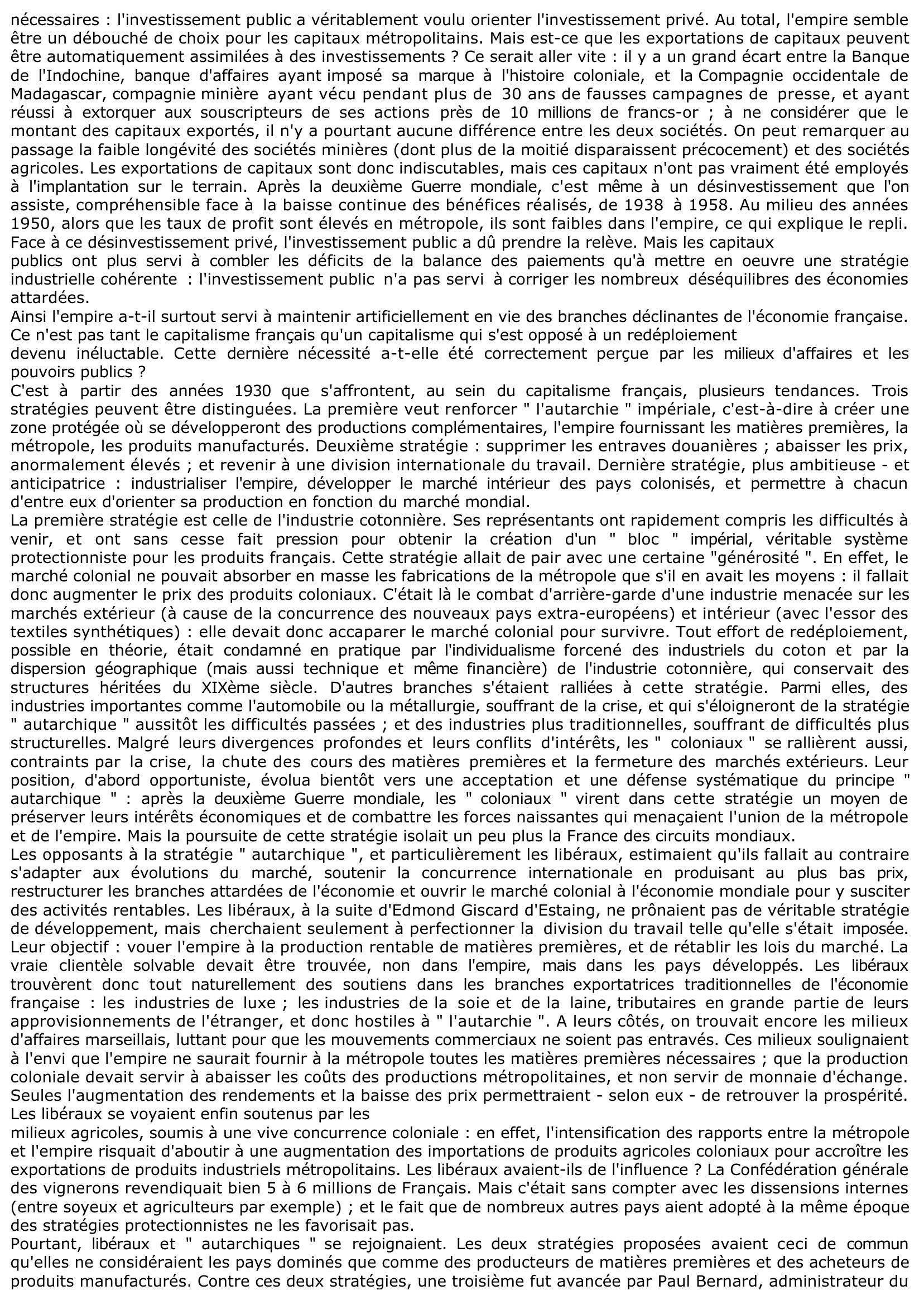Jacques Marseilles, Empire colonial et capitalisme français
Publié le 25/04/2011

Extrait du document
Dans les années 1950, la France s'est séparée de son empire colonial, qui représentait pourtant plus du tiers de ses échanges commerciaux, et la quasi-totalité de ses investissements extérieurs. Néanmoins, la croissance française ne semble pas avoir été grandement affectée par ce bouleversement. Ce constat paradoxal soulève plusieurs questions. La colonisation a-t-elle vraiment été profitable à la France ? L'empire colonial fut-il pour le capitalisme français un moteur, ou plutôt un frein ? Avant toute chose, il faut déjà discerner le vrai du faux dans le bilan colonial de la France. Marseille souligne d'abord les inconvénients de l'approche historique classique de la colonisation, trop concentrée sur des aspects politiques. Elle est aussi critiquable parce qu'elle insiste sur le faible poids des empires coloniaux dans le commerce et les investissements métropolitains avant 1914, et néglige totalement le rôle croissant qu'ont joué les empires après la première Guerre mondiale. L'approche marxiste-léniniste se montre relativement plus adéquate. Elle propose d'autres explications du phénomène impérialiste, et met notamment en cause le capital financier, c'est-à-dire la concentration croissante des entreprises, qui finit par donner aux banques un poids prédominant. Ce stade suprême du capitalisme étant atteint, Hilferding estimait qu'il n'y avait plus qu'à obtenir de nouveaux débouchés pour stimuler la demande et retrouver la prospérité. Plus généralement, les auteurs marxistes soutiennent que la mauvaise distribution du pouvoir d'achat dans la société crée la sous-consommation, poussant ainsi les entreprises à étendre leur domination, surtout sur des pays sous-développés où les profits à réaliser sont plus élevés. Mais à trop souligner le poids commercial et financier croissant de l'empire, on oublie que sa perte n'a pas eu de conséquences néfastes. Au contraire, la métropole a connu à cette époque un dynamisme et une croissance sans précédents. Comment expliquer ce contraste ? L'empire était un partenaire commercial essentiel : cela semble acquis au vu des chiffres. En 1952, la zone franc absorbe plus de 42 % des exportations de la métropole. Dès 1902, l'empire devient le second partenaire commercial de la France, avant de devenir son premier partenaire de 1928 jusqu'à la décolonisation. L'empire est, il est vrai, un partenaire de choix, ses relations avec la métropole étant stables (et pour cause !). Il joue même un rôle d'amortisseur pour le commerce métropolitain, lorsque la conjoncture devient plus difficile. Les pourcentages globaux soulignent le poids de l'empire pour le capitalisme français, mais masquent les écarts existant entre ses diverses branches. Ainsi, en 1906, les exportations vers l'empire ne représentaient que 11 % du total des exportations françaises ; mais pour les tisseurs de coton, l'empire représentait la même année prèsde 85 % de leurs exportations. De même, la métropole ne réalise que 9 % de ses importations en provenance de l'empire, mais en importe la quasi-totalité de ses matières premières agricoles et de ses phosphates. Le poids du débouché colonial pour certaines branches de l'économie française semble donc considérable. Mais son expansion ne préjuge en rien de sa contribution à la croissance économique du pays. Le marché colonial a-t-il vraiment servi les intérêts métropolitains ? Certes, si l'on observe la balance commerciale entre la France et son empire sur le long terme, on peut constater que l'empire a joué un rôle de " réservoir " en période de mauvaise conjoncture, et un rôle de débouché en période de bonne conjoncture. Pourtant, dès la fin des années 1920, on remet déjà en question la politique de mise en valeur de l'empire. Dressons un bilan : les importations de la métropole sont essentiellement constituées de produits alimentaires tropicaux, et de matières premières dont il n'y a pas de pénurie dans le monde à cette époque ; et la France achète à des prix supérieurs aux prix mondiaux des produits dont le poids global va diminuant. Pire, les exportations entre la France et son empire se révèlent indirectement onéreuses pour elle : en effet, les achats effectués par les pays de la zone Franc sont en partie réalisés grâce à l'aide et aux dons de la métropole... Les termes de l'échange sont donc souvent défavorables à la métropole. Le constat est d'autant plus accablant que la protection des marchés coloniaux permet de vendre des produits médiocres à des prix surélevés, ce qui nuit à la compétitivité des entreprises métropolitaines. Prenons deux exemples de branches, deux destins différents : l'industrie cotonnière et l'industrie métallurgique. Toutes deux se sont repliées sur le marché colonial pendant la crise des années 1930. Mais s'il s'agissait pour l'industrie métallurgique d'un repli conjoncturel, pour l'industrie cotonnière, il s'agissait bien d'un repli structurel. Il est significatif de noter que lorsque le déclin de l'industrie cotonnière s'est amorcé, la part de ses ventes sur le marché colonial a atteint 90 %. Le débouché colonial a vraisemblablement permis de freiner le déclin d'une industrie en perte de vitesse, et a ralenti l'évolution de la structure des exportations françaises, pénalisant ainsi la France par rapport à d'autres pays européens. Apprécier le rôle du débouché colonial à l'aune des pourcentages de ventes dans l'empire ne suffit donc pas : le coeur du problème, c'est la compétitivité des industries qui réalisent ces ventes. On peut généraliser ce constat : le débouché colonial a été accaparé par des branches déclinantes de l'économie française et délaissé par ses branches les plus dynamiques, qui avaient pour débouchés principaux les marchés des pays industriels. Une objection sérieuse peut toutefois être soulevée : pourquoi se restreindre à l'étude du commerce entre la métropole et son empire ? Ne considérer que le commerce, c'est en effet oublier les investissements extérieurs. Or que constate-t-on ? L'empire colonial est un placement privilégié : en 1914, si l'on excepte la Russie, l'empire est au deuxième rang des investissements extérieurs de la France. Si l'investissement dans l'empire représente en 1929 un tiers environ de l'investissement extérieur total, en 1939, sa part s'élève à presque 50 %, grâce à la croissance de l'investissement public. L'empire apparaît donc comme un champ commode d'investissement pour les entreprises, offrant sécurité et taux de profit élevés, d'autant plus que l'Etat n'a pas hésité à intervenir pour soutenir - au besoin relancer - l'investissement privé. C'est l'Etat qui a défriché le terrain, créé les infrastructures économiques nécessaires : l'investissement public a véritablement voulu orienter l'investissement privé. Au total, l'empire semble être un débouché de choix pour les capitaux métropolitains. Mais est-ce que les exportations de capitaux peuvent être automatiquement assimilées à des investissements ? Ce serait aller vite : il y a un grand écart entre la Banque de l'Indochine, banque d'affaires ayant imposé sa marque à l'histoire coloniale, et la Compagnie occidentale de Madagascar, compagnie minière ayant vécu pendant plus de 30 ans de fausses campagnes de presse, et ayant réussi à extorquer aux souscripteurs de ses actions près de 10 millions de francs-or ; à ne considérer que le montant des capitaux exportés, il n'y a pourtant aucune différence entre les deux sociétés. On peut remarquer au passage la faible longévité des sociétés minières (dont plus de la moitié disparaissent précocement) et des sociétés agricoles. Les exportations de capitaux sont donc indiscutables, mais ces capitaux n'ont pas vraiment été employés à l'implantation sur le terrain. Après la deuxième Guerre mondiale, c'est même à un désinvestissement que l'on assiste, compréhensible face à la baisse continue des bénéfices réalisés, de 1938 à 1958. Au milieu des années 1950, alors que les taux de profit sont élevés en métropole, ils sont faibles dans l'empire, ce qui explique le repli. Face à ce désinvestissement privé, l'investissement public a dû prendre la relève. Mais les capitaux publics ont plus servi à combler les déficits de la balance des paiements qu'à mettre en oeuvre une stratégie industrielle cohérente : l'investissement public n'a pas servi à corriger les nombreux déséquilibres des économies attardées. Ainsi l'empire a-t-il surtout servi à maintenir artificiellement en vie des branches déclinantes de l'économie française. Ce n'est pas tant le capitalisme français qu'un capitalisme qui s'est opposé à un redéploiement devenu inéluctable. Cette dernière nécessité a-t-elle été correctement perçue par les milieux d'affaires et les pouvoirs publics ? C'est à partir des années 1930 que s'affrontent, au sein du capitalisme français, plusieurs tendances. Trois stratégies peuvent être distinguées. La première veut renforcer " l'autarchie " impériale, c'est-à-dire à créer une zone protégée où se développeront des productions complémentaires, l'empire fournissant les matières premières, la métropole, les produits manufacturés. Deuxième stratégie : supprimer les entraves douanières ; abaisser les prix, anormalement élevés ; et revenir à une division internationale du travail. Dernière stratégie, plus ambitieuse - et anticipatrice : industrialiser l'empire, développer le marché intérieur des pays colonisés, et permettre à chacun d'entre eux d'orienter sa production en fonction du marché mondial. La première stratégie est celle de l'industrie cotonnière. Ses représentants ont rapidement compris les difficultés à venir, et ont sans cesse fait pression pour obtenir la création d'un " bloc " impérial, véritable système protectionniste pour les produits français. Cette stratégie allait de pair avec une certaine "générosité ". En effet, le marché colonial ne pouvait absorber en masse les fabrications de la métropole que s'il en avait les moyens : il fallait donc augmenter le prix des produits coloniaux. C'était là le combat d'arrière-garde d'une industrie menacée sur les marchés extérieur (à cause de la concurrence des nouveaux pays extra-européens) et intérieur (avec l'essor des textiles synthétiques) : elle devait donc accaparer le marché colonial pour survivre. Tout effort de redéploiement, possible en théorie, était condamné en pratique par l'individualisme forcené des industriels du coton et par la dispersion géographique (mais aussi technique et même financière) de l'industrie cotonnière, qui conservait des structures héritées du XIXème siècle. D'autres branches s'étaient ralliées à cette stratégie. Parmi elles, des industries importantes comme l'automobile ou la métallurgie, souffrant de la crise, et qui s'éloigneront de la stratégie " autarchique " aussitôt les difficultés passées ; et des industries plus traditionnelles, souffrant de difficultés plus structurelles. Malgré leurs divergences profondes et leurs conflits d'intérêts, les " coloniaux " se rallièrent aussi, contraints par la crise, la chute des cours des matières premières et la fermeture des marchés extérieurs. Leur position, d'abord opportuniste, évolua bientôt vers une acceptation et une défense systématique du principe " autarchique " : après la deuxième Guerre mondiale, les " coloniaux " virent dans cette stratégie un moyen de préserver leurs intérêts économiques et de combattre les forces naissantes qui menaçaient l'union de la métropole et de l'empire. Mais la poursuite de cette stratégie isolait un peu plus la France des circuits mondiaux. Les opposants à la stratégie " autarchique ", et particulièrement les libéraux, estimaient qu'ils fallait au contraire s'adapter aux évolutions du marché, soutenir la concurrence internationale en produisant au plus bas prix, restructurer les branches attardées de l'économie et ouvrir le marché colonial à l'économie mondiale pour y susciter des activités rentables. Les libéraux, à la suite d'Edmond Giscard d'Estaing, ne prônaient pas de véritable stratégie de développement, mais cherchaient seulement à perfectionner la division du travail telle qu'elle s'était imposée. Leur objectif : vouer l'empire à la production rentable de matières premières, et de rétablir les lois du marché. La vraie clientèle solvable devait être trouvée, non dans l'empire, mais dans les pays développés. Les libéraux trouvèrent donc tout naturellement des soutiens dans les branches exportatrices traditionnelles de l'économie française : les industries de luxe ; les industries de la soie et de la laine, tributaires en grande partie de leurs approvisionnements de l'étranger, et donc hostiles à " l'autarchie ". A leurs côtés, on trouvait encore les milieux d'affaires marseillais, luttant pour que les mouvements commerciaux ne soient pas entravés. Ces milieux soulignaient à l'envi que l'empire ne saurait fournir à la métropole toutes les matières premières nécessaires ; que la production coloniale devait servir à abaisser les coûts des productions métropolitaines, et non servir de monnaie d'échange. Seules l'augmentation des rendements et la baisse des prix permettraient - selon eux - de retrouver la prospérité. Les libéraux se voyaient enfin soutenus par les milieux agricoles, soumis à une vive concurrence coloniale : en effet, l'intensification des rapports entre la métropole et l'empire risquait d'aboutir à une augmentation des importations de produits agricoles coloniaux pour accroître les exportations de produits industriels métropolitains. Les libéraux avaient-ils de l'influence ? La Confédération générale des vignerons revendiquait bien 5 à 6 millions de Français. Mais c'était sans compter avec les dissensions internes (entre soyeux et agriculteurs par exemple) ; et le fait que de nombreux autres pays aient adopté à la même époque des stratégies protectionnistes ne les favorisait pas. Pourtant, libéraux et " autarchiques " se rejoignaient. Les deux stratégies proposées avaient ceci de commun qu'elles ne considéraient les pays dominés que comme des producteurs de matières premières et des acheteurs de produits manufacturés. Contre ces deux stratégies, une troisième fut avancée par Paul Bernard, administrateur du Crédit mobilier indochinois et de la Société financière française et coloniale. Cette troisième option consistait à industrialiser les colonies, à créer en quelque sorte des économies "autocentrées ", privilégiant le développement d'un marché intérieur par rapport aux activités d'exportation. Selon Paul Bernard, le développement des ventes métropolitaines en Indochine (ou plus généralement : dans l'empire) ne passait pas par une protection douanière accrue, mais bien par l'augmentation du pouvoir d'achat (donc, de la capacité de consommation) des classes les plus nombreuses. Certes, le développement d'une industrie dans les colonies pourrait concurrencer la métropole et certaines de ses entreprises. Mais ce serait, affirme Paul Bernard, " au bénéfice de l'économie générale de l'empire ". Mieux encore : l'industrialisation pouvait servir la puissance française, et réduire le chômage. Entre la nouvelle colonie industrialisée et la métropole, des liens commerciaux anciens ne manqueraient certes pas d'être rompus, mais une colonie industrialisée constituerait assurément un bien meilleur client. Les avantages d'un tel " redéploiement " ne s'arrêtent pas là. Les exportateurs métropolitains pourraient par exemple profiter d'une main-d'oeuvre bon marché et d'impôts plus légers. Ce faisant, abaissant leur prix de revient, ils pourraient plus facilement conquérir les marchés extérieurs. Industrialiser les colonies permettrait encore de fournir aux élites indigènes formées par le colonisateur de nouveaux horizons. Enfin, le tissage de liens d'intérêts si nombreux permettrait d'unifier l'empire et de faire reculer les menaces autonomistes. Mais pourquoi cette troisième stratégie n'a-t-elle pu s'imposer ? La raison en est l'émergence tardive d'un capitalisme financier en France. Apparu trop tardivement, il n'a pu exercer d'influence durable sur l'exploitation de l'empire colonial. Jusqu'en 1938, c'est la vision mercantiliste de Méline qui prévaut au sein des milieux d'affaires, l'idée d'un système exclusif réservant l'empire à la métropole. Ni la première Guerre mondiale, ni les nouvelles prises de participation des banques d'affaires dans l'empire ne parviennent à modifier la situation. La crise des années 1930 persuade les milieux d'affaires que la prospérité ne serait pas retrouvée avant longtemps, et ceux-ci voient dans "l'autarchie " le moyen de pallier des débouchés étrangers devenus inaccessibles. La Conférence économique de la France métropolitaine et d'outre-mer, qui s'ouvre en 1934, décide très clairement de conserver les choses en l'état. La stratégie d'industrialisation finit par être mise en place, mais il faut attendre le régime de Vichy pour cela. Durant cette période, les milieux d'affaires se sont trouvés réunis plus souvent et plus régulièrement, non seulement au sein de leur groupement propre, mais aussi au sein du Comité central des groupements professionnels coloniaux. De plus, l'idée s'est répandue que l'état du monde après-guerre n'autoriserait plus le maintien de " l'autarchie ". Les conceptions qui avaient prévalu depuis les débuts de la colonisation se trouvaient ainsi reniées. Et pourtant, après 1945, la situation avait-elle vraiment tant changé ? La volonté d'établir une nouvelle " mise en valeur " de l'empire avait échoué (à cause du plan Marshall, selon Paul Bernard). L'après-guerre voyait en fait la mise en oeuvre de la stratégie libérale. On revenait au statu quo, à ceci près que " l'autarchie " semblait définitivement exclue, et que l'on songeait sérieusement à ouvrir l'empire à l'extérieur. En définitive, parler d'un patronat français est clairement abusif. C'est négliger les forces multiples et antagonistes qui l'ont animé : une fraction défendait l'attachement exclusif de l'empire à la métropole, une autre se prononçait pour un développement " autocentré " des colonies. Mais cette dernière n'a pu imposer ses vues aux branches du capitalisme français dont la survie était directement en jeu, et qui dépendaient presque totalement du débouché colonial. Les partisans de l'industrialisation des colonies auraient pu l'emporter, mais pour cela, il leur eût fallu le soutien des pouvoirs publics. Or, l'impuissance du patronat à s'accorder et à adopter une stratégie concertée a conféré à l'Etat un rôle considérable d'arbitrage. Toute la question est maintenant de savoir quel usage il en a fait, et à quelles fins. Les rapports entre Etat et capitalisme sont complexes. Si l'on prête attention à l'histoire d'une loi assez ordinaire, comme celle sur les oléagineux d'août 1933, loi issue de la crise des arachides, on peut remarquer l'affrontement entre pouvoirs publics et patrons quant à la stratégie à adopter. Ces derniers demandaient par exemple une baisse de la fiscalité pesant sur le commerce, ce qui n'était, pour l'Etat et les administrateurs locaux, qu'un moyen de prolonger la crise. La discussion de cette loi aux Chambres révéla encore un peu plus les divergences d'intérêts des différents groupes de pression. Les critiques ne se turent pas avec le vote de la loi, et les huiliers se virent bientôt soutenus par les industriels de la laine, bientôt par toutes les branches fortement exportatrices, craignant ce regain de protectionnisme. Face à eux s'érigeaient en défenseurs de la loi du 6 août les cotonniers, les éleveurs... L'arbitrage entre ces différents intérêts était d'autant moins facile que l'administration elle-même était divisée : la détermination du ministère des Colonies à imposer le contingentement se heurtait aux calculs du ministère du Commerce et de l'Industrie : le contingentement fut pourtant imposé en janvier 1934. L'histoire de cette loi souligne l'opposition entre l'argumentation économique des branches exportatrices conscientes du redéploiement à effectuer, et l'argumentation politique des branches ayant tout à perdre dans ce redéploiement. Pour contraindre le pouvoir, " autarchistes " et coloniaux poseront fréquemment cette alternative : choisir la rentabilité des productions coloniales et les troubles sociaux dans les populations indigènes ; ou choisir le calme politique, en créant une zone protégée au mépris des lois du marché. La loi du 6 août 1933 et ses péripéties montrent aussi combien le pouvoir, divisé, fut lent à arrêter sa décision : pas moins de huit mois furent nécessaires. L'Etat avait donc le choix entre deux stratégies bien distinctes, le choix entre une souveraineté politique affermie et un progrès économique assuré. L'Etat a-t-il seulement arrêté son choix, entre ces deux voies ? On peut en douter, à voir la division des pouvoirs publics, les tensions et querelles au sein de l'Etat. La politique économique coloniale a souffert d'immobilisme, surtout à partir des années 1930, précisément en raison de l'éclatement administratif, de l'absence de coordination entre les ministères, qui reflètent au niveau public les différents intérêts privés. Il est encore plus saisissant de voir un ministère être tantôt libre-échangiste, tantôt " autarchiste ", selon les intérêts mis en jeu. Au final, la diversité des intérêts, souvent antagonistes, annule toute dynamique : un Etat impuissant pour des milieux d'affaires impuissants à définir une véritable politique de " mise en valeur " de l'empire... Mais l'impuissance de l'Etat, de la superstructure, ne doit pas cacher le rôle croissant tenu par d'autres instances politiques : les administrations locales, et au premier chef, les Gouverneurs généraux, qui disposaient d'une large liberté d'action. Et ces instances politiques puissantes étaient le plus souvent résolument hostiles aux intérêts privés, comme en témoignent les oppositions survenues entre le Gouvernement général d'Indochine et la Société française des Distilleries de l'Indochine. Contrairement à ce que soutenaient les théoriciens marxistes de l'impérialisme, la domination politique directe des colonies n'offrait donc pas les plus grandes commodités aux intérêts privés. L'instance politique, éclatée, était en outre indécise. On peut remarquer la permanence d'un même type de discours, au fil des années, et quel que soit l'orateur. De Sarraut à Lebrun, de Lyautey à de Gaulle, la constante est le projet d'une France généreuse, soucieuse de tisser avec son empire des liens économiques durables, afin de soutenir la concurrence internationale. On trouve les fondements de cette pensée impériale dans le projet de loi Sarraut de 1921. La loi ne verra jamais le jour, mais le discours inspirera tous ses successeurs, réunissant dans une même approbation les tendances les plus diverses du capitalisme français : cotonniers et soyeux, commerçants et huiliers... Mais ce consensus ne témoigne pas de la modernité courageuse du projet Sarraut. La continuité de ce "grand" projet colonial était aussi - et peut-être surtout - un moyen de différer les choix cruciaux, auxquels était confronté l'Etat depuis la crise des années 1930. Les pouvoirs publics devaient affronter un dilemme : faire des colonies des économies complémentaires, ou les industrialiser - avec les risques qui y étaient inhérents ? Le Front Populaire, à son arrivée au pouvoir, semblait être un partisan déterminé de l'industrialisation. Il fit pourtant volte-face, craignant le chômage en métropole, et se méfiant d'un prolétariat indigène susceptible de nourrir des mouvements révolutionnaires dirigés contre la souveraineté française. Et il faut attendre le régime de Vichy pour que s'opère vraiment un changement de politique. Certes, le projet de Vichy est resté lettre morte, mais il souligne la prise de conscience, chez un certain nombre de hauts fonctionnaires, tenants du courant moderniste, des nouvelles conditions auxquelles les colonies devaient s'adapter. A tout le moins, ce projet était bien plus novateur que celui de Brazzaville, aux volontés d'industrialisation plus limitées. Le plan Monnet finit même par écarter totalement l'industrialisation des colonies de son champ de préoccupations. Eût-elle seulement voulu industrialiser ses colonies, la France devait pour cela avoir l'initiative, la maîtrise de sa stratégie. Malheureusement, la seconde Guerre mondiale l'en a privée. Et c'était sans compter avec l'émergence dans les milieux d'affaires d'un véritable " complexe hollandais " : l'idée que le développement des colonies constituait une surcharge de coûts finit par s'imposer. A l'instar de ce qui s'était passé pour les Pays-Bas, il fallait maintenant se séparer au plus vite de l'empire. En conclusion, on peut remarquer l'évolution contraire du point de vue politique et du point de vue économique en ce qui concerne les colonies, de 1880 au lendemain de la seconde Guerre mondiale. Jusque vers 1930, l'instance politique attache visiblement beaucoup moins d'importance à l'empire que ne le font les milieux d'affaires, pour lesquels les colonies sont une solution rêvée aux problèmes de débouchés ; les capitaux privés trouvent dans des colonies sûres des taux de profit élevés. L'opinion publique et le milieu politique restent cependant assez indifférents au problème colonial. Après 1930, la situation se renverse. Les milieux d'affaires voient de plus en plus dans la colonisation un poids mort, favorisant certaines branches en déclin au détriment des secteurs les plus dynamiques de l'économie. Mais, dans les milieux politiques, l'anti- colonialisme cède le pas à la glorification de l'empire, reflétant l'évolution des mentalités en métropole, où la population se montre de plus en plus attachée au maintien de la domination française. Il devenait urgent de faire un choix, entre le génie civilisateur tant loué de la France, et son efficacité économique. Ce choix, il revint à de Gaulle de l'effectuer, à l'occasion d'un changement de régime. La thèse que présente Jacques Marseille est surprenante au premier abord. Le point de vue qu'il défend tranche quelque peu avec l'idée courante que l'on peut se faire de la colonisation et de ses retombées économiques sur la métropole. Une telle attitude n'est cependant pas si étonnante, si l'on prend en compte l'auteur, et sa propension assez marquée à prendre le contre-pied des idées reçues. Avant même que cette thèse ne soit soutenue, il publiait en 1983 Vive la crise et l'inflation !, ouvrage au titre déjà provocateur. Et il ne s'agit pas là d'une exception : l'auteur a récidivé dans les années qui suivirent, avec C'est beau la France, ou encore La France travaille trop... Jacques Marseille semble parfois quitter le terrain de l'historien pour celui du polémiste, et l'on pourrait légitimement craindre que cette tendance ne se retrouve dans Empire colonial et capitalisme français. Fort heureusement, cet ouvrage est plus nuancé. Pour justifier son approche complètement nouvelle de la question coloniale, l'auteur n'hésite pas à s'appuyer à de multiples occasions sur les dits et écrits des personnalités de l'époque (on remarquera même la présence en annexe d'un rapport confidentiel de Claude Cheysson, datant de 1953). On peut encore noter que, si l'approche privilégiée dans les premiers temps de l'analyse est une approche marxiste, Marseille n'hésite pas à la critiquer plusieurs fois, voire à la reformuler, lorsque le dogme léniniste montre nettement ses insuffisances (et le résultat auquel aboutit l'auteur en est effectivement assez éloigné). Toutefois, le fait de partir de telles prémisses donne à la thèse de Marseille un tour assez particulier. L'analyse du phénomène colonial abandonne les explications politiques (sauf vers la fin, lorsqu'il s'agit d'expliquer l'attachement aux colonies alors même que l'économie s'en passerait sans dommages). En revanche, les explications économiques passent au premier plan, étayées par d'abondantes données statistiques. Cette insistance sur le fait économique ne manqua pas de lui être reprochée, par exemple dans le numéro de février 1985 d'Afrique-Asie . Dans cet ouvrage, qui porte - rappelons-le - sur les liens entre la métropole et son empire, on pourra ainsi remarquer que les mouvements nationaux, l'aspect social, sont complètement négligés. Plus généralement, la démarche empruntée appelle quelques remarques. L'histoire économique, lorsqu'elle entreprend d'analyser une époque ou un phénomène bien particulier, demande inévitablement des données de comparaison, des données chiffrées : taux de croissance, importations, crédit,etc. Mais quelle valeur accorder à de telles données ? Une objection peut être notamment soulevée, quant à l'exactitude, la précision des données obtenues. La plus grande partie des documents utilisés n'est pas concernée par cette remarque : leurs sources sont irréfutables et objectives. Mais il n'en va pas toujours de même : on peut par exemple se rapporter au chapitre 4 de la première partie. L'évaluation de l'investissement français dans l'empire soulève de nombreuses difficultés, car il n'existe en fait aucun moyen objectif d'évaluation. Et la méthode d'analyse choisie par Marseille peut doublement être remise en question. Les données obtenues ont-elles quelque vraisemblance ? Quelle valeur accorder à des séries statistiques entièrement reconstruites par l'auteur, pour les besoins de sa thèse ? Ou encore, même si ces données sont exactes, l'analyse qui en est faite est-elle justifiée ? La thèse de Jacques Marseille a cependant le mérite indéniable de compléter les analyses de la décolonisation. Les facteurs politiques ont joué un rôle incontestable, mais les facteurs économiques ont peut- être eu une importance encore plus grande. Cette thèse souligne les divergences d'intérêts entre l'Etat et les milieux d'affaires, mais aussi entre les différents secteurs du capitalisme français, autant de points trop rarement rappelés. Elle a aussi le mérite de montrer que la décolonisation n'a pas uniquement répondu à un souci fraternel de donner leur indépendance aux peuples dominés, ou à la volonté de se débarrasser, après- guerre, de terrains devenus dangereux à cause de l'émergence des mouvements nationalistes. La décolonisation a aussi (et peut-être surtout) eu lieu, parce que la métropole n'avait plus aucun intérêt économique à conserver l'empire sous sa domination directe. Cette approche est d'autant plus logique que ce qui motiva la colonisation elle-même n'était pas tant l'expansion d'un génie civilisateur que la recherche d'un intérêt économique, de nouveaux profits. La thèse de Jacques Marseille se révèle donc indispensable à qui veut pleinement comprendre les enjeux de la colonisation, leur évolution au fil des années, et leurs conséquences sur la réalité des liens entre métropole et colonies. Encore faut-il éviter d'en faire une interprétation abusive... or, comme l'auteur le souligne dans un " post-propos ", la parution de sa thèse a donné lieu à diverses réactions, souvent très politiquement orientées.
«
nécessaires : l'investissement public a véritablement voulu orienter l'investissement privé.
Au total, l'empire sembleêtre un débouché de choix pour les capitaux métropolitains.
Mais est-ce que les exportations de capitaux peuventêtre automatiquement assimilées à des investissements ? Ce serait aller vite : il y a un grand écart entre la Banquede l'Indochine, banque d'affaires ayant imposé sa marque à l'histoire coloniale, et la Compagnie occidentale deMadagascar, compagnie minière ayant vécu pendant plus de 30 ans de fausses campagnes de presse, et ayantréussi à extorquer aux souscripteurs de ses actions près de 10 millions de francs-or ; à ne considérer que lemontant des capitaux exportés, il n'y a pourtant aucune différence entre les deux sociétés.
On peut remarquer aupassage la faible longévité des sociétés minières (dont plus de la moitié disparaissent précocement) et des sociétésagricoles.
Les exportations de capitaux sont donc indiscutables, mais ces capitaux n'ont pas vraiment été employésà l'implantation sur le terrain.
Après la deuxième Guerre mondiale, c'est même à un désinvestissement que l'onassiste, compréhensible face à la baisse continue des bénéfices réalisés, de 1938 à 1958.
Au milieu des années1950, alors que les taux de profit sont élevés en métropole, ils sont faibles dans l'empire, ce qui explique le repli.Face à ce désinvestissement privé, l'investissement public a dû prendre la relève.
Mais les capitauxpublics ont plus servi à combler les déficits de la balance des paiements qu'à mettre en oeuvre une stratégieindustrielle cohérente : l'investissement public n'a pas servi à corriger les nombreux déséquilibres des économiesattardées.Ainsi l'empire a-t-il surtout servi à maintenir artificiellement en vie des branches déclinantes de l'économie française.Ce n'est pas tant le capitalisme français qu'un capitalisme qui s'est opposé à un redéploiementdevenu inéluctable.
Cette dernière nécessité a-t-elle été correctement perçue par les milieux d'affaires et lespouvoirs publics ?C'est à partir des années 1930 que s'affrontent, au sein du capitalisme français, plusieurs tendances.
Troisstratégies peuvent être distinguées.
La première veut renforcer " l'autarchie " impériale, c'est-à-dire à créer unezone protégée où se développeront des productions complémentaires, l'empire fournissant les matières premières, lamétropole, les produits manufacturés.
Deuxième stratégie : supprimer les entraves douanières ; abaisser les prix,anormalement élevés ; et revenir à une division internationale du travail.
Dernière stratégie, plus ambitieuse - etanticipatrice : industrialiser l'empire, développer le marché intérieur des pays colonisés, et permettre à chacund'entre eux d'orienter sa production en fonction du marché mondial.La première stratégie est celle de l'industrie cotonnière.
Ses représentants ont rapidement compris les difficultés àvenir, et ont sans cesse fait pression pour obtenir la création d'un " bloc " impérial, véritable systèmeprotectionniste pour les produits français.
Cette stratégie allait de pair avec une certaine "générosité ".
En effet, lemarché colonial ne pouvait absorber en masse les fabrications de la métropole que s'il en avait les moyens : il fallaitdonc augmenter le prix des produits coloniaux.
C'était là le combat d'arrière-garde d'une industrie menacée sur lesmarchés extérieur (à cause de la concurrence des nouveaux pays extra-européens) et intérieur (avec l'essor destextiles synthétiques) : elle devait donc accaparer le marché colonial pour survivre.
Tout effort de redéploiement,possible en théorie, était condamné en pratique par l'individualisme forcené des industriels du coton et par ladispersion géographique (mais aussi technique et même financière) de l'industrie cotonnière, qui conservait desstructures héritées du XIXème siècle.
D'autres branches s'étaient ralliées à cette stratégie.
Parmi elles, desindustries importantes comme l'automobile ou la métallurgie, souffrant de la crise, et qui s'éloigneront de la stratégie" autarchique " aussitôt les difficultés passées ; et des industries plus traditionnelles, souffrant de difficultés plusstructurelles.
Malgré leurs divergences profondes et leurs conflits d'intérêts, les " coloniaux " se rallièrent aussi,contraints par la crise, la chute des cours des matières premières et la fermeture des marchés extérieurs.
Leurposition, d'abord opportuniste, évolua bientôt vers une acceptation et une défense systématique du principe "autarchique " : après la deuxième Guerre mondiale, les " coloniaux " virent dans cette stratégie un moyen depréserver leurs intérêts économiques et de combattre les forces naissantes qui menaçaient l'union de la métropoleet de l'empire.
Mais la poursuite de cette stratégie isolait un peu plus la France des circuits mondiaux.Les opposants à la stratégie " autarchique ", et particulièrement les libéraux, estimaient qu'ils fallait au contraires'adapter aux évolutions du marché, soutenir la concurrence internationale en produisant au plus bas prix,restructurer les branches attardées de l'économie et ouvrir le marché colonial à l'économie mondiale pour y susciterdes activités rentables.
Les libéraux, à la suite d'Edmond Giscard d'Estaing, ne prônaient pas de véritable stratégiede développement, mais cherchaient seulement à perfectionner la division du travail telle qu'elle s'était imposée.Leur objectif : vouer l'empire à la production rentable de matières premières, et de rétablir les lois du marché.
Lavraie clientèle solvable devait être trouvée, non dans l'empire, mais dans les pays développés.
Les libérauxtrouvèrent donc tout naturellement des soutiens dans les branches exportatrices traditionnelles de l'économiefrançaise : les industries de luxe ; les industries de la soie et de la laine, tributaires en grande partie de leursapprovisionnements de l'étranger, et donc hostiles à " l'autarchie ".
A leurs côtés, on trouvait encore les milieuxd'affaires marseillais, luttant pour que les mouvements commerciaux ne soient pas entravés.
Ces milieux soulignaientà l'envi que l'empire ne saurait fournir à la métropole toutes les matières premières nécessaires ; que la productioncoloniale devait servir à abaisser les coûts des productions métropolitaines, et non servir de monnaie d'échange.Seules l'augmentation des rendements et la baisse des prix permettraient - selon eux - de retrouver la prospérité.Les libéraux se voyaient enfin soutenus par lesmilieux agricoles, soumis à une vive concurrence coloniale : en effet, l'intensification des rapports entre la métropoleet l'empire risquait d'aboutir à une augmentation des importations de produits agricoles coloniaux pour accroître lesexportations de produits industriels métropolitains.
Les libéraux avaient-ils de l'influence ? La Confédération généraledes vignerons revendiquait bien 5 à 6 millions de Français.
Mais c'était sans compter avec les dissensions internes(entre soyeux et agriculteurs par exemple) ; et le fait que de nombreux autres pays aient adopté à la même époquedes stratégies protectionnistes ne les favorisait pas.Pourtant, libéraux et " autarchiques " se rejoignaient.
Les deux stratégies proposées avaient ceci de communqu'elles ne considéraient les pays dominés que comme des producteurs de matières premières et des acheteurs deproduits manufacturés.
Contre ces deux stratégies, une troisième fut avancée par Paul Bernard, administrateur du.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- David Jacques Louis, 1748-1825, né à Paris, peintre français, artiste le plus éminent de la Révolution et de l'Empire.
- L'empire colonial français
- L'empire colonial français en 1930 (histoire)
- L'empire colonial français
- L'empire colonial français