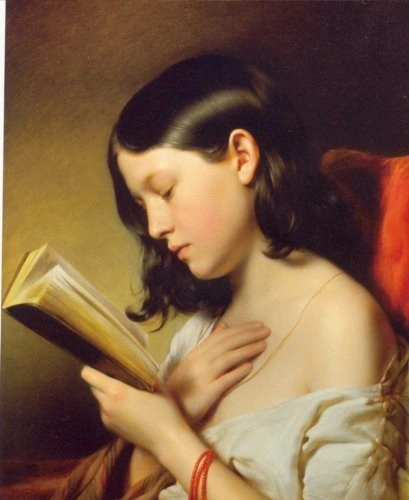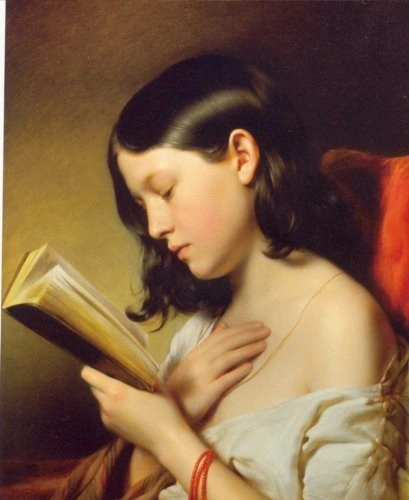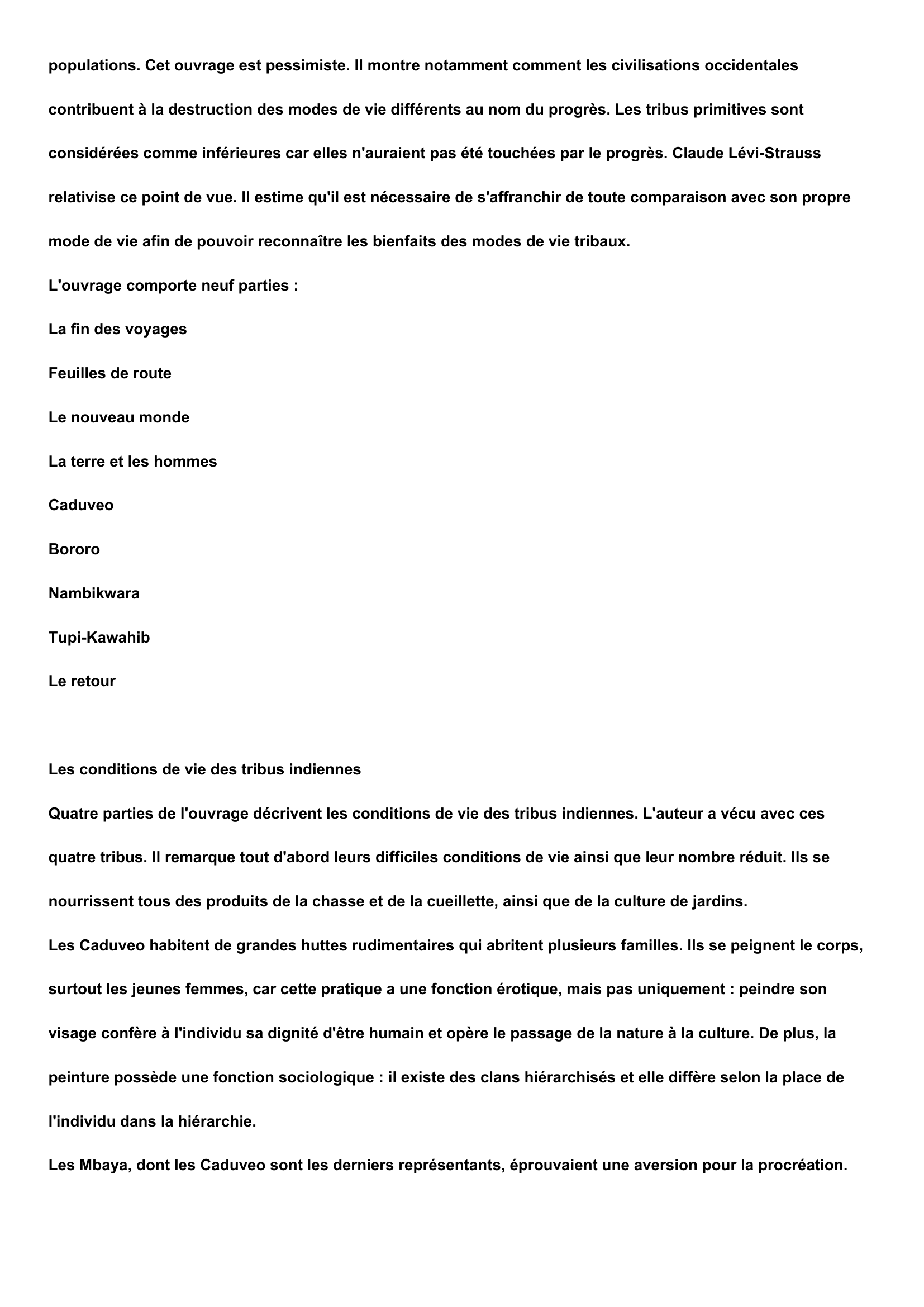L’AUTEUR Claude Lévi-Strauss est né le 28 novembre 1908 à Bruxelles. Normalien, agrégé de philosophie, il part en 1935 au Brésil et enseigne à l'université de Sao Paulo. De 1935 à 1939, il étudie et séjourne avec les populations indiennes nambikwaras, caduvéos et bororos. Il retourne en France avant de s'exiler aux Etats-Unis en 1941. Il passe avec succès son doctorat en France en 1949 (les Structures élémentaires de la parenté). Il devient sous-directeur du musée de l'Homme, puis directeur d'études de l'Ecole pratique des hautes études, chaire des religions comparées des peuples sans écriture. En 1959, il est élu à la chaire d'anthropologie sociale du Collège de France, il y fonde l'année suivante le laboratoire d'anthropologie sociale et la revue l'Homme. Il est élu à l'Académie française en 1973. Il est l'un des ethnologues les plus reconnus de la profession. Il a été distingué à maintes reprises pour ses travaux. Il a notamment reçu en 1966 la médaille d'or et le prix du Viking Fund, décerné par un vote international de la profession ethnologique. L’OUVRAGE Tristes Tropiques a été publié en 1955. Dans son ouvrage, l'auteur entreprend son autobiographie à travers l'évocation des voyages qu'il a pu effectuer. Si l'ouvrage est destiné à décrire la vie de tribus du Brésil, l'auteur raconte également comment il est arrivé aux Etats- Unis lors de la Seconde Guerre Mondiale ou encore son voyage aux Antilles. L'auteur passe ainsi de l'Ancien au Nouveau Monde, du passé au présent. Mais surtout, il propose sa vision du voyage. La première phrase du livre « Je hais les voyages et les explorateurs « est avant tout la critique des récits d'aventures qui contribuent à fabriquer des stéréotypes dont se repaissent les touristes. Tristes Tropiques est à la fois un ouvrage savant et un moyen de faire connaître la profession d'ethnologue et de développer auprès du plus grand nombre sa vision du monde, du progrès et des relations entre civilisations et populations. Cet ouvrage est pessimiste. Il montre notamment comment les civilisations occidentales contribuent à la destruction des modes de vie différents au nom du progrès. Les tribus primitives sont considérées comme inférieures car elles n'auraient pas été touchées par le progrès. Claude Lévi-Strauss relativise ce point de vue. Il estime qu'il est nécessaire de s'affranchir de toute comparaison avec son propre mode de vie afin de pouvoir reconnaître les bienfaits des modes de vie tribaux. L'ouvrage comporte neuf parties : La fin des voyages Feuilles de route Le nouveau monde La terre et les hommes Caduveo Bororo Nambikwara Tupi-Kawahib Le retour Les conditions de vie des tribus indiennes Quatre parties de l'ouvrage décrivent les conditions de vie des tribus indiennes. L'auteur a vécu avec ces quatre tribus. Il remarque tout d'abord leurs difficiles conditions de vie ainsi que leur nombre réduit. Ils se nourrissent tous des produits de la chasse et de la cueillette, ainsi que de la culture de jardins. Les Caduveo habitent de grandes huttes rudimentaires qui abritent plusieurs familles. Ils se peignent le corps, surtout les jeunes femmes, car cette pratique a une fonction érotique, mais pas uniquement : peindre son visage confère à l'individu sa dignité d'être humain et opère le passage de la nature à la culture. De plus, la peinture possède une fonction sociologique : il existe des clans hiérarchisés et elle diffère selon la place de l'individu dans la hiérarchie. Les Mbaya, dont les Caduveo sont les derniers représentants, éprouvaient une aversion pour la procréation. L'avortement et l'infanticide étaient pratiqués de façon presque normale, si bien que la perpétuation du groupe se faisait principalement par l'adoption. Un des buts principaux des expéditions guerrières était de se procurer des enfants. Les Bororo habitent dans de vastes huttes. Il existe une maison des hommes, dans laquelle ils vivent jusqu'à leur mariage, et dont l'entrée est interdite aux femmes. Les habitants sont nus mais ils accordent beaucoup d'importance aux accessoires (couronnes, colliers...) et leurs corps sont peints et colorés. La nuit est réservée à la vie religieuse, les Bororo dorment du lever du soleil à la mi-journée. Les cérémonies ont parfois lieu dans la maison des hommes et sont alors interdites aux femmes. La population est divisée en deux clans. Les mariages sont obligatoirement mixtes. Chaque clan est divisé en trois groupes : supérieur, moyen, inférieur et les mariages ne se font qu'entre personnes appartenant au même groupe. Le chef du village appartient toujours au même clan avec transmission héréditaire du titre en ligne féminine. S'agissant des Nambikwara : L'année nambikwara se compose de deux périodes distinctes. Pendant la saison pluvieuse, d'octobre à mars, ils sont sédentaires. Ils construisent des huttes rudimentaires et cultivent des jardins. Pendant la saison sèche, ils sont nomades et se divisent en petits groupes. La quête alimentaire absorbe alors tous les soins. Ils vivent dans le dénuement. Ils dorment nus et par terre. Les Nambikwara ont peu d'enfants en raison des exigences de la vie nomade et de la pauvreté de leur milieu. Les relations sexuelles entre les parents sont interdites tant que le dernier né n'est pas sevré et les femmes absorbent parfois des plantes afin de provoquer un avortement. Le couple est fondamental dans cette tribu en raison de la division des tâches : l'homme chasse et jardine et la femme participe à la cueillette. Le chef Nambikwara est le seul à pouvoir avoir plusieurs épouses. Cela l'aide à remplir sa fonction, car il a le devoir d'être généreux envers tous les membres du groupe. Mais cette pratique crée un déséquilibre et les autres hommes sont parfois condamnés à rester célibataires. Les Tupi-Kawahib vivent dans des maisons. La chefferie est héréditaire en ligne masculine. Le chef dispose d'un privilège polygame. Mais il le compense en « prêtant « ses femmes aux autres hommes de son groupe et la polyandrie est pratiquée. Les méfaits de la civilisation occidentale La première partie, la fin des voyages, ainsi que la première phrase de l'ouvrage « Je hais les voyages et les explorateurs « illustrent la pensée de Claude Lévi-Strauss : les voyages, dont l'objectif est la découverte et la compréhension d'autres modes de vie, ont disparu. Le voyage n'a plus pour objet que de se vanter d'avoir vécu des aventures sensationnelles. Le respect de l'autre n'est plus le fondement des voyages et les récits des explorateurs ne font que diffuser des préjugés. Les voyageurs ne respectent plus les endroits visités, comme l'annonce l'auteur : « Campeurs, campez au Parana. Ou plutôt non : abstenez-vous. Réservez aux derniers sites d'Europe vos papiers gras, vos flacons indestructibles et vos boîtes de conserve éventrées«. L'auteur dénonce l'attitude des occidentaux à l'égard des tribus indiennes. Ils sont responsables de l'extinction de ces dernières. L'auteur explique notamment que les brésiliens, au XX siècle encore, recueillaient dans les hôpitaux les vêtements des malades de la variole afin de les accrocher, parmi des cadeaux, le long de sentiers encore fréquentés par les tribus indiennes. L'auteur est pessimiste : la civilisation occidentale ne semble amener que la désolation. Les tropiques sont tristes, car les voyages nous montrent « notre ordure lancée au visage de l'humanité «. Les difficultés liées au métier d'ethnographe Claude Lévi-Strauss est à la fois ethnologue et ethnographe. L'ethnologie est l'étude théorique des groupes humains, de leurs caractères anthropologiques, sociaux, décrits par l'ethnographie. Il définit la profession d'ethnographe de la manière suivante : « l'ethnographe cherche à connaître et à juger l'homme d'un point de vue suffisamment élevé et éloigné pour l'abstraire des contingences particulières à telle société ou telle civilisation «. L'auteur s'interroge sur sa profession. Il se demande ainsi pourquoi l'ethnographe, qui a à sa disposition une société à étudier : la sienne, la dédaigne pour en étudier d'autres. Un ethnographe exprime, sinon du dédain, du moins un détachement à l'égard de sa propre société alors qu'il est attaché aux autres sociétés. L'auteur essaie d'expliquer cette contradiction. Un ethnographe est volontiers en rébellion face aux usages traditionnels pratiqués dans sa société tandis qu'il est emprunt de respect dès lors qu'il s'agit d'une société autre. « On n'échappe pas au dilemme : ou bien l'ethnographe adhère aux normes de son groupe, et les autres [sociétés] ne peuvent lui inspirer qu'une curiosité passagère dont la réprobation n'est jamais absente ; ou bien il est capable de se livrer totalement à elles, et son objectivité reste viciée du fait qu'en le voulant ou non, pour se donner à toutes les sociétés il s'est au moins refusé à une «. Selon lui, l'objectivité nécessaire à l'étude d'une société n'existe pas à l'égard de son groupe. Dans le cas de sociétés extérieures, l'ethnographe est spectateur alors que dans sa société il est acteur. Cette contradiction est-elle insurmontable ? Selon les détracteurs de cette profession, il est impossible de déclarer des sociétés respectables sans se fonder sur les valeurs de sa propre société. Les individus seraient incapables d'échapper aux normes qui les ont façonnés. Claude Lévi-Strauss estime que la difficulté se situe ailleurs : si un ethnographe juge un groupe en fonction de buts semblables à ceux que s'est fixé sa propre société, il peut l'estimer supérieur. Mais dans ce cas il se donne le droit de le juger. Pour retrouver l'objectivité, il faut s'abstenir de ce type de jugements. Surgit alors une autre difficulté : celle de juger sa propre société en refusant de condamner un autre groupe qui pratique des agissements semblables. « Quel sera notre droit de les combattre à demeure, s'il suffit qu'ils se produisent ailleurs pour que nous nous inclinions devant eux ? «. Claude Lévi-Strauss la résout en précisant que tout jugement doit être modéré et que toute société offre des avantages à ses membres, mais qu'aucune n'est foncièrement bonne. C'est pourquoi il estime que toute pratique ne doit pas faire l'objet d'une réaction immédiate mais doit au contraire être appréciée de manière correcte. Le rejet de l'ethnocentrisme Les sociétés dites primitives sont souvent comparées aux sociétés occidentales. Leurs membres sont dénigrés au profit des membres des sociétés occidentales, présentés comme civilisés. Claude Lévi-Strauss refuse d'entreprendre de telles comparaisons. C'est en ce sens que peut être comprise la phrase d'introduction de l'ouvrage « Je hais les voyages et les explorateurs «. Il se démarque des autres voyageurs. Il étudie et essaie de comprendre le mode de vie des Indiens en refusant de prendre pour modèle le mode de vie occidental. Il prend comme exemple l'anthropophagie. Cette pratique sauvage nous inspire du dégoût et de l'horreur. Claude Lévi-Strauss distingue d'une part l'anthropophagie alimentaire et d'autre part les formes d'anthropophagie qu'il nomme positives, et qui relèvent d'une cause mystique, magique ou religieuse. La première s'explique par la carence d'une autre chair animale, et il fait remarquer que la famine a pu pousser des individus appartenant aux sociétés occidentales à pratiquer cette forme d'anthropophagie. La seconde consiste en un rituel au cours duquel une parcelle du corps d'un ascendant ou d'un ennemi est ingérée, ce afin d'incorporer ses vertus ou de neutraliser ses pouvoirs. Or cette dernière pratique repose sur la croyance, également largement répandue en Occident, d'un lien entre le corps et l'âme. Elle ne semble pas plus « barbare « à l'auteur que l'existence d'amphithéâtres de dissection. En revanche, pour les sociétés dites primitives, la rupture des liens sociaux, qui se produit notamment lorsqu'une personne est incarcérée, est une pratique barbare et incompréhensible. Selon l'auteur, « le comble de l'absurdité est (...) de croire que nous avons accompli un grand progrès spirituel parce que, plutôt que de consommer quelques-uns de nos semblables, nous préférons les mutiler physiquement et moralement «.
Le refus d'une conception linéaire du progrès Claude Lévi-Strauss ne considère pas que les sociétés dites primitives n'ont pas connu le progrès, à la différence des sociétés occidentales. Il ne voit pas le progrès de façon linéaire. Il estime que les sociétés ont différents choix qui s'offrent à elles et que les indiens d'Amérique ont fait le choix de garder le même système de vie, tandis que les sociétés occidentales modifient le leur. Il n'existe pas une civilisation que l'on peut rencontrer à différentes étapes de l'évolution mais différentes civilisations, qui poursuivent toutes un but qui leur est propre. Les civilisations occidentales considèrent que la démocratie est un des éléments de preuve du niveau avancé d'une société. Or, Claude Lévi-Strauss a étudié les relations de pouvoir dans les tribus indiennes. Il en ressort que si, chez les Tupi-Kawahib, le pouvoir se transmet entre hommes de façon héréditaire, le chef d'un clan Nambikwara ne le reste que tant que les membres du groupe y consentent. Seule l'adhésion de la majorité lui permet de garder une légitimité. Le chef est celui qui dispose d'un prestige personnel et de l'aptitude à inspirer confiance car il organise la vie du groupe. Claude Lévi-Strauss considère, comme Rousseau avant lui, que le contrat et le consentement sont « les matières premières de la vie sociale «. L'anthropologie structurale Le structuralisme est l'hypothèse selon laquelle on peut étudier une langue en tant que structure. Cette position est adoptée par Ferdinand de Saussure. Selon lui, une langue est un système dans lequel chacun des éléments n'est définissable que par les relations d'équivalence ou d'opposition qu'il entretient avec les autres. Cet ensemble de relations forme une structure. Claude Lévi-Strauss applique cette vision aux sociétés. Selon lui, l'anthropologie doit se consacrer à la recherche des rapports unissant l'homme au monde qui l'entoure. L'anthropologue doit s'immerger dans la culture étudiée, déterminer comment se structurent les rapports observés entre les mythes, les techniques, les représentations de la parenté et formuler des propriétés générales de la vie sociale. Le structuralisme vise à mettre en évidence les structures inconscientes par la compréhension et l'explication de leurs réalisations sensibles. « Si l'activité inconsciente de l'esprit consiste à imposer des formes à un contenu, et si ces formes sont fondamentalement les mêmes pour tous les esprits, anciens et modernes, primitifs et civilisés, il faut et il suffit d'atteindre la structure inconsciente, sous jacente à chaque institution et à chaque coutume, pour obtenir un principe d'interprétation valide pour d'autres institutions et d'autres coutumes. « (Anthropologie structurale)