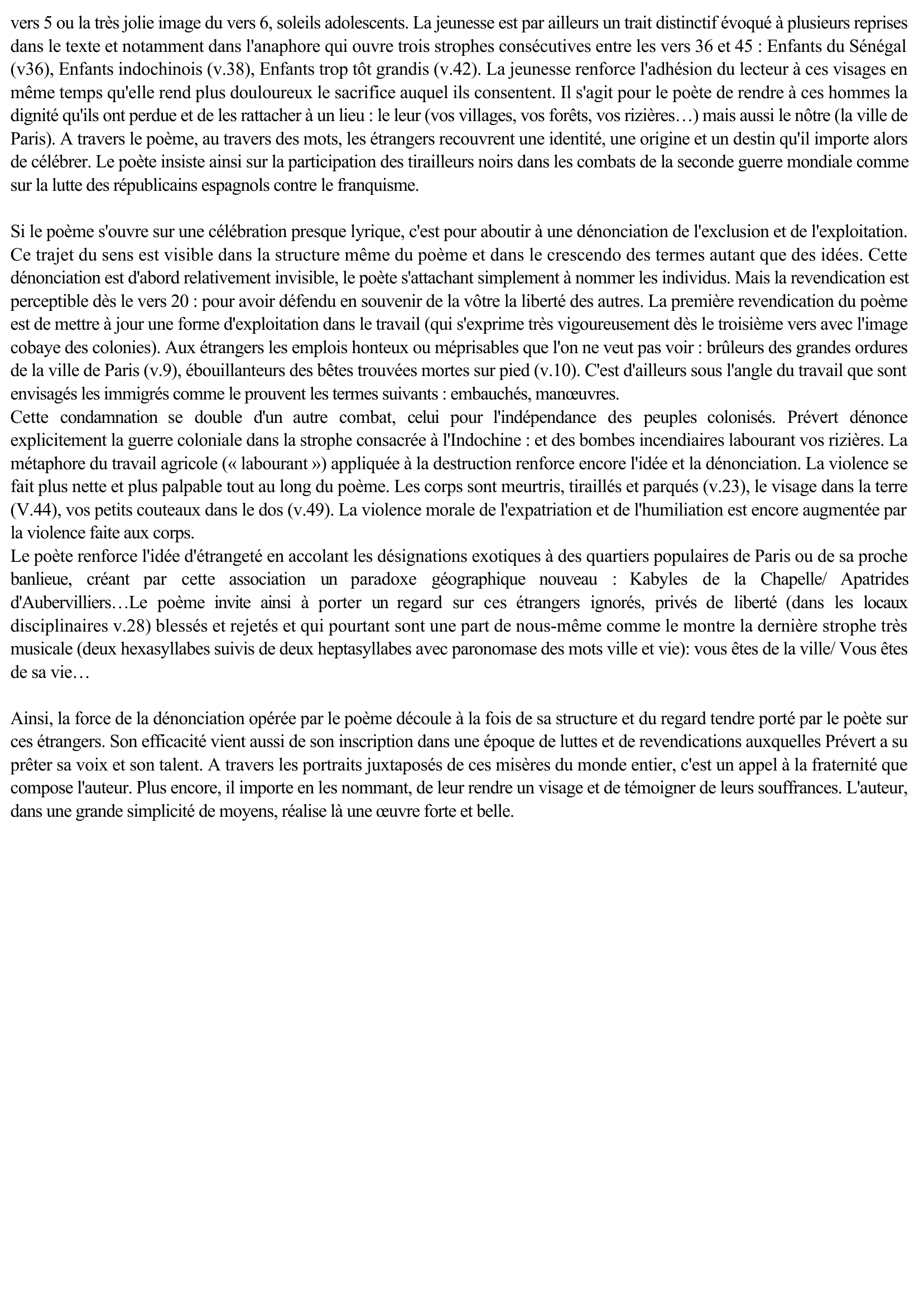Etranges étrangers – Jacques Prévert (commentaire rédigé)
Publié le 12/09/2006

Extrait du document
Dans le poème en vers libres, Etranges étrangers, Jacques Prévert, compagnon de route du surréalisme et humaniste engagé, dresse une liste des peuples qui font la richesse et la diversité de la France de l’après-guerre. Ce poème entend faire exister en les nommant ces travailleurs de l’ombre, ces humbles étrangers qui participent à la construction et à l’histoire de la France, qui est encore en 1955 un empire colonial. Nous nous efforcerons de cerner la nature de la force argumentative du poème entre lyrisme et dénonciation. Il conviendra alors d’étudier dans un premier temps la forme singulière de ce poème, sorte de lettre ouverte et d’hommage autant que litanie. Nous nous attacherons ensuite à la description de ces déracinés dont le poète détaille chaque fois l’identité et la fonction sociale. Enfin, nous conclurons sur le choc des mondes que donne à voir le texte, choc des cultures qui se lit à travers les nombreuses oppositions qui parcourent le texte et en constituent la force argumentative. Tout d’abord, la forme du poème est originale. Le texte, écrit en 1955, se singularise par une liberté formelle autant que par sa simplicité qui a fait par ailleurs la notoriété de la poésie de Prévert : simplicité du vocabulaire et des tournures syntaxiques, simplicité aussi des images qui leur confère ainsi une puissante évidence, simplicité, enfin, d’une écriture poétique qui ne cherche pas les effets et joue de manière légère avec les retours de sons (la plupart des rimes -quand il y en a- sont pauvres – le son [e] revenant le plus fréquemment). Le texte se présente ainsi comme une sorte de lettre ouverte, comme l’atteste l’emploi du pronom de deuxième personne que l’on rencontre à partir du vers 25 : où peu vous vous baignez. Le poète s’adresse à ces étrangers, et ce n’est que dans les dernières strophes que l’on connaît les motifs qui justifient une telle apostrophe. Le poème est un message adressé à ces étrangers, une déclaration de fraternité et d’amitié comme en témoignent les derniers vers : vous êtes de la ville «. Il s’agit précisément de rendre ces étrangers proches et familiers, de combattre ainsi les préjugés qui les rejettent ou les stigmatisent. Le poème s’offre à lire comme une longue liste. Les strophes enchaînent les descriptions sommaires consacrées aux étrangers qui constituent une force de travail, une main d’œuvre dont Prévert s’attache à dénoncer l’exploitation. Ce sont tour à tour les Kabyles, puis les Bohémiens, les Tunisiens, les Polonais, les Espagnols, les Africains, enfin les Indochinois. Cette liste énumère les peuples conquis par l’empire colonial français en plein conflit (la guerre d’Indochine vient de s’achever, et celle d’Algérie a déjà débuté) et ceux qui se sont exilés pour des raisons politiques (rescapés de Franco) ou économiques (Polacks du Marais). Les termes choisis par l’auteur pour désigner ces peuples sont par moment simplement référentiels (Tunisiens par exemple) et parfois connotés (Polack au vers 15 est une façon familière et dévalorisante de nommer les travailleurs polonais. Prévert reprend ici ce vocable méprisant pour en faire, paradoxalement, un titre de gloire). A ces désignations géographiques vient s’ajouter l’adjectif apatrides lequel renvoie à l’exil et au déracinement. Le poème, dans sa force litanique, effectue un tour du monde salutaire qui s’achève à Paris (partout présente dans la première strophe, le vers 33 la désigne ensuite par la périphrase –la capitale, le vers 51 en est une probable allusion à travers le groupe la ville). Paris, cité cosmopolite, creuset où viennent se mélanger les cultures et les couleurs. Ainsi, cette liste est un hommage rendu à ces hommes, une célébration qui passe par les noms, ces noms que le poète prend plaisir à dire et qui font exister ceux que l’on nomme. Tout l’intérêt du texte réside dans la manière dont ces étrangers sont caractérisés. Tout d’abord le poète les englobe sous l’appellation générique d’étranges étrangers jouant sur la répétition. Ils sont étranges parce qu’ils sont différents. Le poète prend acte d’une connotation qui est présente dans la langue même. L’étranger est pour nous un être bizarre et que l’on cerne mal. Ils sont étrangers par leur appartenance à d’autres cultures, des cultures lointaines et résolument autres (ce que nous dit la formulation étonnante du vers 3, hommes des pays loin dans laquelle Prévert troque l’adjectif lointain contre l’adverbe plus rare, voire inhabituel, dans cet emploi). Le poète ne cherche par ailleurs pas à gommer en eux cette étrangeté. Il la glorifie plutôt, en fait l’essence même de ces hommes. Ainsi exercent-ils des professions curieuses ou marginales, musiciens (v.5), brûleurs des grandes ordures (v.9), jongleurs de couteaux (v.39- expression dans laquelle on remarquera une hypallage. En effet, l’adjectif innocents se déplace des jongleurs aux couteaux créant un contraste de termes). On pourra même reprocher au poète cette forme d’exotisme qui reprend à bon compte quelques traits stéréotypés des cultures citées –la musique jouée sur des instruments bricolés pour les peuples d’Afrique (avec une vieille boîte à cigares,v.29), les dragons en papier pour les Asiatiques. Dans cette caractérisation, le poète s’amuse des mots en jouant des échos sonores comme des répétitions et de la musicalité des noms : embauchés débauchés (v.13), manœuvres désoeuvrés (v.14), dépatriés expatriés et naturalisés (v.36). Ce jeu sur le changement de préfixe traduit plus sérieusement une forme de dépossession dont sont victimes ces déracinés ; le préfixe privatif indique bien le manque ou l’absence d’identité. En quelques mots le poète esquisse un tableau de leurs contrées d’origine. Ainsi évoque-t-il les oiseaux des forêts équatoriales au vers 32, les rizières d’Asie au vers 45 ou encore les ports d’Espagne dans la deuxième strophe. Ces étrangers sont de partout et de nulle part, mais ce qui les réunit est la dignité que veut leur rendre le poète. Cette énumération est malgré l’humilité des hommes qui y figurent, étonnamment valorisante. Les termes qui qualifient ou désignent les étrangers sont affectueux, empreints d’une vraie tendresse pour les marginaux et les exclus. Ainsi l’adjectif doux au vers 5 ou la très jolie image du vers 6, soleils adolescents. La jeunesse est par ailleurs un trait distinctif évoqué à plusieurs reprises dans le texte et notamment dans l’anaphore qui ouvre trois strophes consécutives entre les vers 36 et 45 : Enfants du Sénégal (v36), Enfants indochinois (v.38), Enfants trop tôt grandis (v.42). La jeunesse renforce l’adhésion du lecteur à ces visages en même temps qu’elle rend plus douloureux le sacrifice auquel ils consentent. Il s’agit pour le poète de rendre à ces hommes la dignité qu’ils ont perdue et de les rattacher à un lieu : le leur (vos villages, vos forêts, vos rizières…) mais aussi le nôtre (la ville de Paris). A travers le poème, au travers des mots, les étrangers recouvrent une identité, une origine et un destin qu’il importe alors de célébrer. Le poète insiste ainsi sur la participation des tirailleurs noirs dans les combats de la seconde guerre mondiale comme sur la lutte des républicains espagnols contre le franquisme. Si le poème s’ouvre sur une célébration presque lyrique, c’est pour aboutir à une dénonciation de l’exclusion et de l’exploitation. Ce trajet du sens est visible dans la structure même du poème et dans le crescendo des termes autant que des idées. Cette dénonciation est d’abord relativement invisible, le poète s’attachant simplement à nommer les individus. Mais la revendication est perceptible dès le vers 20 : pour avoir défendu en souvenir de la vôtre la liberté des autres. La première revendication du poème est de mettre à jour une forme d’exploitation dans le travail (qui s’exprime très vigoureusement dès le troisième vers avec l’image cobaye des colonies). Aux étrangers les emplois honteux ou méprisables que l’on ne veut pas voir : brûleurs des grandes ordures de la ville de Paris (v.9), ébouillanteurs des bêtes trouvées mortes sur pied (v.10). C’est d’ailleurs sous l’angle du travail que sont envisagés les immigrés comme le prouvent les termes suivants : embauchés, manœuvres. Cette condamnation se double d’un autre combat, celui pour l’indépendance des peuples colonisés. Prévert dénonce explicitement la guerre coloniale dans la strophe consacrée à l’Indochine : et des bombes incendiaires labourant vos rizières. La métaphore du travail agricole (« labourant «) appliquée à la destruction renforce encore l’idée et la dénonciation. La violence se fait plus nette et plus palpable tout au long du poème. Les corps sont meurtris, tiraillés et parqués (v.23), le visage dans la terre (V.44), vos petits couteaux dans le dos (v.49). La violence morale de l’expatriation et de l’humiliation est encore augmentée par la violence faite aux corps. Le poète renforce l’idée d’étrangeté en accolant les désignations exotiques à des quartiers populaires de Paris ou de sa proche banlieue, créant par cette association un paradoxe géographique nouveau : Kabyles de la Chapelle/ Apatrides d’Aubervilliers…Le poème invite ainsi à porter un regard sur ces étrangers ignorés, privés de liberté (dans les locaux disciplinaires v.28) blessés et rejetés et qui pourtant sont une part de nous-même comme le montre la dernière strophe très musicale (deux hexasyllabes suivis de deux heptasyllabes avec paronomase des mots ville et vie): vous êtes de la ville/ Vous êtes de sa vie… Ainsi, la force de la dénonciation opérée par le poème découle à la fois de sa structure et du regard tendre porté par le poète sur ces étrangers. Son efficacité vient aussi de son inscription dans une époque de luttes et de revendications auxquelles Prévert a su prêter sa voix et son talent. A travers les portraits juxtaposés de ces misères du monde entier, c’est un appel à la fraternité que compose l’auteur. Plus encore, il importe en les nommant, de leur rendre un visage et de témoigner de leurs souffrances. L’auteur, dans une grande simplicité de moyens, réalise là une œuvre forte et belle.
«
vers 5 ou la très jolie image du vers 6, soleils adolescents.
La jeunesse est par ailleurs un trait distinctif évoqué à plusieurs reprisesdans le texte et notamment dans l'anaphore qui ouvre trois strophes consécutives entre les vers 36 et 45 : Enfants du Sénégal(v36), Enfants indochinois (v.38), Enfants trop tôt grandis (v.42).
La jeunesse renforce l'adhésion du lecteur à ces visages enmême temps qu'elle rend plus douloureux le sacrifice auquel ils consentent.
Il s'agit pour le poète de rendre à ces hommes ladignité qu'ils ont perdue et de les rattacher à un lieu : le leur (vos villages, vos forêts, vos rizières…) mais aussi le nôtre (la ville deParis).
A travers le poème, au travers des mots, les étrangers recouvrent une identité, une origine et un destin qu'il importe alorsde célébrer.
Le poète insiste ainsi sur la participation des tirailleurs noirs dans les combats de la seconde guerre mondiale commesur la lutte des républicains espagnols contre le franquisme.
Si le poème s'ouvre sur une célébration presque lyrique, c'est pour aboutir à une dénonciation de l'exclusion et de l'exploitation.Ce trajet du sens est visible dans la structure même du poème et dans le crescendo des termes autant que des idées.
Cettedénonciation est d'abord relativement invisible, le poète s'attachant simplement à nommer les individus.
Mais la revendication estperceptible dès le vers 20 : pour avoir défendu en souvenir de la vôtre la liberté des autres.
La première revendication du poèmeest de mettre à jour une forme d'exploitation dans le travail (qui s'exprime très vigoureusement dès le troisième vers avec l'imagecobaye des colonies).
Aux étrangers les emplois honteux ou méprisables que l'on ne veut pas voir : brûleurs des grandes orduresde la ville de Paris (v.9), ébouillanteurs des bêtes trouvées mortes sur pied (v.10).
C'est d'ailleurs sous l'angle du travail que sontenvisagés les immigrés comme le prouvent les termes suivants : embauchés, manœuvres.Cette condamnation se double d'un autre combat, celui pour l'indépendance des peuples colonisés.
Prévert dénonceexplicitement la guerre coloniale dans la strophe consacrée à l'Indochine : et des bombes incendiaires labourant vos rizières.
Lamétaphore du travail agricole (« labourant ») appliquée à la destruction renforce encore l'idée et la dénonciation.
La violence sefait plus nette et plus palpable tout au long du poème.
Les corps sont meurtris, tiraillés et parqués (v.23), le visage dans la terre(V.44), vos petits couteaux dans le dos (v.49).
La violence morale de l'expatriation et de l'humiliation est encore augmentée parla violence faite aux corps.Le poète renforce l'idée d'étrangeté en accolant les désignations exotiques à des quartiers populaires de Paris ou de sa prochebanlieue, créant par cette association un paradoxe géographique nouveau : Kabyles de la Chapelle/ Apatridesd'Aubervilliers…Le poème invite ainsi à porter un regard sur ces étrangers ignorés, privés de liberté (dans les locauxdisciplinaires v.28) blessés et rejetés et qui pourtant sont une part de nous-même comme le montre la dernière strophe trèsmusicale (deux hexasyllabes suivis de deux heptasyllabes avec paronomase des mots ville et vie): vous êtes de la ville/ Vous êtesde sa vie…
Ainsi, la force de la dénonciation opérée par le poème découle à la fois de sa structure et du regard tendre porté par le poète surces étrangers.
Son efficacité vient aussi de son inscription dans une époque de luttes et de revendications auxquelles Prévert a suprêter sa voix et son talent.
A travers les portraits juxtaposés de ces misères du monde entier, c'est un appel à la fraternité quecompose l'auteur.
Plus encore, il importe en les nommant, de leur rendre un visage et de témoigner de leurs souffrances.
L'auteur,dans une grande simplicité de moyens, réalise là une œuvre forte et belle..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Étranges étrangers - Jacques prévert
- Jacques Prévert, Grand Bal du Printemps. Commentaire
- Jacques Prévert, Grand Bal du Printemps. Commentaire composé
- Commentaire Jacques Prévert - Grasse Matinée
- Jacques Prévert, Barbara, Paroles (1946) - commentaire