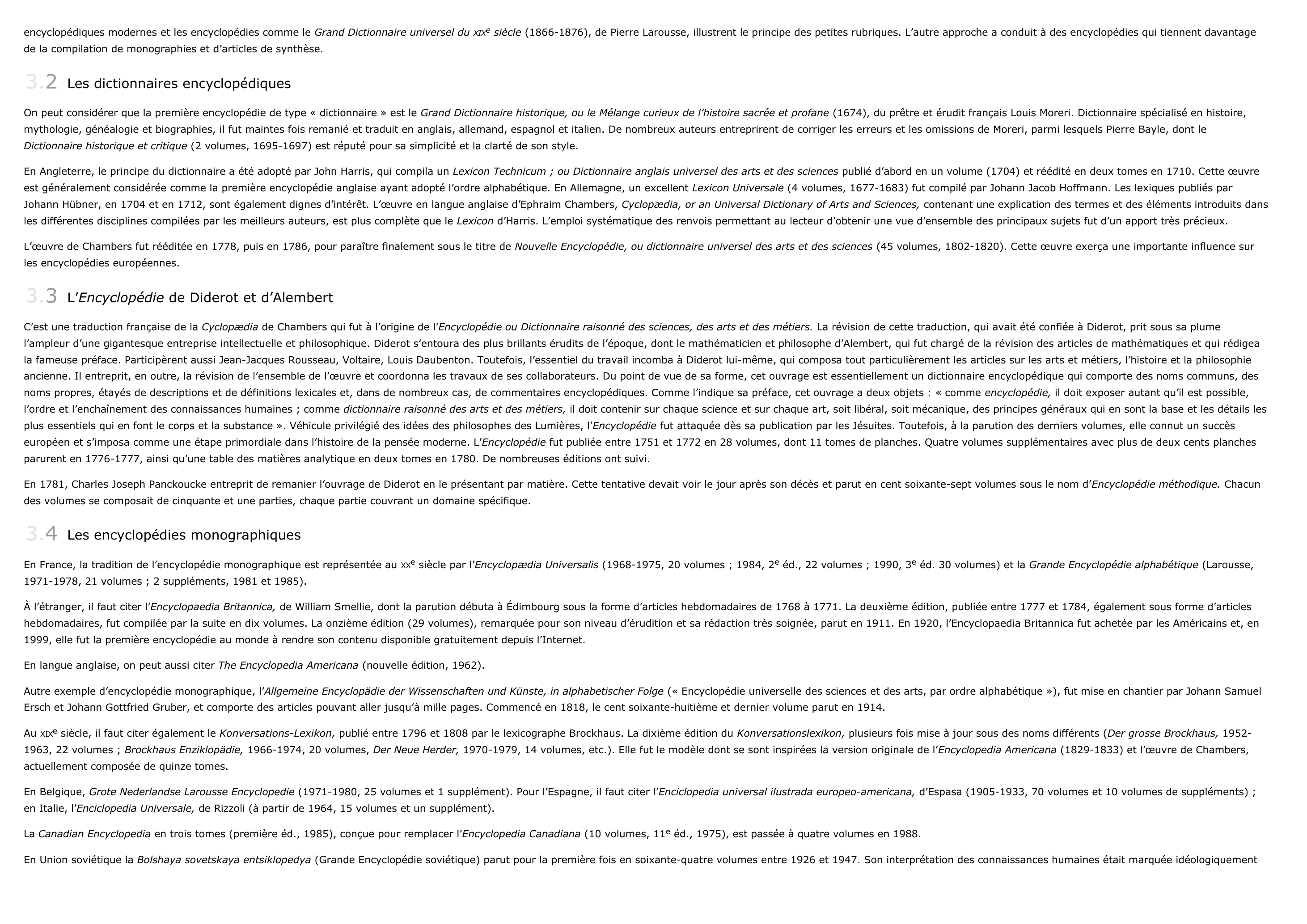encyclopédie.
Publié le 08/05/2013
Extrait du document
«
encyclopédiques modernes et les encyclopédies comme le Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle (1866-1876), de Pierre Larousse, illustrent le principe des petites rubriques.
L’autre approche a conduit à des encyclopédies qui tiennent davantage
de la compilation de monographies et d’articles de synthèse.
3. 2 Les dictionnaires encyclopédiques
On peut considérer que la première encyclopédie de type « dictionnaire » est le Grand Dictionnaire historique, ou le Mélange curieux de l’histoire sacrée et profane (1674), du prêtre et érudit français Louis Moreri.
Dictionnaire spécialisé en histoire,
mythologie, généalogie et biographies, il fut maintes fois remanié et traduit en anglais, allemand, espagnol et italien.
De nombreux auteurs entreprirent de corriger les erreurs et les omissions de Moreri, parmi lesquels Pierre Bayle, dont le
Dictionnaire historique et critique (2 volumes, 1695-1697) est réputé pour sa simplicité et la clarté de son style.
En Angleterre, le principe du dictionnaire a été adopté par John Harris, qui compila un Lexicon Technicum ; ou Dictionnaire anglais universel des arts et des sciences publié d’abord en un volume (1704) et réédité en deux tomes en 1710.
Cette œuvre
est généralement considérée comme la première encyclopédie anglaise ayant adopté l’ordre alphabétique.
En Allemagne, un excellent Lexicon Universale (4 volumes, 1677-1683) fut compilé par Johann Jacob Hoffmann.
Les lexiques publiés par
Johann Hübner, en 1704 et en 1712, sont également dignes d’intérêt.
L’œuvre en langue anglaise d’Ephraim Chambers, Cyclopædia, or an Universal Dictionary of Arts and Sciences, contenant une explication des termes et des éléments introduits dans
les différentes disciplines compilées par les meilleurs auteurs, est plus complète que le Lexicon d’Harris.
L’emploi systématique des renvois permettant au lecteur d’obtenir une vue d’ensemble des principaux sujets fut d’un apport très précieux.
L’œuvre de Chambers fut rééditée en 1778, puis en 1786, pour paraître finalement sous le titre de Nouvelle Encyclopédie, ou dictionnaire universel des arts et des sciences (45 volumes, 1802-1820).
Cette œuvre exerça une importante influence sur
les encyclopédies européennes.
3. 3 L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert
C’est une traduction française de la Cyclopædia de Chambers qui fut à l’origine de l’ Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. La révision de cette traduction, qui avait été confiée à Diderot, prit sous sa plume
l’ampleur d’une gigantesque entreprise intellectuelle et philosophique.
Diderot s’entoura des plus brillants érudits de l’époque, dont le mathématicien et philosophe d’Alembert, qui fut chargé de la révision des articles de mathématiques et qui rédigea
la fameuse préface.
Participèrent aussi Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Louis Daubenton.
Toutefois, l’essentiel du travail incomba à Diderot lui-même, qui composa tout particulièrement les articles sur les arts et métiers, l’histoire et la philosophie
ancienne.
Il entreprit, en outre, la révision de l’ensemble de l’œuvre et coordonna les travaux de ses collaborateurs.
Du point de vue de sa forme, cet ouvrage est essentiellement un dictionnaire encyclopédique qui comporte des noms communs, des
noms propres, étayés de descriptions et de définitions lexicales et, dans de nombreux cas, de commentaires encyclopédiques.
Comme l’indique sa préface, cet ouvrage a deux objets : « comme encyclopédie, il doit exposer autant qu’il est possible,
l’ordre et l’enchaînement des connaissances humaines ; comme dictionnaire raisonné des arts et des métiers, il doit contenir sur chaque science et sur chaque art, soit libéral, soit mécanique, des principes généraux qui en sont la base et les détails les
plus essentiels qui en font le corps et la substance ».
Véhicule privilégié des idées des philosophes des Lumières, l’ Encyclopédie fut attaquée dès sa publication par les Jésuites.
Toutefois, à la parution des derniers volumes, elle connut un succès
européen et s’imposa comme une étape primordiale dans l’histoire de la pensée moderne.
L’ Encyclopédie fut publiée entre 1751 et 1772 en 28 volumes, dont 11 tomes de planches.
Quatre volumes supplémentaires avec plus de deux cents planches
parurent en 1776-1777, ainsi qu’une table des matières analytique en deux tomes en 1780.
De nombreuses éditions ont suivi.
En 1781, Charles Joseph Panckoucke entreprit de remanier l’ouvrage de Diderot en le présentant par matière.
Cette tentative devait voir le jour après son décès et parut en cent soixante-sept volumes sous le nom d’ Encyclopédie méthodique. Chacun
des volumes se composait de cinquante et une parties, chaque partie couvrant un domaine spécifique.
3. 4 Les encyclopédies monographiques
En France, la tradition de l’encyclopédie monographique est représentée au XXe siècle par l’ Encyclopædia Universalis (1968-1975, 20 volumes ; 1984, 2 e éd., 22 volumes ; 1990, 3 e éd.
30 volumes) et la Grande Encyclopédie alphabétique (Larousse,
1971-1978, 21 volumes ; 2 suppléments, 1981 et 1985).
À l’étranger, il faut citer l’ Encyclopaedia Britannica, de William Smellie, dont la parution débuta à Édimbourg sous la forme d’articles hebdomadaires de 1768 à 1771.
La deuxième édition, publiée entre 1777 et 1784, également sous forme d’articles
hebdomadaires, fut compilée par la suite en dix volumes.
La onzième édition (29 volumes), remarquée pour son niveau d’érudition et sa rédaction très soignée, parut en 1911.
En 1920, l’Encyclopaedia Britannica fut achetée par les Américains et, en
1999, elle fut la première encyclopédie au monde à rendre son contenu disponible gratuitement depuis l’Internet.
En langue anglaise, on peut aussi citer The Encyclopedia Americana (nouvelle édition, 1962).
Autre exemple d’encyclopédie monographique, l’ Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste, in alphabetischer Folge (« Encyclopédie universelle des sciences et des arts, par ordre alphabétique »), fut mise en chantier par Johann Samuel
Ersch et Johann Gottfried Gruber, et comporte des articles pouvant aller jusqu’à mille pages.
Commencé en 1818, le cent soixante-huitième et dernier volume parut en 1914.
Au XIXe siècle, il faut citer également le Konversations-Lexikon, publié entre 1796 et 1808 par le lexicographe Brockhaus.
La dixième édition du Konversationslexikon, plusieurs fois mise à jour sous des noms différents ( Der grosse Brockhaus, 1952-
1963, 22 volumes ; Brockhaus Enziklopädie, 1966-1974, 20 volumes, Der Neue Herder, 1970-1979, 14 volumes, etc.).
Elle fut le modèle dont se sont inspirées la version originale de l’ Encyclopedia Americana (1829-1833) et l’œuvre de Chambers,
actuellement composée de quinze tomes.
En Belgique, Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie (1971-1980, 25 volumes et 1 supplément).
Pour l’Espagne, il faut citer l’ Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana, d’Espasa (1905-1933, 70 volumes et 10 volumes de suppléments) ;
en Italie, l’ Enciclopedia Universale, de Rizzoli (à partir de 1964, 15 volumes et un supplément).
La Canadian Encyclopedia en trois tomes (première éd., 1985), conçue pour remplacer l’ Encyclopedia Canadiana (10 volumes, 11 e éd., 1975), est passée à quatre volumes en 1988.
En Union soviétique la Bolshaya sovetskaya entsiklopedya (Grande Encyclopédie soviétique) parut pour la première fois en soixante-quatre volumes entre 1926 et 1947.
Son interprétation des connaissances humaines était marquée idéologiquement.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Diderot et l'Encyclopédie (cours)
- ENCYCLOPÉDIE de Denis Diderot (résumé & analyse)
- ENCYCLOPÉDIE DES SCIENCES PHILOSOPHIQUES EN ABRÉGÉ ou PRÉCIS DE L’ENCYCLOPÉDIE DES SCIENCES PHILOSOPHIQUES, Georg Wilhelm Friedrich Hegel
- ENCYCLOPÉDIE (l') (Histoire de la littérature)
- Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une Société de gens de lettres. Ouvrage collectif dirigé par Denis Diderot