Emma Bovary: entre le rêve et la réalité
Publié le 18/09/2010
Extrait du document
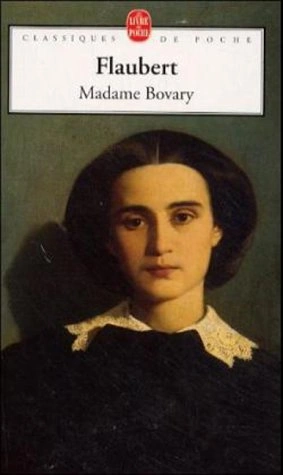
C’est intéressant qu’Emma Bovary soit un personnage littéraire qui n’est pas satisfaite de sa réalité parce qu’elle a lu trop de romans romantiques et veut vivre la vie d’un caractère…littéraire. Comment peut-on dire sérieusement qu’un caractère d’un livre ne vive pas dans la réalité? C’est possible, si la réalité veut dire la réalité du roman, construite part l’écrivain, mais dans ce cas c’est possible aussi parce que Emma est trop romantique pour n’importe quelle réalité, celle du roman, celle du neuvième siècle en France, ou celle d’aujourd’hui. Comme a dit Beatrice Didier, «Elle a une puissance infinie de rêve.«(18) Ses rêves et les efforts de les transformer en réalité ont marque sa vie et ont été la cause de sa déchéance. Dans cette rédaction, je vais examiner les rêves d’Emma, leur origine, leur vanité et leur noblesse, et la divergence grandissante entre eux et la réalité d’Emma qui l’a forcée à quitter le monde du roman en avance.
Beatrice Didier a fait une observation révélatrice sur le nom du caractère principal du roman de Flaubert : Emma Bovary. Le nom lui-même indique le conflit fondamental qui crée son histoire tragique: « Le prénom est tout empreint de rêves romanesques et romantiques, tandis que le nom possède cette solidité normande et bovine, comme si le rapprochement même du nom et du prénom suffisait à définir le drame de l’héroïne. «(13). Pourtant, même si le mariage bourgeois avec Charles est l’obstacle principal qu’empêche Emma de vivre sa vie idéale (au moins, celle est sa perception), ce mariage n’est pas une baisse dans le sens social. Malgré ses airs aristocratiques, on ne doit pas oublier qu’Emma est une paysanne d’origine, et son nom d’enfance, Emma Rouault, n’est guère plus adéquat pour sa nature imaginative que son nom marié. Evidemment, il n’est pas obligatoire que le nom et le milieu social où on est né déterminent la personnalité des gens. Dans la plupart des cas, ils n’ont aucune influence sur les désirs des personnes, mais ils limitent leur réalisation – celle est l’essence du sort humain. Donc, pour n’être pas éternellement (trop) insatisfaits nous sommes éduqués et obligés à modifier notre désirs et a rêver dans une façon réaliste et modérée. La conclusion qui s’impose est que l’éducation d’Emma n’a pas réussi à la préparer pour la vie qui l’attendait, n’a peut pas refréner sa capacité de rêver. Bien qu’elle ait reçu une éducation plus élevé que l’habituelle pour sa classe, elle n’est pas devenue plus réaliste et capable de s’occuper de soi même, de faire face aux difficultés et à la monotonie de sa vie de petite bourgeoise. On apprend de la première Mme Bovary que « …Mme Rouault, élevée au couvent, chez les Ursulines, avait reçu, comme on dit, une belle éducation, qu’elle savait, en conséquence, la danse, la géographie, le dessin, faire de la tapisserie et toucher du piano « (50). Une belle éducation, c’est vrai, l’éducation d’une dame, mais complètement inutile pour une vie active et responsable. Le moral religieux du couvent n’a pu pas impressionner Emma, parce qu’elle a un tempérament plus sensuel qui s’excite parmi des odeurs, images and touchers, qui aime la musique et la beauté et finesse du luxe, et qui est créé pour nager à la surface du lac et pas pour plonger dans les profondeurs métaphysiques de la foi. Elle essaye à substituer les plaisirs terrestres avec la résignation chrétienne encore une fois plus tard, après la rupture de sa relation avec Rodolphe et son départ, mais l’ennui vient vite, suivi par la fin da sa dévotion. Emma est trop passionnante pour être une créature d’autre monde, elle souhaite le bonheur dans ce monde-ci, elle est une femme adultère par excellence.
Cependant, les connaissances énumérées ci-dessus qu’Emma a acquises dans le couvent forment une part moins importante de son éducation. Sa vraie éducation a été la lecture des romans réalistes et romantiques, la lecture qui n’était pas organisé ni contrôlé par personne. Ce sont des livres qu’ont formé sa vision de la vie, ses idées de l’avenir et ses désirs. Les romans historiques de Walter Scott ont suscite son ensorcellement par les histoires chevaleresques et la vie aristocratique ; les romans romantiques ont créé son admiration aux grands amours et grandes passions. Elle persiste dans ces lectures pendant toute sa vie et ne renonce pas ce source permanent d’images et émotions dont vient sa naïveté et son romantisme exagéré. Étant donne que la lecture d’Emma est responsable pour ses rêves mal appropriés à la réalité, on peut dire que les livres ont précipité sa catastrophe, que sa lecture a été fatale. Selon Jules de Gaultier, « …l’éducation de la paysanne au couvent des Ursulines, dans un milieu aristocratique et mystique, l’influence romantique, agissant sur elle par les lectures publiques ou secrets, sont les causes des appétits de luxe en même temps que de la avidité sentimentale qui se développent dans l’âme de la jeune fille. « (29). Il nomme cette éducation une éducation romanesque.
Ayant établi l’origine des rêves d’Emma, maintenant il faut considérer leur fond et leur but. Ils ont deux dimensions qui sont interconnectées et inséparables dans l’imagination d’Emma. À la première place, elle veut éprouver des sentiments exaltés, elle rêve d’un grand amour raffiné, d’une passion incontrôlable qui dirige tous les pensées et actions vers un dévouement complète. Puis, elle rêve des richesses, des bals masqués, de vivre la vie d’une aristocrate haute. Emma a une fausse conception que les grands amours ne poussent bien que dans des cours d’or, que les vertus seulement existent où il y a des vêtements élégants et des manières hautes et délicates : « Elle confondait, dans son désir, les sensualités du luxe avec les joies du cœur, l’élégance des habitudes et les délicatesses du sentiment. « Ensuite: « Les soupirs au clair de lune, les longues étreintes, les larmes qui coulent sur les mains qu’on abandonne, toutes les fièvres de la chair et les langueurs de la tendresse ne se séparaient donc pas du balcon des grands châteaux… « (92)
Emma veut, donc, entre une grande dame, mais cela n’est pas possible car elle est marie avec un médecin de campagne et seulement peut avoir accès a une vie provinciale et limitée. Il est facile de percevoir la vanité et la futilité de ses rêveries et il semble que l’auteur-même tourne son romantisme en dérision. C’est fascinant comme elle devient égoïste et ne s’intéresse à aucune chose qui n’est pas liée à ses rêves, étant complètement absorbée dans sa propre insatisfaction. Elle ne prend pas soin de sa fille, s’occupe de sa maison seulement quand elle est de bonne humeur et pour satisfaire ses fantaisies extravagantes. Son mari Charles est un mal inévitable et il faut rassembler toute la force pour pouvoir supporter sa médiocrité. Emma pense que Charles est le seul coupable pour son malheur et croit qu’elle fasse un énorme sacrifice pour qu’il soit calme et stupidement content. Par exemple, après la défaillance de l’essai de Charles à curer Hyppolite Emma pense : « Comment donc avait-elle fait (elle qui était si intelligente!) pour se méprendre encore une fois? Du reste, par quelle déplorable manie avoir ainsi abime son existence en sacrifices continuels? «. Et un peu plus tard: «C’était pour lui cependant, pour cet être, pour cet homme qui ne comprenait rien, qui ne sentait rien! « (218) Néanmoins, que l’ironie soit complète, tandis que ses amants Rodolphe et Léon dorment paisiblement la nuit où elle est morte, cet être et le seul qui souffre, qui sent une foule de choses. Beatrice Didier suggère que après la mort d’Emma Charles se transforme dans une façon surprenante, qu’il devient l’homme idéal qu’elle aurait pu aimer, avec lequel elle aurait pu partager ses rêves. « Pour lui plaire, comme si elle vivait encore, il adopta ses prédilections, ses idées ; il s’acheta des bottes vernies, il prit l’usage des cravates blanches. Il mettait du cosmétique a ses moustaches, il souscrivit comme elle des billets a ordre. Elle le corrompait par-delà le tombeau (p.375-376) «.
Nous avons considéré la situation sociale d’Emma comme la raison principale pour l’impossibilité de réaliser ses rêves. Sa situation sociale est liée avec le fait qu’elle est femme et avec la position des femmes bourgeoises en France au 19iéme siècle. Elle-même est consciente de n’être pas aussi libre qu’un homme, et Flaubert nous donne son avis sur la question féminine lorsqu’elle s’attend à la naissance de son enfant: « Elle souhaitait un fils ; il serait fort et brun, elle l’appellerait Georges ; et cette idée d’avoir pour un enfant un male était comme la revanche en espoir de toutes ses impuissances passées. Un homme, au moins est libre ; il peut parcourir les passions et lest pays, traverser les obstacles, mordre aux bonheurs les plus lointains. Mais une femme est empêchée continuellement. Inerte et flexible a la fois, elle a contre les mollesses de la chair avec les dépendances de la loi. Sa volonté, comme le voile de son chapeau retenu par un cordon, palpite a tous les vents ; il ya toujours quelque désir qui entraine, quelque convenance qui retient. « (123) Sans doute, cette réflexion présente les conditions véritables dans lesquelles vivaient les femmes à ce temps-là, qui sont vraiment un obstacle pour Emma et ses désirs imaginaires. Toutefois, il y a aussi une distinction de classe ici; si Emma avait une vie difficile et occupée, si elle devait travailler comme Catherine Leroux, par exemple, peut-être son insatisfaction n’existerait pas. Beatrice Didier est d’accord sur le fait qu’un aspect du drame d’Emma Bovary est l’image de la condition féminine au 19iéme siècle: « Il est bien probable qu’Emma n’aurait pas connu la même fin si elle avait eu une indépendance financière, une formation juridique, la possibilité de gagner de l’argent et l’art d’en disposer. « Et ensuite: «On peut dire que tous les héros de Flaubert, des qu’ils ont certaine consistance, en sont atteints, si par la on entend une possibilité infinie de rêver et d’être déçu par la réalité. Mais les héros s’en sortent mieux que les héroïnes, ce qui est logique dans le contexte social où ils vivent. Léon a beaucoup rêve; mais il revient sur terre et épouse – ironie de l’écrivain- une Mlle Lebœuf. Frédéric aussi se remettra se ses Illusions perdues : ce n’aura été qu’une étape nécessaire de toute éducation sentimentale ; Emma, elle, en meurt. «(21)
La possibilité infinie de rêver et d’être déçu par la réalité mentionnée par Didier a été appelée par Jules de Gaultier le bovarysme, d’après le nom de l’épitomé de cette tendance chez les personnages de Flaubert, Emma Bovary. Dans son livre Le bovarysme, Jules de Gaultier a développé tout une théorie psychologique basée sur les caractères des livres de Flaubert. Selon Gaultier, le bovarysme et le pouvoir départi à l’homme de se concevoir autre qu’il n’est (13), la faculté d’avoir les aspirations qui s’opposent aux tendances naturelles de l’être. Gaultier en plus ajoute que « cette défaillance de la personnalité est toujours accompagne d’une impuissance, et s’ils se conçoivent autres qu’ils ne sont, ils ne parviennent point a s’égaler au modèle qu’ils se sont proposes «. (14) Cet analyse peut être parfaitement applique sur le cas d’Emma et expliquer dans une façon révélatrice son insatisfaction permanente. Considérons cette exclamation comme exemple : « N’importe ! elle n’était pas heureuse, ne l’avait jamais été. D’où venait donc cette insuffisance de la vie, cette pourriture instantanée des choses ou elle s’appuyait ? « (319) Cependant au début il y a une affirmation problématique dans la théorie de Gaultier. Il parle des « tendances naturelles « qui sont contredite par les rêves des héros. Si on chercherait d’établir quelles sont ces tendances naturelles chez Emma qui sont cachées par ses rêves, on ne trouverait rien, parce que la tendance la plus naturelle chez Emma est sa tendance de rêver à l’infini. Gaultier comprend sa parfaitement et il procède vers la conclusion que le bovarysme est une faculté et tendance humaine universelle. Il n’y a rien plus naturel de se concevoir autre qu’on n’est, au contraire, cette tendance est la force agissante des tous les changements, du développement de la personnalité, de la croissance des gens. « Devenir autre est la loi de la vie. « (211), dit Jules de Gaultier. En plus : « Quelle que soit l’hypothèse, il reste que la vie phénoménale ne nous est donnée que dans le mouvement. Elle n’est pas figée dans le fait de l’existence pure et simple. A vrai dire, elle n’est pas, elle devient. Elle devient, cela signifie – et c’est un pléonasme de l’énoncer – qu’elle devient à tout moment autre qu’elle n’était. « (211)
Le mouvement des rêves humains est finalement la source du progrès entier de l’humanité. « Ce concevoir autre, c’est vivre et progresser. « (212) On peut voir Emma Bovary comme un des grands overreachers de la littérature mondiale – docteur Faust, Ulysse et autres, mais aussi comme un des billions êtres humains qui vivent pour rêver, parce que à la fin ce sont les rêves, l’espoir, qui nous donnent la force de persister dans la lutte permanente qui est la vie. Parfois, les rêves peuvent précipiter une fin tragique du rêveur, et faire mal aux autres, comme dans le cas d’Emma. D’ici un idée vague que si les rêves et les passions d’Emma étaient plus modérés, peut-être elle, Charles et la petite Berthe auraient un sort moins malheureux. Mais, dans cette cas elle ne serait pas Emma Bovary, une héroïne irrésistiblement romantique dans un roman réaliste, et le roman-même de Flaubert ne serait un tel l’chef-d-ouvre.
Liens utiles
- Mariée à Charles Bovary et mère d'une petite fille, Berthe, Emma a formé le projet de s'enfuir avec son amant Rodolphe. Tandis que son époux dort, elle, à ses côtés, demeure éveillée et rêve.
- Madame Bovary : Le Rêve d'Emma (Partie II Chapitre 12) - Flaubert- commentaire
- Gustave FLAUBERT, Madame Bovary (Mariée depuis peu au médecin Charles Bovary et installée dans une petite ville de province, Emma rêve de Paris. L'intrigue se déroule au XIXe siècle.)
- Gustave Flaubert, Madame Bovary : Vous ferez un commentaire composé de ce texte, en montrant en particulier comment Flaubert présente le caractère de son héroïne à travers la transformation qu'elle fait subir, dans son rêve, à la réalité
- Madame Bovary mort d'Emma































