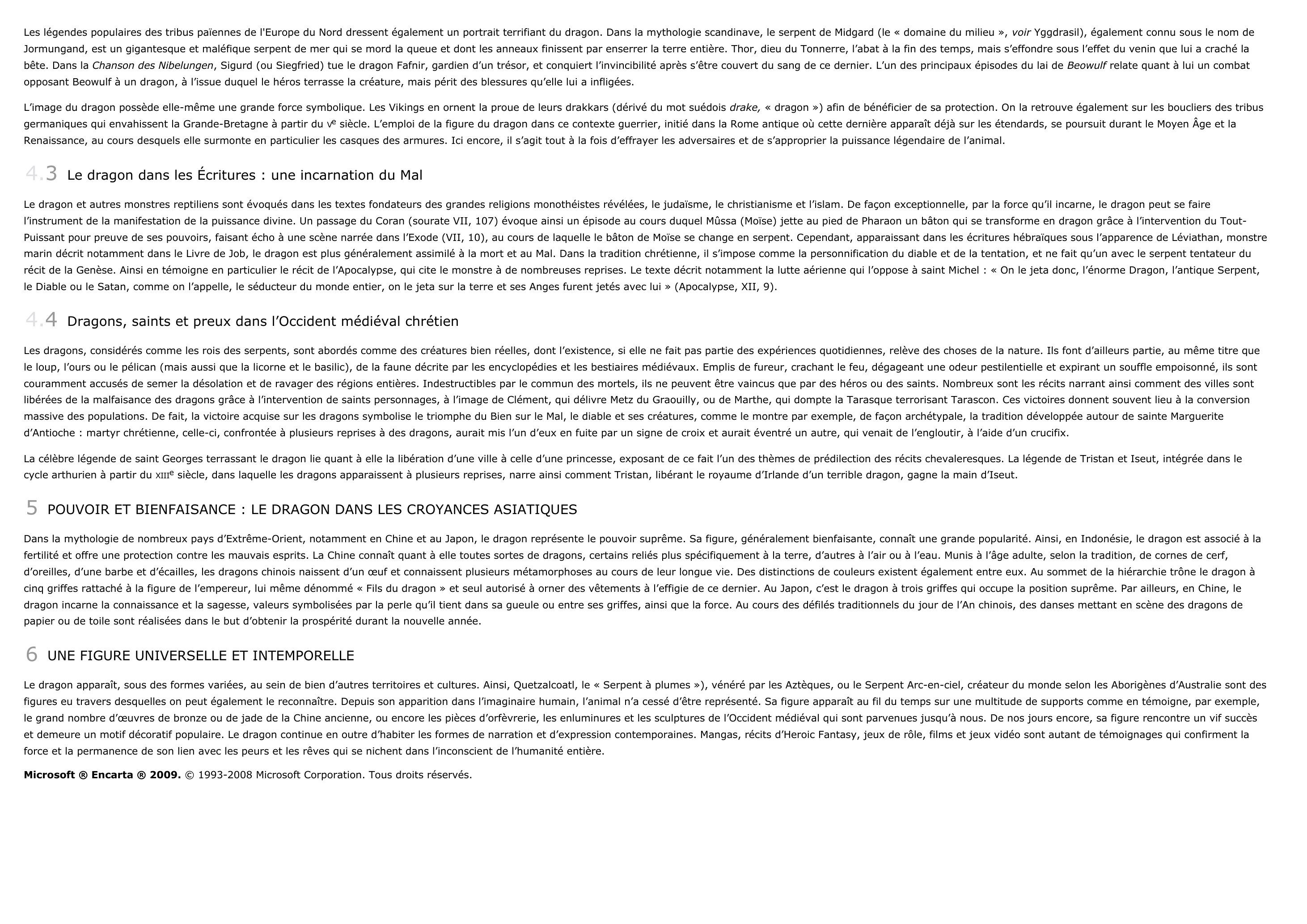dragon - littérature.
Publié le 28/04/2013
Extrait du document
«
Les légendes populaires des tribus païennes de l'Europe du Nord dressent également un portrait terrifiant du dragon.
Dans la mythologie scandinave, le serpent de Midgard (le « domaine du milieu », voir Yggdrasil), également connu sous le nom de
Jormungand, est un gigantesque et maléfique serpent de mer qui se mord la queue et dont les anneaux finissent par enserrer la terre entière.
Thor, dieu du Tonnerre, l’abat à la fin des temps, mais s’effondre sous l’effet du venin que lui a craché la
bête.
Dans la Chanson des Nibelungen , Sigurd (ou Siegfried) tue le dragon Fafnir, gardien d’un trésor, et conquiert l’invincibilité après s’être couvert du sang de ce dernier.
L’un des principaux épisodes du lai de Beowulf relate quant à lui un combat
opposant Beowulf à un dragon, à l’issue duquel le héros terrasse la créature, mais périt des blessures qu’elle lui a infligées.
L’image du dragon possède elle-même une grande force symbolique.
Les Vikings en ornent la proue de leurs drakkars (dérivé du mot suédois drake, « dragon ») afin de bénéficier de sa protection.
On la retrouve également sur les boucliers des tribus
germaniques qui envahissent la Grande-Bretagne à partir du Ve siècle.
L’emploi de la figure du dragon dans ce contexte guerrier, initié dans la Rome antique où cette dernière apparaît déjà sur les étendards, se poursuit durant le Moyen Âge et la
Renaissance, au cours desquels elle surmonte en particulier les casques des armures.
Ici encore, il s’agit tout à la fois d’effrayer les adversaires et de s’approprier la puissance légendaire de l’animal.
4. 3 Le dragon dans les Écritures : une incarnation du Mal
Le dragon et autres monstres reptiliens sont évoqués dans les textes fondateurs des grandes religions monothéistes révélées, le judaïsme, le christianisme et l’islam.
De façon exceptionnelle, par la force qu’il incarne, le dragon peut se faire
l’instrument de la manifestation de la puissance divine.
Un passage du Coran (sourate VII, 107) évoque ainsi un épisode au cours duquel Mûssa (Moïse) jette au pied de Pharaon un bâton qui se transforme en dragon grâce à l’intervention du Tout-
Puissant pour preuve de ses pouvoirs, faisant écho à une scène narrée dans l’Exode (VII, 10), au cours de laquelle le bâton de Moïse se change en serpent.
Cependant, apparaissant dans les écritures hébraïques sous l’apparence de Léviathan, monstre
marin décrit notamment dans le Livre de Job, le dragon est plus généralement assimilé à la mort et au Mal.
Dans la tradition chrétienne, il s’impose comme la personnification du diable et de la tentation, et ne fait qu’un avec le serpent tentateur du
récit de la Genèse.
Ainsi en témoigne en particulier le récit de l’Apocalypse, qui cite le monstre à de nombreuses reprises.
Le texte décrit notamment la lutte aérienne qui l’oppose à saint Michel : « On le jeta donc, l’énorme Dragon, l’antique Serpent,
le Diable ou le Satan, comme on l’appelle, le séducteur du monde entier, on le jeta sur la terre et ses Anges furent jetés avec lui » (Apocalypse, XII, 9).
4. 4 Dragons, saints et preux dans l’Occident médiéval chrétien
Les dragons, considérés comme les rois des serpents, sont abordés comme des créatures bien réelles, dont l’existence, si elle ne fait pas partie des expériences quotidiennes, relève des choses de la nature.
Ils font d’ailleurs partie, au même titre que
le loup, l’ours ou le pélican (mais aussi que la licorne et le basilic), de la faune décrite par les encyclopédies et les bestiaires médiévaux.
Emplis de fureur, crachant le feu, dégageant une odeur pestilentielle et expirant un souffle empoisonné, ils sont
couramment accusés de semer la désolation et de ravager des régions entières.
Indestructibles par le commun des mortels, ils ne peuvent être vaincus que par des héros ou des saints.
Nombreux sont les récits narrant ainsi comment des villes sont
libérées de la malfaisance des dragons grâce à l’intervention de saints personnages, à l’image de Clément, qui délivre Metz du Graouilly, ou de Marthe, qui dompte la Tarasque terrorisant Tarascon.
Ces victoires donnent souvent lieu à la conversion
massive des populations.
De fait, la victoire acquise sur les dragons symbolise le triomphe du Bien sur le Mal, le diable et ses créatures, comme le montre par exemple, de façon archétypale, la tradition développée autour de sainte Marguerite
d’Antioche : martyr chrétienne, celle-ci, confrontée à plusieurs reprises à des dragons, aurait mis l’un d’eux en fuite par un signe de croix et aurait éventré un autre, qui venait de l’engloutir, à l’aide d’un crucifix.
La célèbre légende de saint Georges terrassant le dragon lie quant à elle la libération d’une ville à celle d’une princesse, exposant de ce fait l’un des thèmes de prédilection des récits chevaleresques.
La légende de Tristan et Iseut, intégrée dans le
cycle arthurien à partir du XIIIe siècle, dans laquelle les dragons apparaissent à plusieurs reprises, narre ainsi comment Tristan, libérant le royaume d’Irlande d’un terrible dragon, gagne la main d’Iseut.
5 POUVOIR ET BIENFAISANCE : LE DRAGON DANS LES CROYANCES ASIATIQUES
Dans la mythologie de nombreux pays d’Extrême-Orient, notamment en Chine et au Japon, le dragon représente le pouvoir suprême.
Sa figure, généralement bienfaisante, connaît une grande popularité.
Ainsi, en Indonésie, le dragon est associé à la
fertilité et offre une protection contre les mauvais esprits.
La Chine connaît quant à elle toutes sortes de dragons, certains reliés plus spécifiquement à la terre, d’autres à l’air ou à l’eau.
Munis à l’âge adulte, selon la tradition, de cornes de cerf,
d’oreilles, d’une barbe et d’écailles, les dragons chinois naissent d’un œuf et connaissent plusieurs métamorphoses au cours de leur longue vie.
Des distinctions de couleurs existent également entre eux.
Au sommet de la hiérarchie trône le dragon à
cinq griffes rattaché à la figure de l’empereur, lui même dénommé « Fils du dragon » et seul autorisé à orner des vêtements à l’effigie de ce dernier.
Au Japon, c’est le dragon à trois griffes qui occupe la position suprême.
Par ailleurs, en Chine, le
dragon incarne la connaissance et la sagesse, valeurs symbolisées par la perle qu’il tient dans sa gueule ou entre ses griffes, ainsi que la force.
Au cours des défilés traditionnels du jour de l’An chinois, des danses mettant en scène des dragons de
papier ou de toile sont réalisées dans le but d’obtenir la prospérité durant la nouvelle année.
6 UNE FIGURE UNIVERSELLE ET INTEMPORELLE
Le dragon apparaît, sous des formes variées, au sein de bien d’autres territoires et cultures.
Ainsi, Quetzalcoatl, le « Serpent à plumes »), vénéré par les Aztèques, ou le Serpent Arc-en-ciel, créateur du monde selon les Aborigènes d’Australie sont des
figures eu travers desquelles on peut également le reconnaître.
Depuis son apparition dans l’imaginaire humain, l’animal n’a cessé d’être représenté.
Sa figure apparaît au fil du temps sur une multitude de supports comme en témoigne, par exemple,
le grand nombre d’œuvres de bronze ou de jade de la Chine ancienne, ou encore les pièces d’orfèvrerie, les enluminures et les sculptures de l’Occident médiéval qui sont parvenues jusqu’à nous.
De nos jours encore, sa figure rencontre un vif succès
et demeure un motif décoratif populaire.
Le dragon continue en outre d’habiter les formes de narration et d’expression contemporaines.
Mangas, récits d’Heroic Fantasy, jeux de rôle, films et jeux vidéo sont autant de témoignages qui confirment la
force et la permanence de son lien avec les peurs et les rêves qui se nichent dans l’inconscient de l’humanité entière.
Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation.
Tous droits réservés..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Madame Bovary et la littérature sentimentale
- l'histoire de la littérature
- En quoi la littérature et le cinéma participent-ils à la construction de la mémoire de la Shoah ? (exemple du journal d'Hélène Berr)
- Fiche pédagogique Littérature francophone
- Comment la littérature peut-elle témoigner de la violence de l’histoire ?