D'Holbach Système de la nature ou des lois du monde physique et du monde moral
Publié le 22/02/2012
Extrait du document
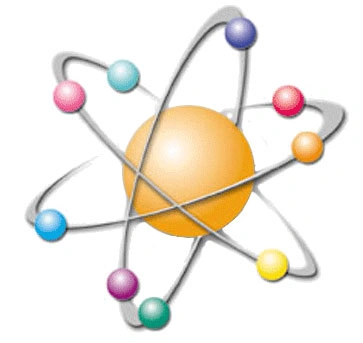
D'Holbach
Système de la nature ou des lois du monde physique et du monde moral
1770
T. II, partie II, ch. 1
Si les dieux des nations furent enfantés dans le sein des alarmes, ce fut encore dans celui de la douleur que chaque homme façonne la puissance inconnue qu'il se fit pour lui-même. Faute de connoître les causes naturelles et leurs façons d'agir, lorsqu'il éprouve quelque infortune ou quelque sensation fâcheuse, il ne sait à qui s'en prendre. Les mouvemens qui malgré lui s'excitent au dedans de lui-même, ses maladies, ses peines, ses passions, ses inquiétudes, les altérations douloureuses que sa machine éprouve sans en démêler les vraies sources, enfin la mort, sont des effets dont l'aspect est si redoutable pour un être fortement attaché à la vie, dont des effets qu'il regarde comme surnaturels, parce qu'ils sont contraires à sa nature actuelle ; il les attribue donc à quelque cause puissante, qui, malgré tous ses efforts, dispose à chaque instant de lui. Son imagination désespérée des maux qu'il trouve inévitables, lui crée sur le champ quelque phantôme, sous lequel la conscience de sa propre foiblesse l'oblige de frissonner. C'est alors que, malgré la terreur, il médite tristement sur ses peines, et cherche en tremblant les moyens de les écarter, en désarmant le courroux de la chimère qui le poursuit. Ce fut donc toujours dans l'attelier de la tristesse que l'homme malheureux a façonné le phantôme dont il a fait son Dieu. Nous ne jugeons jamais des objets que nous ignorons que d'après ceux que nous sommes à portée de connoître. L'homme, d'après lui-même, prête une volonté, de l'intelligence, du dessein, des projets, des passions, en un mot des qualités analogues aux siennes, à toute cause inconnue qu'il sent agir sur lui. Dès qu'une cause visible ou supposée l'affecte d'une façon agréable ou favorable à son être, il la juge bonne et bien intentionnée pour lui : il juge au contraire que toute cause qui lui fait éprouver des sensations fâcheuses est mauvaise par sa nature et dans l'intention de lui nuire. Il attribue des vues, un plan, un systéme de conduite à tout ce qui paroît produire de soi-même des effets liés, agir avec ordre et suite, opérer constamment les mêmes sensations sur lui. D'après ces idées, que l'homme emprunte toujours de lui-même et de sa propre façon d'agir, il aime ou il craint les objets qui l'ont affecté ; il s'en approche avec confiance ou avec crainte ; il les cherche, ou il les suit quand il croit pouvoir se soustraire à leur puissance. Bientôt il leur parle, il les invoque, il les prie de lui accorder leur assistance, ou de cesser de l'affliger ; il tâche de les gagner par des soumissions, par des bassesses, par des présens, auxquels il se trouve lui-même sensible ; enfin il exerce l'hospitalité à leur égard, il leur donne un azyle, il leur fait une demeure, et leur fournit les choses qu'il juge devoir leur plaire le plus, parce qu'il y attache lui-même un très grand prix. Ces dispositions servent à nous rendre compte de la formation de ces dieux tutélaires, que chaque homme se fait dans les nations sauvages et grossieres. Nous voyons que des hommes simples regardent comme les arbitres de leur sort des animaux, des pierres, des substances informes et inanimées, des fétiches, qu'ils transforment en Divinités, en leur prêtant de l'intelligence, des desirs et des volontés.
Il est encore une disposition qui servit à tromper l'homme sauvage, et qui trompera tous ceux que la raison n'aura point désabusés des apparences, c'est le concours fortuit de certains effets avec des causes qui ne les ont point produits, ou la coëxistence des ces effets avec de certaines causes qui n'ont avec eux aucunes liaisons véritables. C'est ainsi que le sauvage attribuera la bonté ou la volonté de lui faire du bien à quelque objet, soit animé soit inanimé, tel qu'une pierre d'une certaine forme, une roche, une montagne, un arbre, un serpent, un animal, etc. si toutes les fois qu'il a rencontré ces objets, les circonstances ont voulu qu'il eût un bon succès à la chasse, à la pêche, à la guerre, ou dans une autre entreprise. Le même sauvage, tout aussi gratuitement, attachera l'idée de malice ou de méchanceté à un objet quelconque qu'il aura rencontré les jours où il éprouvera quelqu'accident fâcheux ; incapable de raisonner, il ne voit pas que ces effets divers sont dûs à des causes naturelles, à des circonstances nécessaires ; il trouve plus court d'en faire honneur à des causes incapables d'influer sur lui, ou de lui vouloir du bien et du mal ; conséquemment son ignorance et la paresse de son esprit les divinisent, c'est-à-dire, leur prêtent de l'intelligence, des passions, des desseins, et leur supposent un pouvoir surnaturel. Le Sauvage n'est jamais qu'un enfant ; celui-ci frappe l'objet qui lui déplaît, de même que le chien mord la pierre qui le blesse ; sans remonter à la main qui la lui jette.
Tel est encore dans l'homme sans expérience le fondement de la foi qu'il a pour les présages heureux ou malheureux ; il les regarde comme des avertissemens donnés par ses dieux ridicules, à qui il attribue une sagacité, une prévoyance, des facultés dont il est lui-même dépourvu. L'ignorance et le trouble font que l'homme croit une pierre, un reptile, un oiseau, beaucoup plus instruits que lui-même. Le peu d'observations que fit l'homme ignorant ne firent que le rendre plus superstitieux ; il vit que certains oiseaux annonçoient par leur vol, du beau tems, des orages ; il vit qu'en certains tems il sortoit des vapeurs du fond de quelques cavernes ; il n'en fallut pas davantage pour lui faire croire que ces êtres connoissoient l'avenir et jouissoient de don de la prophétie.
Si peu-à-peu l'expérience et la réflexion parviennent à détromper l'homme de la puissance, de l'intelligence et des vertus qu'il avoit d'abord assignées à des objets insensibles ; il les suppose du moins mis en jeu par quelque cause secrete, par quelque agent invisible, dont ils sont les instrumens ; c'est alors à cet agent caché qu'il s'adresse ; il lui parle, il cherche à le gagner, il implore son assistance, il veut fléchir sa colere ; et pour y réussir, il emploie les mêmes moyens dont il se serviroit pour appaiser ou gagner les êtres de son espece.
T. II, partie II, ch. 4
D'ailleurs l'universalité d'une opinion ne prouve rien en faveur de sa vérité. Ne voyons-nous pas un grand nombre de préjugés et d'erreurs grossières jouir même aujourd'hui de la sanction presqu'universelle du genre-humain ? Ne voyons-nous pas tous les peuples de la terre imbus des idées de la magie, de divinations, d'enchantemens, de présages, de sortilèges, de revenans ? Si les personnes les plus instruites se sont guéries de ces préjugés, ils trouvent encore des partisans très zélés dans le plus grand nombre des hommes, qui les croient pour le moins aussi fermement que l'existence d'un Dieu. En conclura-t-on que ces chimères appuyées du consentement presqu'unanime de l'espèce humaine, ont quelque réalité ? Avant Copernic il n'y avoit personne qui ne crût que la terre étoit immobile, et que le soleil tournoit autour d'elle ; cette opinion universelle en étoit-elle moins une erreur pour cela ? Chaque homme a son Dieu : tous ces Dieux existent-ils, ou n'en existe-t-il aucun ? Mais on nous dira, chaque homme a son idée du soleil, tous ces soleils existent-ils ? Il est facile de répondre que l'existence du soleil est un fait constaté par l'usage journalier des sens, au lieu que l'existence d'un Dieu n'est constatée par l'usage d'aucun sens ; tout le monde voit le soleil, mais personne ne voit Dieu. Voilà la seule différence entre la réalité et la chimère : la réalité est presqu'aussi diverse dans la tête des hommes que la chimère, mais l'une existe et l'autre n'existe pas ; il y a d'un côté des qualités sur lesquelles on ne dispute point, de l'autre côté on dispute sur toutes les qualités. Personne n'a jamais dit, il n'y a point de soleil ou le soleil n'est point lumineux et chaud, au lieu que plusieurs hommes sensés ont dit, il n'y a point de Dieu. Ceux qui trouvent cette proposition affreuse et insensée et qui affirment que Dieu existe, ne nous disent-ils pas en même tems qu'ils ne l'ont jamais vu ni senti et que l'on n'y connoît rien ? La Théologie est un monde où tout suit les Loix inverses de celui que nous habitons !
Que devient donc cet accord si vanté de tous les hommes à reconnoître un Dieu et la nécessité du culte qu'on doit lui rendre ? Il prouve qu'eux, ou leurs Peres ignorans, ont éprouvé des malheurs sans pouvoir les rapporter à leurs véritables causes. Si nous avions le courage d'examiner les choses de sang froid et de mettre à l'écart les préjugés que tout conspire à rendre aussi durables que nous, nous serions bien-tôt forcés de reconnoître que l'idée de la divinité ne nous est aucunement infuse par la nature, qu'il fut un tems où elle n'existoit point en nous, et que nous verrions que nous la tenons par tradition de ceux qui nous ont élevés, que ceux-ci l'avoient reçue de leurs ancêtres, et qu'en dernier ressort elle est venue des Sauvages ignorans qui furent nos premiers pères, ou si l'on veut, des Législateurs adroits qui sçurent mettre à profit les craintes, l'ignorance et la crédulité de nos devanciers pour les soumettre à leur joug.
Cependant il y eut des mortels qui se vanterent d'avoir vu la divinité : le premier qui osa le dire aux hommes fut évidemment un menteur, dont l'objet fut de tirer parti de leur simplicité crédule, ou un enthousiaste, qui débita pour des vérités les rêveries de son imagination. Nos ancêtres nous ont transmis les divinités qu'ils avoient ainsi reçues de ceux qui les ont trompés eux-mêmes, et dont les fourberies modifiées depuis, d'âges en âges ont peu-à-peu acquis la fonction publique et la solidité que nous voyons. En conséquence le nom de Dieu est un des premiers mots que l'on ait fait retentir dans nos oreilles ; on nous en a parlé sans cesse, on nous l'a fait balbutier avec respect et crainte, on nous a fait un devoir d'adresser nos voeux et de réfléchir le genou devant un phantôme que ce nom représentoit, mais qu'il ne nous fut jamais permis d'examiner. À force de nous menacer de cette chimère, à force de nous raconter les antiques fables qu'on lui attribue, nous nous persuadons que nous en avons des idées, nous confondons des habitudes machinales avec les instincts de notre nature, et nous croyons bonnement que tout homme apporte au monde l'idée de la divinité.
C'est faute de nous rappeller les premieres circonstances où notre imagination fut frappée du nom de Dieu et des récits merveilleux qui nous ont été faits pendant le cours de notre enfance et de notre éducation, que nous croyons cette idée abstraite inhérente à notre être et innée dans tous les hommes.
Notre mémoire ne nous rappelle pas la succession des causes qui ont gravé ce nom dans notre cerveau. C'est uniquement par habitude que nous admirons et craignons un objet que nous ne connoissons que par le nom dont nous l'avons entendu désigner, dès l'enfance. Aussi-tôt qu'on le prononce, nous lui associons machinalement et sans réflexion les idées que ce mot réveille dans notre imagination, et les sensations dont on nous a dit qu'il devoit être accompagné. Ainsi, pour peu que nous voulions être de bonne foi avec nous-mêmes, nous conviendrons que l'idée de Dieu et des qualités que nous lui attribuons, n'a d'autre fondement que l'opinion de nos peres, traditionnellement infuse en nous par l'éducation, confirmée par l'habitude et fortifiée par l'exemple et par l'autorité.
On voit donc comment les idées de Dieu, enfantées dans l'origine par l'ignorance, l'admiration et la crainte ; adoptées par l'expérience et la crédulité ; propagées par l'éducation, par l'exemple, par l'habitude, par l'autorité sont devenues inviolables et sacrées ; nous les avons reçues malgré nous sur la parole de nos peres, de nos instituteurs, de nos législateurs, de nos prêtres ; nous y tenons par habitude et sans les avoir jamais examinées ; nous les regardons comme sacrées, parce qu'on nous a toujours assuré qu'elles étoient essentielles à notre bonheur ; nous croyons les avoir toujours eues, parce que nous les avions dès notre enfance ; nous les jugeons indubitables, parce que nous n'avions jamais eu l'intrépidité d'en douter. Si notre sort nous eût fait naître sur les côtes de l'Afrique, nous adorerions avec autant d'ignorance et de simplicité le serpent révéré par les Nègres, que nous adorons le Dieu spirituel et métaphysique que l'on adore en Europe. Nous serions aussi indignés si quelqu'un nous disputoit la divinité de ce reptile, que nous aurions appris à respecter au sortir du sein de nos meres, que nos Théologiens le sont quand on dispute à leur Dieu les attributs merveilleux dont ils l'ont orné. Cependant si l'on contestoit ses titres et ses qualités au Dieu serpent des Nègres, au moins ne pourroit-on pas lui contester son existence, dont on seroit à portée de se convaincre par ses yeux. Il n'en est pas de même du Dieu immatériel, incorporel, contradictoire, ou de l'homme divinisé que nos penseurs modernes ont si subtilement composé. À force de rêver, de raisonner, de subtiliser, ils ont rendu son existence impossible pour quiconque osera le méditer de sang froid. On ne pourra jamais se figurer un être qui n'est composé que d'abstractions et de qualités négatives, c'est-à-dire, qui n'a aucune des qualités que l'esprit humain est susceptible de juger. Nos Théologiens ne savent ce qu'ils adorent ; ils n'ont aucune idée réelle de l'être dont ils s'occupent sans cesse ; cet être seroit depuis long-tems anéanti, si ceux à qui on l'annonce avoient osé l'examiner.
En effet, dès le premier pas nous nous trouvons arrêtés : l'existence même de l'être le plus important et le plus révéré est encore un problême pour quiconque veut peser de sang froid les preuves qu'en donne la Théologie ; et quoiqu'avant de raisonner ou de disputer sur la nature et les qualités d'un être il fût à propos de constater son existence, celle de la divinité n'est rien moins que démontrée pour tout homme qui voudra consulter le bon sens. Que dis-je ! les Théologiens eux-mêmes n'ont presque jamais été d'accord sur les preuves dont on se servoit pour établir l'existence divine. Depuis que l'esprit humain s'occupe de son Dieu, et quand ne s'en est-il pas occupé ! on n'est point jusqu'ici parvenu à démontrer l'existence de cet objet intéressant, d'une façon pleinement satisfaisante, pour ceux-mêmes qui veulent que nous en soyons convaincus. D'âges en âges de nouveaux champions de la divinité, des philosophes profonds, des Théologiens subtils ont cherché de nouvelles preuves de l'existence de Dieu, parce qu'ils étoient, sans doute, peu contens de celles de leurs prédécesseurs. Les penseurs qui s'étoient flattés d'avoir démontré ce grand problême furent souvent accusés d'athéisme, et d'avoir trahi la cause de Dieu par la foiblesse des argumens dont ils l'avoient appuyée. Des hommes d'un très-grand génie ont en effet successivement échoué dans leurs démonstrations ou dans les solutions qu'ils ont voulu donner ; en croyant lever une difficulté, ils en ont continuellement fait éclore cent autres. C'est en pure perte que les plus grands métaphysiciens ont épuisé tous leurs efforts soit pour prouver que Dieu existoit, soit pour concilier ses attributs compatibles, soit pour répondre aux objections les plus simples ; ils n'ont encore pu réussir à mettre leur divinité hors d'atteinte ; les difficultés qu'on leur oppose sont assez claires pour être entendues par un enfant, tandis que dans les nations les plus instruites, l'on trouveroit à peine douze hommes capables d'entendre les démonstrations, les solutions et les réponses d'un Descartes, d'un Leibnitz, d'un Clarcke quand ils veulent nous prouver l'existence de la divinité. N'en soyons point étonnés, les hommes ne s'entendent jamais eux-mêmes quand ils nous parlent de Dieu ; comment pourroient-ils donc s'entendre les uns les autres, ou convenir entr'eux quand ils raisonnent sur la nature et les qualités d'un être créé par des imaginations diverses que chaque homme est forcé de voir diversement, et sur le compte duquel les hommes seront toujours dans une égale ignorance faute d'avoir une mesure commune pour en juger ?
T. II, partie II, ch. 7
Mais, me dira l'enthousiaste heureux, dont l'ame est sensible à ses jouissances, et dont l'imagination attendrie a besoin de se peindre un objet séduisant à qui elle puisse rendre graces de ses prétendus bienfaits, « pourquoi m'ôter un Dieu que je vois sous les traits d'un Souverain rempli de sagesse et de bonté ? Quelle douceur ne trouvé-je point à me figurer un Monarque puissant, intelligent et bon dont je suis le favori, qui s'occupe de mon bien-être, qui veille sans cesse à ma sûreté, qui pourvoit à mes besoins, qui consent que sous lui je commande à la nature entière ? Je crois le voir répandre sans cesse ses bienfaits sur l'homme ; je vois sa Providence travailler pour lui sans relâche ; elle couvre en sa faveur la terre de verdure et les arbres de fruits délicieux ; elle peuple les forêts d'animaux propres à le nourrir ; elle suspend sur sa tête des astres qui l'éclairent pendant le jour, qui guident ses pas incertains pendant la nuit ; elle étend autour de lui l'azur du firmament ; pour réjouir ses yeux elle orne la prairie de fleurs ; elle arrose son séjour de fontaines, de ruisseaux, de rivières. Ah ! Laissez-moi remercier l'auteur de tant de bienfaits. Ne m'ôtez point mon phantôme charmant ; je ne trouverai point mes illusions si douces dans une nécessité sévère, dans une matière aveugle et inanimée, dans une nature privée d'intelligence et de sentiment.
Pourquoi ! Dira l'infortuné, à qui son sort refuse avec rigueur des biens qu'il prodigue à tant d'autres, pourquoi me ravir une erreur qui m'est chère ? Pourquoi m'anéantir un Dieu dont l'idée consolante tarit la source de mes pleurs et sert à calmer mes peines ? Pourquoi me priver d'un objet que je me représente comme un Père compâtissant et tendre qui m'éprouve en ce monde, mais dans les bras duquel je me jette avec confiance, lorsque la nature entière semble m'abandonner ? En supposant même que ce Dieu n'est qu'une chimère, les malheureux en ont besoin pour se garantir d'un affreux désespoir : n'est-ce pas être inhumain et cruel que de vouloir les plonger dans le vuide en cherchant à les détromper ? Une erreur utile n'est-elle pas préférable à des vérités qui privent l'esprit de toute consolation et qui ne lui montrent aucun soulagement à ses maux ? »
Non, dirai-je à ces enthousiastes, la vérité ne peut jamais vous rendre malheureux ; c'est elle qui console véritablement ; elle est un trésor caché qui, bien mieux que des phantômes inventés par la crainte, peut rassurer les coeurs et leur donner le courage de supporter les fardeaux de la vie : elle élève l'ame, elle la rend active, elle lui fournit des moyens de résister aux attaques du sort et de combattre avec succès la fortune ennemie. Je leur demanderai sur quoi ils fondent cette bonté qu'ils attribuent follement à leur Dieu. Mais ce Dieu, leur dirai-je, est-il donc bienfaisant pour tous les hommes ? Contre un mortel qui jouit de l'abondance et des faveurs de la fortune n'en est-il pas des millions qui languissent dans le besoin et la misère ? Ceux qui prennent pour modèle l'ordre, dont on suppose ce Dieu l'auteur, sont-ils donc les plus heureux en ce monde ? La bonté de cet être pour quelques individus favorisés ne se dément-elle jamais ? Ces consolations même que l'imagination va chercher dans son sein n'annoncent-elles pas des infortunes amenées par ses décrets et dont il est l'auteur ? La terre n'est-elle pas couverte de malheureux, qui ne semblent y être venus que pour souffrir gémir et mourir ? Cette Providence divine se livre-t-elle au sommeil durant ces contagions, ces pestes, ces guerres, ces désordres, ces révolutions physiques et morales dont la race humaine est continuellement la victime ? Cette terre dont on regarde la fécondité comme un bienfait du ciel, n'est-elle pas en mille endroits aride et inexorable ? Ne produit-elle pas des poisons à côté des fruits les plus doux ? Ces rivières et ces mers que l'on croit faites pour arroser notre séjour et faciliter notre commerce, ne viennent-elles pas souvent inonder nos campagnes, renverser nos demeures, entraîner les hommes et leurs troupeaux également malheureux ? Enfin ce Dieu, qui préside à l'univers et qui veille sans cesse à la conservation de ses créatures, ne les livre-t-il pas presque toujours aux fers de tant de Souverains inhumains qui se font un jeu du malheur de leurs sujets, tandis que ces infortunés s'adressent en vain au ciel pour faire cesser des calamités multipliées, visiblement dues à une administration insensée, et non à la colère des cieux.
Le malheureux qui cherche à se consoler dans les bras de son Dieu devroit au moins se souvenir que c'est ce même Dieu, qui étant le maître de tout, distribue et le bien et le mal : si l'on croit la nature soumise à ses ordres suprêmes, ce Dieu est aussi souvent injuste, rempli de malice, d'imprudence, de déraison, que de bonté, de sagesse et d'équité. Si le Dévôt moins prévenu et plus conséquent vouloit un peu raisonner, il se désireroit un Dieu capricieux qui souvent le fait souffrir lui-même ; il n'iroit point se consoler dans les bras de son bourreau qu'il a la folie de prendre pour son ami ou pour son Père.
T. II, partie II, ch. 10
Celui qui se repaît d'illusions agréables est, sans doute, un enthousiaste moins dangereux que celui dont l'ame est tourmentée par des spectres odieux. Si une ame honnêtes et tendre ne cause point de ravages dans une société, un esprit agité par des passions incommodes, ne peut manquer de se rendre tôt ou tard incommode à ses semblables. Le Dieu d'un Socrate et d'un Fénelon peut convenir à des ames aussi douces que les leurs ; mais il ne peut être impunément le Dieu d'une nation entière dans laquelle il sera toujours très-rare de trouver des hommes de leur trempe. La Divinité, comme on l'a souvent dit, sera toujours pour le grand nombre des mortels une chimère effrayante propre à leur troubler le cerveau, à mettre leurs passions en jeu, à les rendre nuisibles à leurs associés. Si des gens ne voient leur Dieu que comme rempli de bonté ; des hommes vicieux, inflexibles, inquiets et méchans prêteront à leur Dieu leur propre caractère, et s'autoriseront de son exemple pour donner un libre cours à leurs propres passions. Chaque homme ne peut voir sa chimère qu'avec ses propres yeux ; et le nombre de ceux qui se peindront la divinité hideuse, affligeante et cruelle sera toujours bien plus grand et plus à craindre que ceux qui lui prêtent des couleurs séduisantes ; pour un heureux que cette chimère peut faire, elle fera des milliers de malheureux ; elle sera tôt ou tard une source intarissable de divisions, d'extravagances et de fureurs ; elle troublera l'esprit des ignorans sur lesquels les imposteurs et les fanatiques auront toujours du pouvoir ; elle effrayera les lâches et les pusillanimes, que leur foiblesse dispose à la perfidie et à la cruauté ; elle fera trembler les plus honnêtes, qui même en pratiquant la vertu, craindront d'encourir la disgrace d'un Dieu bizarre et capricieux ; elle n'arrêtera point les méchans qui la mettront de côté pour se livrer au crime, ou qui même se serviront de cette chimère divine pour justifier leurs forfaits. En un mot, entre les mains des tyrans, ce Dieu, tyran lui-même, ne servira qu'à écraser la liberté des peuples et violer impunément les droits de l'équité. Entre les mains des prêtres ce Dieu sera un Talisman propre à enivrer, aveugler, subjuguer également les souverains et les sujets ; enfin entre les mains des peuples, cette idole sera toujours une arme à deux tranchans dont ils se feront à eux-mêmes les blessures les plus mortelles.
D'un autre côté le Dieu théologique n'étant, comme on a vu, qu'un amas de contradictions ; étant représenté, malgré son immutabilité, tantôt comme la bonté même, tantôt comme le plus cruel et le plus injuste des êtres ; étant d'ailleurs envisagé par des hommes dont la machine éprouve des variations continuelles, ce Dieu, dis-je, ne peut en tout tems paroître le même à ceux qui s'en occupent. Ceux qui s'en forment les idées les plus favorables sont souvent malgré eux forcés de reconnoître que le portrait qu'ils s'en font n'est point toujours conforme à l'original. Le dévôt le plus fervent, l'enthousiaste le plus prévenu ne peut s'empêcher de voir les traits de leur divinité changer, et s'ils étoient capables de raisonner, ils sentiroient l'inconséquence de la conduite qu'ils tiennent sans cesse à son égard. En effet ne verroient-ils pas que cette conduite semble démentir à chaque instant les perfections merveilleuses qu'ils assignent à leur Dieu ?
Prier la divinité n'est-ce pas douter de sa sagesse, de sa bienveillance, de sa providence, de son omniscience, de son immutabilité ? N'est-ce pas l'accuser d'oublier ses créatures et lui demander qu'il altère les décrets éternels de sa justice, qu'il change les loix invariables qu'il a lui-même fixées ? Prier Dieu n'est-ce pas lui dire ? « O mon Dieu, je reconnois votre sagesse, votre science, votre bonté infinies ; cependant vous m'oubliez ; vous perdez de vue votre créature ; vous ignorez, ou vous feignez d'ignorer ce qui lui manque ; ne voyez-vous pas que je souffre de l'arrangement merveilleux que nos loix sages ont mis dans l'univers ? La nature, contre vos ordres, rend naturellement mon existence pénible : changez donc, je vous en prie, l'essence que votre volonté a donnée à tous les êtres. Faites en sorte que les élémens perdent pour moi en ce moment leurs propriétés distinctives ; faites que les corps graves ne tombent point, que le feu ne brûle point, que la machine frêle que j'ai reçue de vous ne souffre point des chocs qu'elle éprouve à chaque instant. Rectifiez pour mon bien-être le plan que votre prudence infinie a tracé depuis l'éternité. » Tels sont à-peu-près les voeux que forment tous les hommes ; telles sont les demandes ridicules qu'ils font à chaque instant à la divinité, dont ils vantent la sagesse, l'intelligence, la providence et l'équité, tandis que presque jamais ils ne sont contens des effets de ces perfections divines.
T. II, partie II, ch. 11
En voyant le déchaïnement qu'excitent parmi les Théologiens les opinions des athées, et les supplices qui, à leur instigation, furent souvent décernés contr'eux, ne seroit-on pas autorisé de conclure que ces docteurs, ou ne sont pas aussi sûrs qu'ils le disent de l'existence de leur Dieu, ou ne regardent pas les opinions de leurs adversaires comme aussi absurdes qu'ils le prétendent ? Ce n'est jamais que la défiance, la foiblesse et la crainte qui rendent cruel ; on n'a point de colère contre ceux qu'on méprise : on ne regarde point la folie comme un crime punissable ; on se contenteroit de rire d'un insensé qui nieroit l'existence du soleil, on ne le puniroit pas si l'on n'étoit soi-même insensé. La fureur théologique ne prouvera jamais que la foiblesse de sa cause ; l'inhumanité de ces hommes intéressés, dont la profession est d'annoncer des chimères aux nations, nous prouve qu'eux seuls tirent parti de ces puissances invisibles, dont ils se servent avec succès pour effrayer les mortels. Ce sont pourtant ces tyrans des esprits qui, peu conséquens dans leurs principes, défont d'une main ce qu'ils élèvent de l'autre : ce sont eux qui, après avoir fait une divinité remplie de bonté, de sagesse et d'équité, la diffament, la décrient, l'anéantissent tout-à-fait, en disant qu'elle est cruelle, qu'elle est capricieuse, injuste et despotique, qu'elle est altérée du sang des malheureux. Cela posé, ce sont les vrais impies.
Celui qui ne connoît point la divinité, ne peut lui faire injure, ni par conséquent être appellé un impie. Etre impie, dit Epicure, ce n'est point ôter au vulgaire les Dieux qu'il a, c'est attribuer à ces Dieux les opinions du vulgaire. Etre impie, c'est insulter un Dieu qu'on croit, c'est l'outrager sciemment. Etre impie, c'est admettre un Dieu bon, tandis qu'on prêche en même tems la persécution et le carnage. Etre impie, c'est tromper les hommes au nom d'un Dieu que l'on sait servir de prétexte à ses indignes passions. Etre impie, c'est dire qu'un Dieu souverainement heureux et tout-puissant peut être offensé par les foibles créatures. Etre impie, c'est mentir de la part d'un Dieu que l'on suppose l'ennemi du mensonge. Etre impie enfin, c'est se servir de la divinité pour troubler les sociétés, pour les asservir à des tyrans ; c'est leur persuader que la cause de l'imposture est la cause de Dieu ; c'est imputer à Dieu des crimes qui anéantiroient ses perfections divines. Etre impie et insensé à la fois, c'est faire une pure chimère du Dieu que l'on adore.
D'un autre côté, être pieux c'est servir la patrie, c'est être utile à ses semblables, c'est travailler à leur bien-être ; chacun peut y prétendre suivant ses facultés ; celui qui médite, peut se rendre utile, lorsqu'il a le courage d'annoncer la vérité, de combattre l'erreur, d'attaquer les préjugés qui s'opposent par-tout au bonheur des humains ; il est vraiment utile, et c'est même un devoir, d'arracher des mains des mortels les couteaux que le fanatisme leur distribue, d'ôter à l'imposture et à la tyrannie l'empire funeste de l'opinion dont elles se servent avec succès en tout tems, en tous lieux, pour s'élever sur les ruines de la liberté, de la sûreté, de la félicité publique. Etre vraiment pieux, c'est observer religieusement les loix saintes de la nature, et suivre fidèlement les devoirs qu'elle nous prescrit ; être pieux, c'est être humain, équitable, bienfaisant, c'est respecter les biens des hommes ; être pieux et sensé, c'est rejetter des rêveries qui pourroient faire méconnoître les conseils de la raison.
Ainsi quoi qu'en disent le fanatisme et l'imposture, celui qui nie l'existence de Dieu, en voyant qu'elle n'a d'autre base que l'imagination allarmée ; celui qui rejette un Dieu continuellement en contradiction avec lui-même ; celui qui bannit de son esprit et de son coeur un Dieu continuellement aux prises avec la nature, la raison, le bien-être des hommes ; celui, dis-je, qui se détrompte d'une si dangereuse chimère, peut être réputé pieux, honnête et vertueux, quand sa conduite ne s'écartera point des règles invariables que la nature et la raison lui prescrivent. De ce qu'un homme refuse d'admettre à un Dieu contradictoire, ainsi que les oracles obscurs qu'on débite en son nom, s'ensuit-il donc qu'un tel homme refuse de connoître les loix évidentes et démontrées d'une nature dont il dépend, dont il éprouve le pouvoir, dont les devoirs nécessaires l'obligent sous peine d'être puni dans ce monde ? Il est vrai que si la vertu consistoit par hazard dans un honteux renoncement à la raison, dans un fanatisme destructeur, dans des pratiques inutiles, l'athée ne peut point passer pour vertueux ; mais si la vertu consistoit à faire à la société tout le bien dont on est capable, l'athée peut y prétendre ; son ame courageuse et tendre ne sera point criminelle en faisant éclater son indignation légitime contre des préjugés fatals au genre-humain.
Liens utiles
- SYSTÈME DE LA NATURE OU DES LOIS DU MONDE PHYSIQUE ET DU MONDE MORAL de D’Holbach
- SYSTÈME DE LA NATURE (LE), ou Des lois du monde physique et du monde moral, 1770. Holbach (Paul-Henri Dietrich, baron d’)
- L'eau est un véhicule propre à favoriser la combinaison des corps, dans laquelle elle entre elle-même comme partie constituante. Paul Henri Dietrich, baron d'Holbach, Système de la nature, ou Des lois du monde physique et du monde moral
- SYSTÈME DE LA NATURE (Le) ou Des lois du monde physique et moral. (résumé et analyse)
- Explication de texte : Holbach, Système de la nature Chapitre VII































