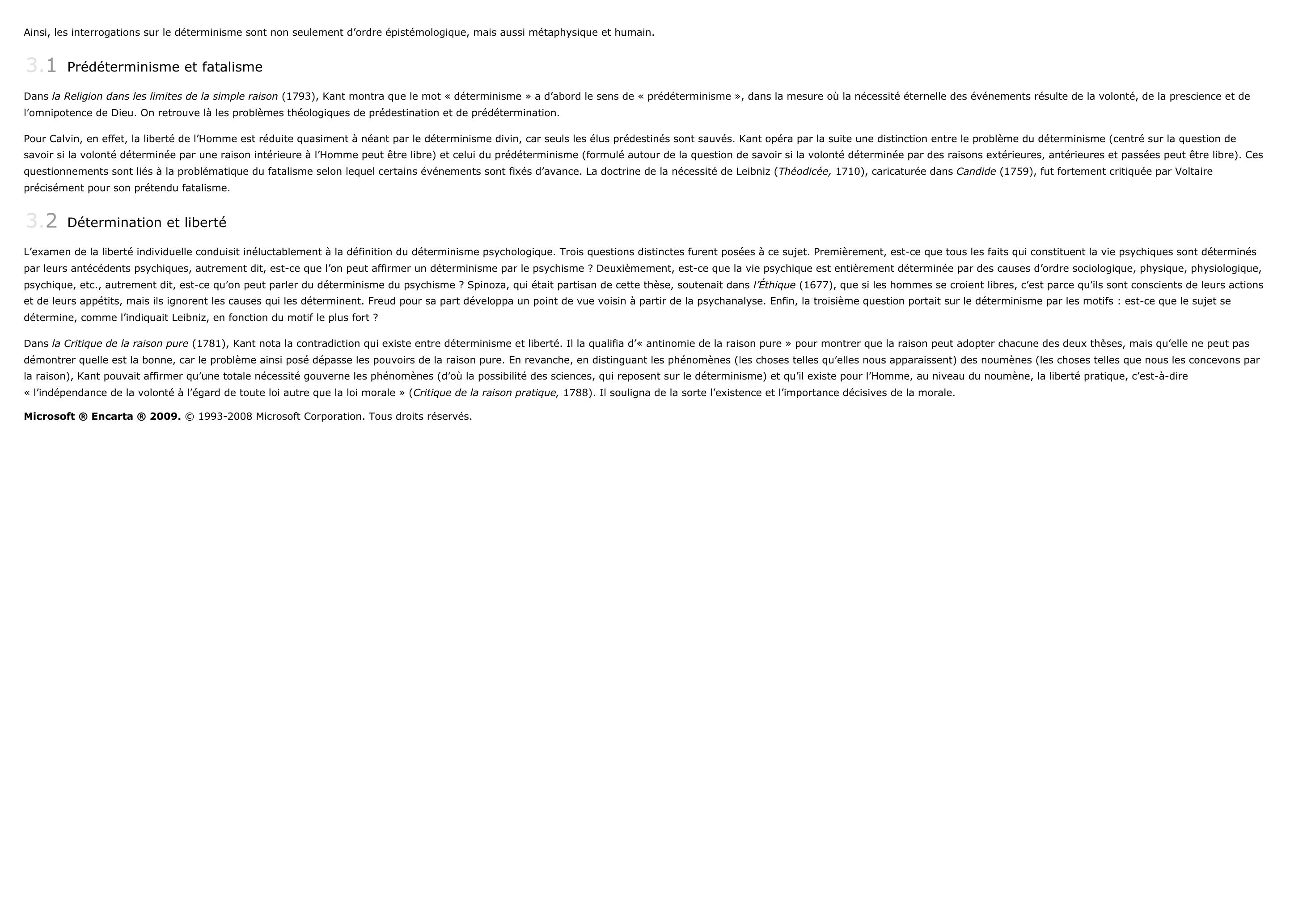déterminisme - philosophie.
Publié le 08/05/2013
Extrait du document


«
Ainsi, les interrogations sur le déterminisme sont non seulement d’ordre épistémologique, mais aussi métaphysique et humain.
3. 1 Prédéterminisme et fatalisme
Dans la Religion dans les limites de la simple raison (1793), Kant montra que le mot « déterminisme » a d’abord le sens de « prédéterminisme », dans la mesure où la nécessité éternelle des événements résulte de la volonté, de la prescience et de
l’omnipotence de Dieu.
On retrouve là les problèmes théologiques de prédestination et de prédétermination.
Pour Calvin, en effet, la liberté de l’Homme est réduite quasiment à néant par le déterminisme divin, car seuls les élus prédestinés sont sauvés.
Kant opéra par la suite une distinction entre le problème du déterminisme (centré sur la question de
savoir si la volonté déterminée par une raison intérieure à l’Homme peut être libre) et celui du prédéterminisme (formulé autour de la question de savoir si la volonté déterminée par des raisons extérieures, antérieures et passées peut être libre).
Ces
questionnements sont liés à la problématique du fatalisme selon lequel certains événements sont fixés d’avance.
La doctrine de la nécessité de Leibniz ( Théodicée, 1710), caricaturée dans Candide (1759), fut fortement critiquée par Voltaire
précisément pour son prétendu fatalisme.
3. 2 Détermination et liberté
L’examen de la liberté individuelle conduisit inéluctablement à la définition du déterminisme psychologique.
Trois questions distinctes furent posées à ce sujet.
Premièrement, est-ce que tous les faits qui constituent la vie psychiques sont déterminés
par leurs antécédents psychiques, autrement dit, est-ce que l’on peut affirmer un déterminisme par le psychisme ? Deuxièmement, est-ce que la vie psychique est entièrement déterminée par des causes d’ordre sociologique, physique, physiologique,
psychique, etc., autrement dit, est-ce qu’on peut parler du déterminisme du psychisme ? Spinoza, qui était partisan de cette thèse, soutenait dans l’Éthique (1677), que si les hommes se croient libres, c’est parce qu’ils sont conscients de leurs actions
et de leurs appétits, mais ils ignorent les causes qui les déterminent.
Freud pour sa part développa un point de vue voisin à partir de la psychanalyse.
Enfin, la troisième question portait sur le déterminisme par les motifs : est-ce que le sujet se
détermine, comme l’indiquait Leibniz, en fonction du motif le plus fort ?
Dans la Critique de la raison pure (1781), Kant nota la contradiction qui existe entre déterminisme et liberté.
Il la qualifia d’« antinomie de la raison pure » pour montrer que la raison peut adopter chacune des deux thèses, mais qu’elle ne peut pas
démontrer quelle est la bonne, car le problème ainsi posé dépasse les pouvoirs de la raison pure.
En revanche, en distinguant les phénomènes (les choses telles qu’elles nous apparaissent) des noumènes (les choses telles que nous les concevons par
la raison), Kant pouvait affirmer qu’une totale nécessité gouverne les phénomènes (d’où la possibilité des sciences, qui reposent sur le déterminisme) et qu’il existe pour l’Homme, au niveau du noumène, la liberté pratique, c’est-à-dire
« l’indépendance de la volonté à l’égard de toute loi autre que la loi morale » ( Critique de la raison pratique, 1788).
Il souligna de la sorte l’existence et l’importance décisives de la morale.
Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation.
Tous droits réservés..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'oisiveté est la mère de la philosophie (Hobbes)
- Philosophie marc aurele
- M Vergeade Philosophie : Explication du texte janv.21 Les idées et les âges (1927)P 102 -Manuel Delagrave -P 427-
- À propos de l'histoire de la philosophie (I).
- Philosophie Post-moderne