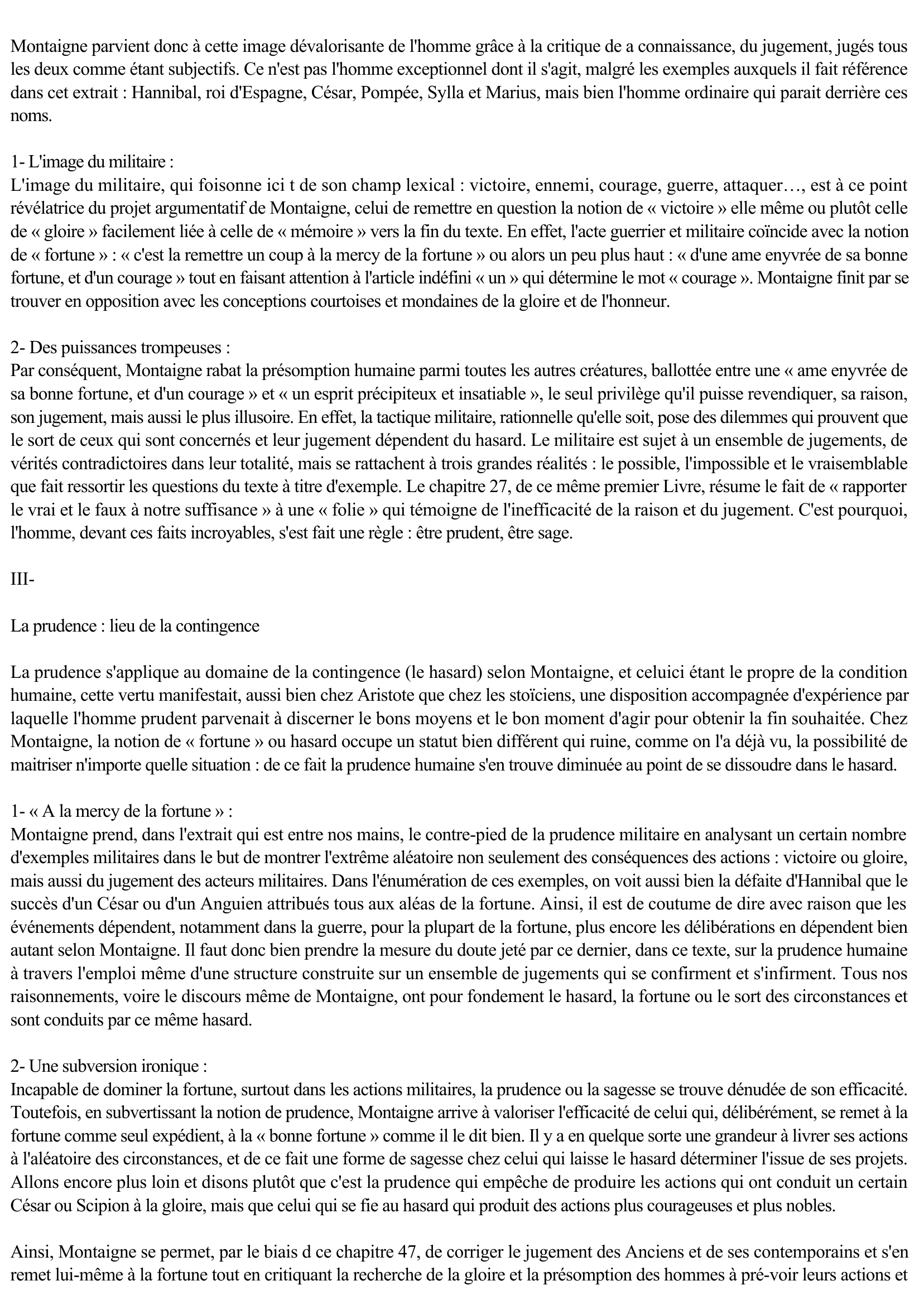« De l'incertitude de notre jugement » Montaigne
Publié le 12/09/2006
Extrait du document

Introduction S’il est beaucoup question de jugement et de fortune dans l’œuvre de Montaigne, c’est que justement ces notions, et le débat qui les entoure à son époque, interrogent le moraliste. Le jugement et la fortune sont, dans les Essais, le lieu d’une réflexion et d’une mise en problème, bien plus que d’une solution de l’un à l’autre. La première impulsion de la réflexion vient sans doute du contexte social et politique de guerre de religion dans lequel Montaigne aborde la question. De ce fait la thématique militaire, qui constitue ici le moule de l’argumentation, reflète l’équivocité des actions entreprises à des fins pourtant simples : la victoire. Le titre, « De l’incertitude de notre jugement «, révèle d’emblée l’issue du discours montaigniste : l’impossibilité, pour l’homme, de connaitre, de prévoir. En effet, dans ce début du chapitre 47 des Essais, Livre I, il s’agit pour lui de remettre en cause toute connaissance qui se veut absolue dans le cadre d’un scepticisme positif en lui assujettissant le concept de fortune qui signifie tantôt chance, tantôt malchance, toujours avec un caractère fortuit. Pour Montaigne, seule compte une sagesse pratique, seule importe une vertu réalisée. En cela, il suit bien le mouvement humaniste qui tend à faire prévaloir l’autonomie de la sphère morale sur la sphère théorétique, mais sans faire face à la charge du hasard. A quel point, donc, le texte, et plus généralement l’écriture de Montaigne, peut être considéré comme une délibération perpétuelle et un déploiement d’une prudence repensée et fondée sur le hasard. Il s’agit donc de voir tout d’abord les différentes manifestations de cette « incertitude de notre jugement « et de cet éclatement de l’esprit, ensuite on essayera d’examiner l’image de l’homme faible et écrasé dans le texte, à mette en question même la notion de raison. On verra comment la fortuité du jugement humain fonde le concept même de prudence et permet à Montaigne une subversion ironique de cette dernière chez les Anciens et les contemporains. I- « De l’incertitude de notre jugement « Dans l’ensemble des Essais, et en occurrence l’extrait qui nous est proposé, Montaigne développe l’idée selon laquelle tout jugement auquel nous nous arrêtons es susceptible d’être répliqué sous la forme d’un jugement exactement contraire. Le texte d’ailleurs s’ouvre sur cette citation d’Homère : « il y a bien des façons de parler de tout et pour et contre «, plus même, sa structure de décline en deux grandes parties qu’articule un « mais « d’opposition dans le dernier paragraphe. Dire par conséquent, que le jugement est « décision de rationalité «, c’est dire qu’on prend la responsabilité épistémique d’arrêter la perception sur l’une de ses significations, et de déployer celle-ci pour en mesurer les possibilités. 1- Une connaissance relative : Etre « sceptique « ce n’est pas de retenir de porter des jugements, c’est admettre que tout jugement souffre au moins virtuellement la concurrence d’une infinité de perspectives différentes. La valeur d’un discours tient principalement aux possibilités épistémiques et pratiques qu’il renferme, d’où bien évidement cette forme double du texte et même contradictoire. Une critique de la connaissance absolue s’installe au fur et à mesure de notre lecture, car, pour Montaigne, il est impossible de fixer des limites à la Nature ou à la Providence (que résume le terme de « fortune «). Une critique subtile dans le texte puisqu’elle n’est perçue qu’à travers la structure du texte, chapeauté par ce vers d’Homère que Montaigne traduit lui-même, ce qui est assez rare. Deux parties qui s’opposent, se nient mais forment un tout contradictoire à l’image même du jugement. 2- Eclatement de l’esprit entre contradictions et spéculations : Vérité et mensonge ont donc le même visage, puisque ce ne sont pas les « gens « qui contrôlent l’esprit (dans le sens de raison), mais plutôt l’inverse, d’où la subjectivité qui est incapable de connaitre. Ainsi, toutes les connaissances restent au niveau de l’opinion, d’où d’ailleurs un champ lexical : « ce party «, « nos gens «, « ceux «, « il pourra dire «, « diraon «… en plus des questions qui clôturent ou ouvrent chacun des paragraphes et qui témoignent de l’impuissance de l’être humain à cerner le vrai. En outre, l’emploi des citations concoure à installer un climat de doute : Homère, Pétrarque, Lucain et Portius Latro, plus qu’une illustration des propos de Montaigne. Cependant, poser des opinions contradictoires n’implique pas pour Montaigne une lutte entre vérité et erreur, mais dénote simplement le vain instinct combinatoire de la fantaisie qui confirme en quelque sorte la nature contradictoire de l’esprit : les figures d’opposition, à cet égard, sont claires : « de sa bonne fortune, et d’un courage « par exemple ; l’emploi du « mais « à plusieurs reprises… L’homme est de ce fait déchu, remis à son point de départ : sa nature faible. II- L’homme faible et écrasé Montaigne parvient donc à cette image dévalorisante de l’homme grâce à la critique de a connaissance, du jugement, jugés tous les deux comme étant subjectifs. Ce n’est pas l’homme exceptionnel dont il s’agit, malgré les exemples auxquels il fait référence dans cet extrait : Hannibal, roi d’Espagne, César, Pompée, Sylla et Marius, mais bien l’homme ordinaire qui parait derrière ces noms. 1- L’image du militaire : L’image du militaire, qui foisonne ici t de son champ lexical : victoire, ennemi, courage, guerre, attaquer…, est à ce point révélatrice du projet argumentatif de Montaigne, celui de remettre en question la notion de « victoire « elle même ou plutôt celle de « gloire « facilement liée à celle de « mémoire « vers la fin du texte. En effet, l’acte guerrier et militaire coïncide avec la notion de « fortune « : « c’est la remettre un coup à la mercy de la fortune « ou alors un peu plus haut : « d’une ame enyvrée de sa bonne fortune, et d’un courage « tout en faisant attention à l’article indéfini « un « qui détermine le mot « courage «. Montaigne finit par se trouver en opposition avec les conceptions courtoises et mondaines de la gloire et de l’honneur. 2- Des puissances trompeuses : Par conséquent, Montaigne rabat la présomption humaine parmi toutes les autres créatures, ballottée entre une « ame enyvrée de sa bonne fortune, et d’un courage « et « un esprit précipiteux et insatiable «, le seul privilège qu’il puisse revendiquer, sa raison, son jugement, mais aussi le plus illusoire. En effet, la tactique militaire, rationnelle qu’elle soit, pose des dilemmes qui prouvent que le sort de ceux qui sont concernés et leur jugement dépendent du hasard. Le militaire est sujet à un ensemble de jugements, de vérités contradictoires dans leur totalité, mais se rattachent à trois grandes réalités : le possible, l’impossible et le vraisemblable que fait ressortir les questions du texte à titre d’exemple. Le chapitre 27, de ce même premier Livre, résume le fait de « rapporter le vrai et le faux à notre suffisance « à une « folie « qui témoigne de l’inefficacité de la raison et du jugement. C’est pourquoi, l’homme, devant ces faits incroyables, s’est fait une règle : être prudent, être sage. III- La prudence : lieu de la contingence La prudence s’applique au domaine de la contingence (le hasard) selon Montaigne, et celuici étant le propre de la condition humaine, cette vertu manifestait, aussi bien chez Aristote que chez les stoïciens, une disposition accompagnée d’expérience par laquelle l’homme prudent parvenait à discerner le bons moyens et le bon moment d’agir pour obtenir la fin souhaitée. Chez Montaigne, la notion de « fortune « ou hasard occupe un statut bien différent qui ruine, comme on l’a déjà vu, la possibilité de maitriser n’importe quelle situation : de ce fait la prudence humaine s’en trouve diminuée au point de se dissoudre dans le hasard. 1- « A la mercy de la fortune « : Montaigne prend, dans l’extrait qui est entre nos mains, le contre-pied de la prudence militaire en analysant un certain nombre d’exemples militaires dans le but de montrer l’extrême aléatoire non seulement des conséquences des actions : victoire ou gloire, mais aussi du jugement des acteurs militaires. Dans l’énumération de ces exemples, on voit aussi bien la défaite d’Hannibal que le succès d’un César ou d’un Anguien attribués tous aux aléas de la fortune. Ainsi, il est de coutume de dire avec raison que les événements dépendent, notamment dans la guerre, pour la plupart de la fortune, plus encore les délibérations en dépendent bien autant selon Montaigne. Il faut donc bien prendre la mesure du doute jeté par ce dernier, dans ce texte, sur la prudence humaine à travers l’emploi même d’une structure construite sur un ensemble de jugements qui se confirment et s’infirment. Tous nos raisonnements, voire le discours même de Montaigne, ont pour fondement le hasard, la fortune ou le sort des circonstances et sont conduits par ce même hasard. 2- Une subversion ironique : Incapable de dominer la fortune, surtout dans les actions militaires, la prudence ou la sagesse se trouve dénudée de son efficacité. Toutefois, en subvertissant la notion de prudence, Montaigne arrive à valoriser l’efficacité de celui qui, délibérément, se remet à la fortune comme seul expédient, à la « bonne fortune « comme il le dit bien. Il y a en quelque sorte une grandeur à livrer ses actions à l’aléatoire des circonstances, et de ce fait une forme de sagesse chez celui qui laisse le hasard déterminer l’issue de ses projets. Allons encore plus loin et disons plutôt que c’est la prudence qui empêche de produire les actions qui ont conduit un certain César ou Scipion à la gloire, mais que celui qui se fie au hasard qui produit des actions plus courageuses et plus nobles. Ainsi, Montaigne se permet, par le biais d ce chapitre 47, de corriger le jugement des Anciens et de ses contemporains et s’en remet lui-même à la fortune tout en critiquant la recherche de la gloire et la présomption des hommes à pré-voir leurs actions et les conséquences qui s’en suivent. Conclusion Dans une sorte d’évolution de la pensée de Montaigne, ces contradictions et ces incertitudes des jugements, dont ce texte traite et dont l’Apologie tirait une leçon négative de scepticisme, apparaissent à Montaigne, non point comme la preuve d’une infirmité radicale de la connaissance, mais comme la conséquence d’un mauvais usage de nos facultés naturelles : le mal, pour lui, n’est pas à priori sans remède. Pour reconstruire, il importe dans cette conception des choses, de définir les règles ou la méthode qui assurent le bon usage de notre jugement, idée qui est entamée ici, mais qu’il développera par a suite dans le chapitre 8 du livre III intitulé : « l’art de conférer «.

«
Montaigne parvient donc à cette image dévalorisante de l'homme grâce à la critique de a connaissance, du jugement, jugés tousles deux comme étant subjectifs.
Ce n'est pas l'homme exceptionnel dont il s'agit, malgré les exemples auxquels il fait référencedans cet extrait : Hannibal, roi d'Espagne, César, Pompée, Sylla et Marius, mais bien l'homme ordinaire qui parait derrière cesnoms.
1- L'image du militaire :L'image du militaire, qui foisonne ici t de son champ lexical : victoire, ennemi, courage, guerre, attaquer…, est à ce pointrévélatrice du projet argumentatif de Montaigne, celui de remettre en question la notion de « victoire » elle même ou plutôt cellede « gloire » facilement liée à celle de « mémoire » vers la fin du texte.
En effet, l'acte guerrier et militaire coïncide avec la notionde « fortune » : « c'est la remettre un coup à la mercy de la fortune » ou alors un peu plus haut : « d'une ame enyvrée de sa bonnefortune, et d'un courage » tout en faisant attention à l'article indéfini « un » qui détermine le mot « courage ».
Montaigne finit par setrouver en opposition avec les conceptions courtoises et mondaines de la gloire et de l'honneur.
2- Des puissances trompeuses :Par conséquent, Montaigne rabat la présomption humaine parmi toutes les autres créatures, ballottée entre une « ame enyvrée desa bonne fortune, et d'un courage » et « un esprit précipiteux et insatiable », le seul privilège qu'il puisse revendiquer, sa raison,son jugement, mais aussi le plus illusoire.
En effet, la tactique militaire, rationnelle qu'elle soit, pose des dilemmes qui prouvent quele sort de ceux qui sont concernés et leur jugement dépendent du hasard.
Le militaire est sujet à un ensemble de jugements, devérités contradictoires dans leur totalité, mais se rattachent à trois grandes réalités : le possible, l'impossible et le vraisemblableque fait ressortir les questions du texte à titre d'exemple.
Le chapitre 27, de ce même premier Livre, résume le fait de « rapporterle vrai et le faux à notre suffisance » à une « folie » qui témoigne de l'inefficacité de la raison et du jugement.
C'est pourquoi,l'homme, devant ces faits incroyables, s'est fait une règle : être prudent, être sage.
III-
La prudence : lieu de la contingence
La prudence s'applique au domaine de la contingence (le hasard) selon Montaigne, et celuici étant le propre de la conditionhumaine, cette vertu manifestait, aussi bien chez Aristote que chez les stoïciens, une disposition accompagnée d'expérience parlaquelle l'homme prudent parvenait à discerner le bons moyens et le bon moment d'agir pour obtenir la fin souhaitée.
ChezMontaigne, la notion de « fortune » ou hasard occupe un statut bien différent qui ruine, comme on l'a déjà vu, la possibilité demaitriser n'importe quelle situation : de ce fait la prudence humaine s'en trouve diminuée au point de se dissoudre dans le hasard.
1- « A la mercy de la fortune » :Montaigne prend, dans l'extrait qui est entre nos mains, le contre-pied de la prudence militaire en analysant un certain nombred'exemples militaires dans le but de montrer l'extrême aléatoire non seulement des conséquences des actions : victoire ou gloire,mais aussi du jugement des acteurs militaires.
Dans l'énumération de ces exemples, on voit aussi bien la défaite d'Hannibal que lesuccès d'un César ou d'un Anguien attribués tous aux aléas de la fortune.
Ainsi, il est de coutume de dire avec raison que lesévénements dépendent, notamment dans la guerre, pour la plupart de la fortune, plus encore les délibérations en dépendent bienautant selon Montaigne.
Il faut donc bien prendre la mesure du doute jeté par ce dernier, dans ce texte, sur la prudence humaineà travers l'emploi même d'une structure construite sur un ensemble de jugements qui se confirment et s'infirment.
Tous nosraisonnements, voire le discours même de Montaigne, ont pour fondement le hasard, la fortune ou le sort des circonstances etsont conduits par ce même hasard.
2- Une subversion ironique :Incapable de dominer la fortune, surtout dans les actions militaires, la prudence ou la sagesse se trouve dénudée de son efficacité.Toutefois, en subvertissant la notion de prudence, Montaigne arrive à valoriser l'efficacité de celui qui, délibérément, se remet à lafortune comme seul expédient, à la « bonne fortune » comme il le dit bien.
Il y a en quelque sorte une grandeur à livrer ses actionsà l'aléatoire des circonstances, et de ce fait une forme de sagesse chez celui qui laisse le hasard déterminer l'issue de ses projets.Allons encore plus loin et disons plutôt que c'est la prudence qui empêche de produire les actions qui ont conduit un certainCésar ou Scipion à la gloire, mais que celui qui se fie au hasard qui produit des actions plus courageuses et plus nobles.
Ainsi, Montaigne se permet, par le biais d ce chapitre 47, de corriger le jugement des Anciens et de ses contemporains et s'enremet lui-même à la fortune tout en critiquant la recherche de la gloire et la présomption des hommes à pré-voir leurs actions et.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Comment comprenez-vous ce jugement de Montaigne : « Ce grand montre est le miroir où il faut se regarder pour se bien connaître » ?
- L'expression du jugement personnel de Montaigne dans les Essais fait-elle de cet auteur un critique sévère de la société de son temps ?
- Vous commenterez ce jugement de Sainte-Beuve sur Montaigne : « Ce n'est pas un système de philosophie, ni même avant tout un sceptique, mais la nature... la nature au complet sans la grâce » (Port-Royal). ?
- Commentez ce jugement de Pascal : « Ce n'est pas dans Montaigne, mais dans moi, que je trouve tout ce que j'y vois. »
- Pascal a écrit à propos des Essais de Montaigne : ''Le sot projet qu'il a eu de se peindre'', ce jugement vous paraît-il équitable ?