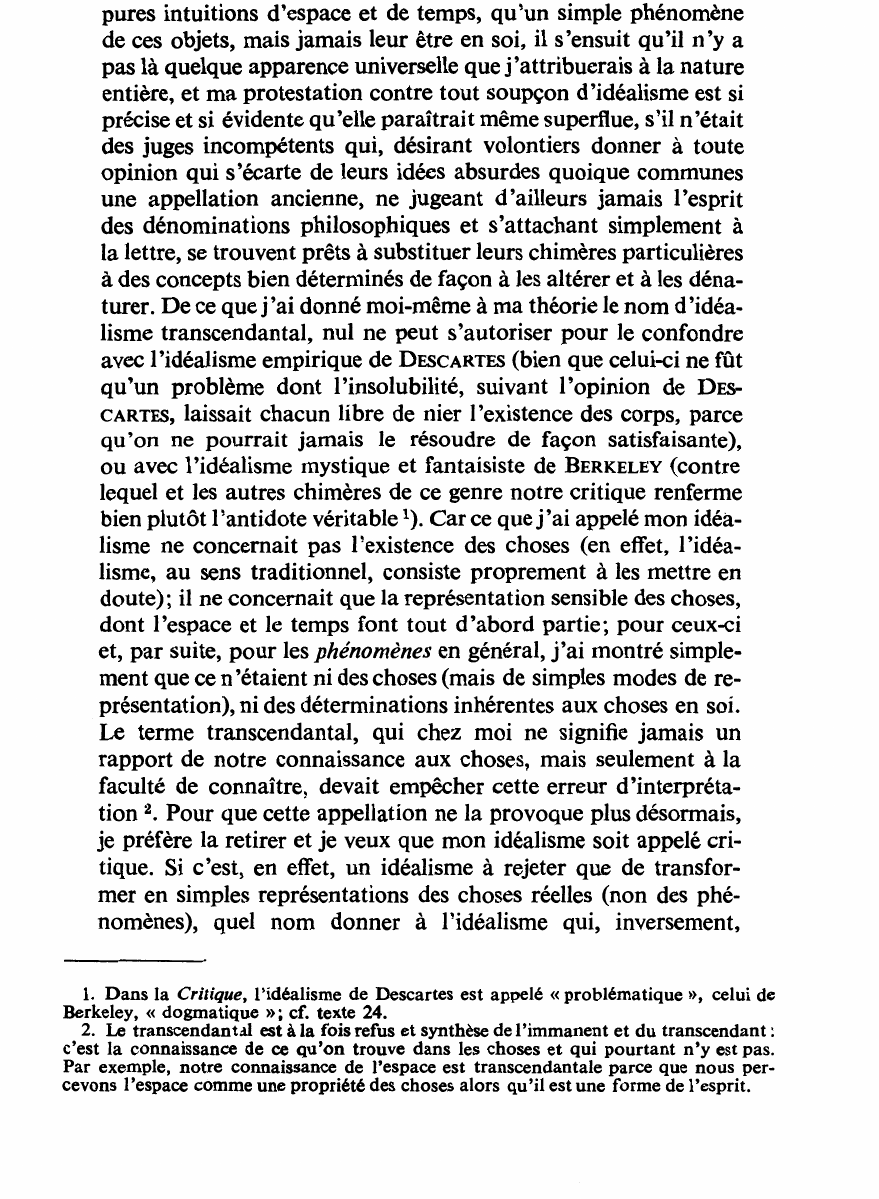d'arriver, sur les objets des questions de métaphysique, à une
Publié le 22/10/2012
Extrait du document
«
39 L'idéalisme transcendontal
pures
intuitions d'espace et de temps, qu'un simple phénomène
de ces objets, mais jamais leur être en soi, il s'ensuit qu'il n'y a
pas là quelque apparence universelle que j'attribuerais à la nature
entière, et ma protestation contre tout soupçon d'idéalisme est si
précise et si évidente qu'elle paraîtrait même superflue, s'il n'était
des juges incompétents qui, désirant volontiers donner à toute
opinion qui s'écarte de leurs idées absurdes quoique communes
une appellation ancienne, ne jugeant d'ailleurs jamais l'esprit
des dénominations philosophiques et s'attachant simplement à
la lettre,
se trouvent prêts à substituer leurs chimères particulières
à des concepts bien déterminés de façon à les altérer et à les déna
turer.
De ce que j'ai donné moi-même à ma théorie le nom d 'idéa
lisme transcendantal, nul ne peut s'autoriser pour le confondre
avec l'idéalisme empirique de
DESCARTES (bien que celui-ci ne fût
qu'un problème dont l'insolubilité, suivant l'opinion de DES CARTES, laissait chacun libre de nier l'existence des corps, parce qu'on ne pourrait jamais le résoudre de façon satisfaisante), ou avec l'idéalisme mystique et fantaisiste de BERKELEY (contre
lequel et les autres chimères de ce genre notre critique renferme
bien plutôt l'antidote véritable 1).
Car ce que j'ai appelé mon idéa lisme ne concernait pas l'existence des choses (en effet, l'idéa
lisme, au sens traditionnel, consiste proprement à les mettre en
doute); il ne concernait que la représentation sensible des choses,
dont l'espace et le temps font tout d'abord partie; pour ceux-ci
et, par suite, pour les phénomènes en général, j'ai montré simple
ment que ce n'étaient ni des choses (mais de simples modes de re
présentation), ni des déterminations inhérentes aux choses en soi.
Le terme transcendantal, qui chez moi ne signifie jamais un
rapport de notre connaissance aux choses, mais seulement à la
faculté de connaître, devait empêcher cette erreur d'interpréta
tion
2 • Pour que cette appellation ne la provoque plus désormais,
je préfère la retirer et je veux que mon idéalisme soit appelé cri
tique.
Si c'est, en effet, un idéalisme à rejeter que de transfor
mer en simples représentations des choses réelles (non des phé
nomènes), quel nom donner à l'idéalisme qui, inversement,
1.
Dans la Critique, l'idéalisme de Descartes est appelé «problématique», celui de
Berkeley, « dogmatique »; cf.
texte 24.
2.
Le transcendant.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Questions de compréhension: ethnographie, ethnologie, métaphysique, anthropologie, philosophie, sociologie.
- Le concept du bonheur est un concept si indéterminé, que, malgré le désir qu'a tout homme d'arriver à être heureux, personne ne peut jamais dire en termes précis et cohérents ce que véritablement il veut et il désire... Le bonheur est un idéal, non de la raison, mais de l'imagination. Kant, Fondements de la métaphysique des moeurs, deuxième section. Commentez cette citation.
- « Le domaine de la philosophie se ramène aux questions suivantes : 1) Que puis-je savoir? 2) Que dois-je faire? 3) Que m'est-il permis d'espérer? 4) Qu'est-ce que l'homme ? A la première question répond la métaphysique, à la seconde la morale, à la troisième la religion, à la quatrième l'anthropologie. Mais, au fond, on pourrait tout ramener à l'anthropologie, parce que les trois premières questions se rapportent à la dernière. » Kant, Logique, 1800. Commentez cette citation.
- On ne peut se défaire de la métaphysique comme on se défait d'une opinion. Heidegger
- questions de civilisations la renaissance