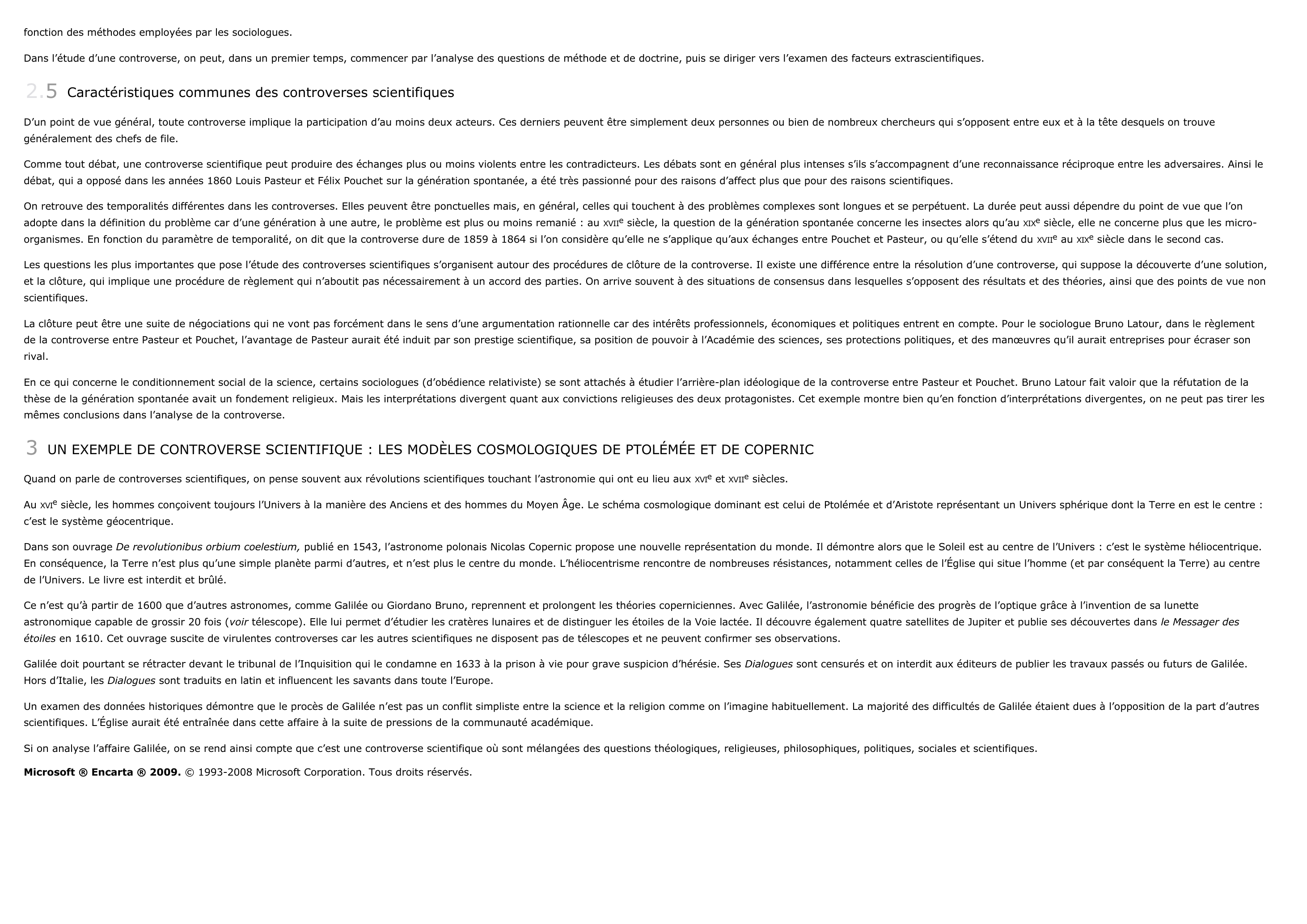controverse scientifique - philosophie.
Publié le 08/05/2013
Extrait du document
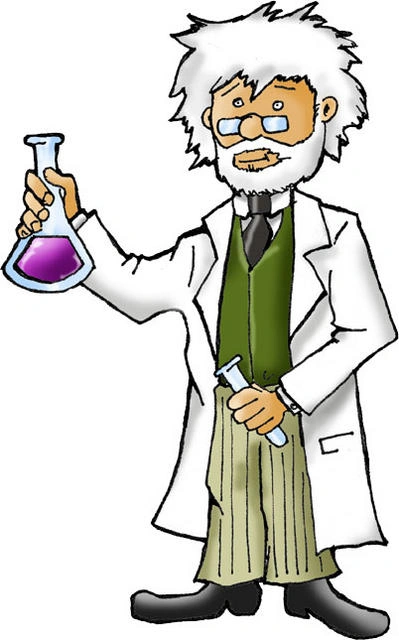
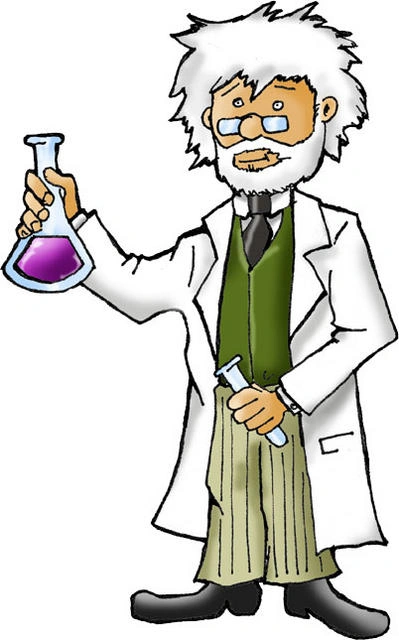
«
fonction des méthodes employées par les sociologues.
Dans l’étude d’une controverse, on peut, dans un premier temps, commencer par l’analyse des questions de méthode et de doctrine, puis se diriger vers l’examen des facteurs extrascientifiques.
2. 5 Caractéristiques communes des controverses scientifiques
D’un point de vue général, toute controverse implique la participation d’au moins deux acteurs.
Ces derniers peuvent être simplement deux personnes ou bien de nombreux chercheurs qui s’opposent entre eux et à la tête desquels on trouve
généralement des chefs de file.
Comme tout débat, une controverse scientifique peut produire des échanges plus ou moins violents entre les contradicteurs.
Les débats sont en général plus intenses s’ils s’accompagnent d’une reconnaissance réciproque entre les adversaires.
Ainsi le
débat, qui a opposé dans les années 1860 Louis Pasteur et Félix Pouchet sur la génération spontanée, a été très passionné pour des raisons d’affect plus que pour des raisons scientifiques.
On retrouve des temporalités différentes dans les controverses.
Elles peuvent être ponctuelles mais, en général, celles qui touchent à des problèmes complexes sont longues et se perpétuent.
La durée peut aussi dépendre du point de vue que l’on
adopte dans la définition du problème car d’une génération à une autre, le problème est plus ou moins remanié : au XVII e siècle, la question de la génération spontanée concerne les insectes alors qu’au XIXe siècle, elle ne concerne plus que les micro-
organismes.
En fonction du paramètre de temporalité, on dit que la controverse dure de 1859 à 1864 si l’on considère qu’elle ne s’applique qu’aux échanges entre Pouchet et Pasteur, ou qu’elle s’étend du XVII e au XIXe siècle dans le second cas.
Les questions les plus importantes que pose l’étude des controverses scientifiques s’organisent autour des procédures de clôture de la controverse.
Il existe une différence entre la résolution d’une controverse, qui suppose la découverte d’une solution,
et la clôture, qui implique une procédure de règlement qui n’aboutit pas nécessairement à un accord des parties.
On arrive souvent à des situations de consensus dans lesquelles s’opposent des résultats et des théories, ainsi que des points de vue non
scientifiques.
La clôture peut être une suite de négociations qui ne vont pas forcément dans le sens d’une argumentation rationnelle car des intérêts professionnels, économiques et politiques entrent en compte.
Pour le sociologue Bruno Latour, dans le règlement
de la controverse entre Pasteur et Pouchet, l’avantage de Pasteur aurait été induit par son prestige scientifique, sa position de pouvoir à l’Académie des sciences, ses protections politiques, et des manœuvres qu’il aurait entreprises pour écraser son
rival.
En ce qui concerne le conditionnement social de la science, certains sociologues (d’obédience relativiste) se sont attachés à étudier l’arrière-plan idéologique de la controverse entre Pasteur et Pouchet.
Bruno Latour fait valoir que la réfutation de la
thèse de la génération spontanée avait un fondement religieux.
Mais les interprétations divergent quant aux convictions religieuses des deux protagonistes.
Cet exemple montre bien qu’en fonction d’interprétations divergentes, on ne peut pas tirer les
mêmes conclusions dans l’analyse de la controverse.
3 UN EXEMPLE DE CONTROVERSE SCIENTIFIQUE : LES MODÈLES COSMOLOGIQUES DE PTOLÉMÉE ET DE COPERNIC
Quand on parle de controverses scientifiques, on pense souvent aux révolutions scientifiques touchant l’astronomie qui ont eu lieu aux XVIe et XVII e siècles.
Au XVIe siècle, les hommes conçoivent toujours l’Univers à la manière des Anciens et des hommes du Moyen Âge.
Le schéma cosmologique dominant est celui de Ptolémée et d’Aristote représentant un Univers sphérique dont la Terre en est le centre :
c’est le système géocentrique.
Dans son ouvrage De revolutionibus orbium coelestium, publié en 1543, l’astronome polonais Nicolas Copernic propose une nouvelle représentation du monde.
Il démontre alors que le Soleil est au centre de l’Univers : c’est le système héliocentrique.
En conséquence, la Terre n’est plus qu’une simple planète parmi d’autres, et n’est plus le centre du monde.
L’héliocentrisme rencontre de nombreuses résistances, notamment celles de l’Église qui situe l’homme (et par conséquent la Terre) au centre
de l’Univers.
Le livre est interdit et brûlé.
Ce n’est qu’à partir de 1600 que d’autres astronomes, comme Galilée ou Giordano Bruno, reprennent et prolongent les théories coperniciennes.
Avec Galilée, l’astronomie bénéficie des progrès de l’optique grâce à l’invention de sa lunette
astronomique capable de grossir 20 fois ( voir télescope).
Elle lui permet d’étudier les cratères lunaires et de distinguer les étoiles de la Voie lactée.
Il découvre également quatre satellites de Jupiter et publie ses découvertes dans le Messager des
étoiles en 1610.
Cet ouvrage suscite de virulentes controverses car les autres scientifiques ne disposent pas de télescopes et ne peuvent confirmer ses observations.
Galilée doit pourtant se rétracter devant le tribunal de l’Inquisition qui le condamne en 1633 à la prison à vie pour grave suspicion d’hérésie.
Ses Dialogues sont censurés et on interdit aux éditeurs de publier les travaux passés ou futurs de Galilée.
Hors d’Italie, les Dialogues sont traduits en latin et influencent les savants dans toute l’Europe.
Un examen des données historiques démontre que le procès de Galilée n’est pas un conflit simpliste entre la science et la religion comme on l’imagine habituellement.
La majorité des difficultés de Galilée étaient dues à l’opposition de la part d’autres
scientifiques.
L’Église aurait été entraînée dans cette affaire à la suite de pressions de la communauté académique.
Si on analyse l’affaire Galilée, on se rend ainsi compte que c’est une controverse scientifique où sont mélangées des questions théologiques, religieuses, philosophiques, politiques, sociales et scientifiques.
Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation.
Tous droits réservés..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Philosophie expérimentation scientifique
- Bertrand Russell : MÉTHODE SCIENTIFIQUE EN PHILOSOPHIE - résumé, analyse
- PHILOSOPHIE DU NON (LA), Essai d une philosophie du nouvel esprit scientifique, Gaston Bachelard
- Y a-t-il une place pour la philosophie dans une société qui accorde toute sa confiance à la raison scientifique et à la réussite technique?
- Y a-t-il une place pour la philosophie dans une société qui accorde toute sa confiance à la raison scientifique et à la réussite technique?