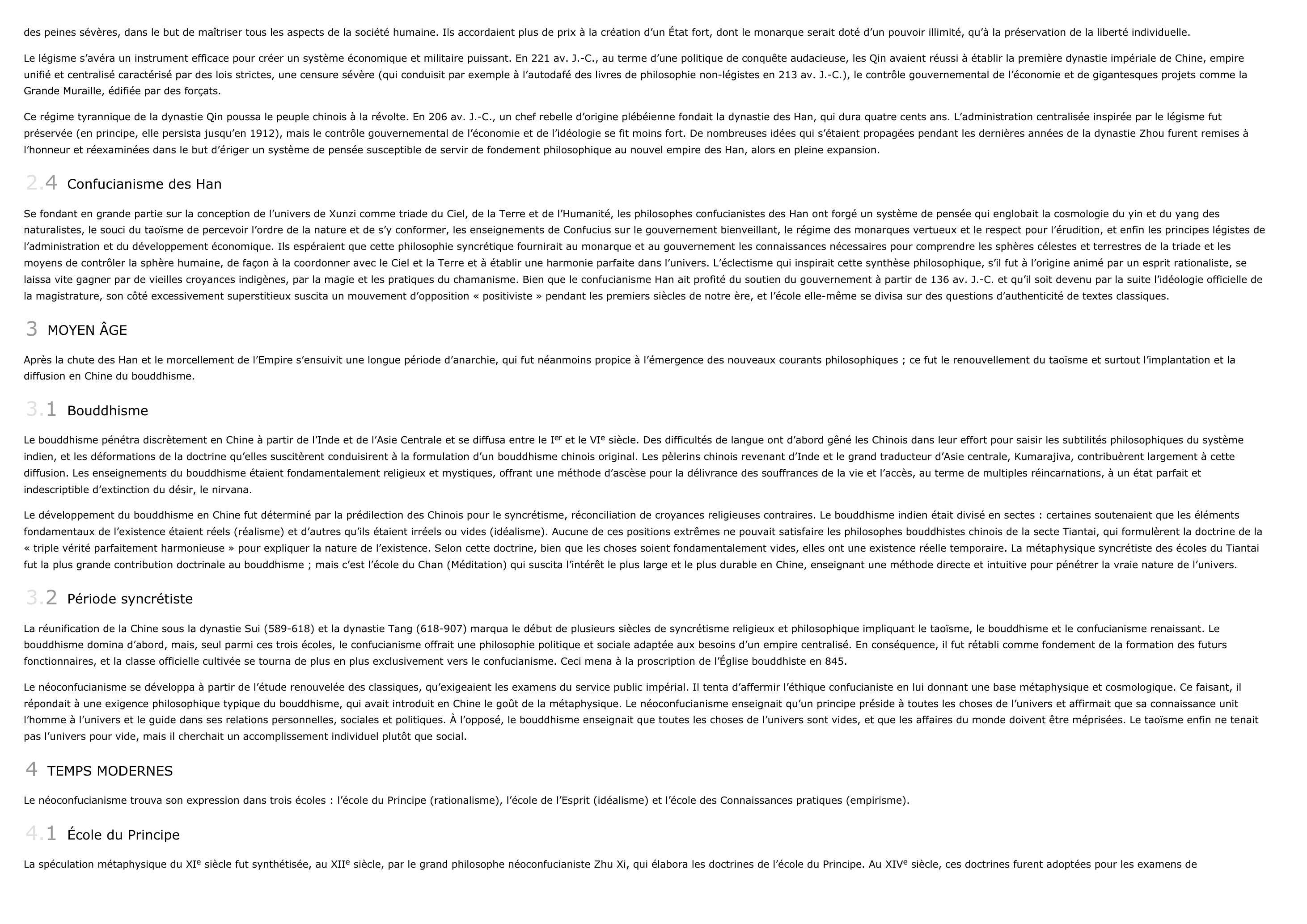chinoise, philosophie - philosophie.
Publié le 08/05/2013
Extrait du document


«
des peines sévères, dans le but de maîtriser tous les aspects de la société humaine.
Ils accordaient plus de prix à la création d’un État fort, dont le monarque serait doté d’un pouvoir illimité, qu’à la préservation de la liberté individuelle.
Le légisme s’avéra un instrument efficace pour créer un système économique et militaire puissant.
En 221 av.
J.-C., au terme d’une politique de conquête audacieuse, les Qin avaient réussi à établir la première dynastie impériale de Chine, empire
unifié et centralisé caractérisé par des lois strictes, une censure sévère (qui conduisit par exemple à l’autodafé des livres de philosophie non-légistes en 213 av.
J.-C.), le contrôle gouvernemental de l’économie et de gigantesques projets comme la
Grande Muraille, édifiée par des forçats.
Ce régime tyrannique de la dynastie Qin poussa le peuple chinois à la révolte.
En 206 av.
J.-C., un chef rebelle d’origine plébéienne fondait la dynastie des Han, qui dura quatre cents ans.
L’administration centralisée inspirée par le légisme fut
préservée (en principe, elle persista jusqu’en 1912), mais le contrôle gouvernemental de l’économie et de l’idéologie se fit moins fort.
De nombreuses idées qui s’étaient propagées pendant les dernières années de la dynastie Zhou furent remises à
l’honneur et réexaminées dans le but d’ériger un système de pensée susceptible de servir de fondement philosophique au nouvel empire des Han, alors en pleine expansion.
2. 4 Confucianisme des Han
Se fondant en grande partie sur la conception de l’univers de Xunzi comme triade du Ciel, de la Terre et de l’Humanité, les philosophes confucianistes des Han ont forgé un système de pensée qui englobait la cosmologie du yin et du yang des
naturalistes, le souci du taoïsme de percevoir l’ordre de la nature et de s’y conformer, les enseignements de Confucius sur le gouvernement bienveillant, le régime des monarques vertueux et le respect pour l’érudition, et enfin les principes légistes de
l’administration et du développement économique.
Ils espéraient que cette philosophie syncrétique fournirait au monarque et au gouvernement les connaissances nécessaires pour comprendre les sphères célestes et terrestres de la triade et les
moyens de contrôler la sphère humaine, de façon à la coordonner avec le Ciel et la Terre et à établir une harmonie parfaite dans l’univers.
L’éclectisme qui inspirait cette synthèse philosophique, s’il fut à l’origine animé par un esprit rationaliste, se
laissa vite gagner par de vieilles croyances indigènes, par la magie et les pratiques du chamanisme.
Bien que le confucianisme Han ait profité du soutien du gouvernement à partir de 136 av.
J.-C.
et qu’il soit devenu par la suite l’idéologie officielle de
la magistrature, son côté excessivement superstitieux suscita un mouvement d’opposition « positiviste » pendant les premiers siècles de notre ère, et l’école elle-même se divisa sur des questions d’authenticité de textes classiques.
3 MOYEN ÂGE
Après la chute des Han et le morcellement de l’Empire s’ensuivit une longue période d’anarchie, qui fut néanmoins propice à l’émergence des nouveaux courants philosophiques ; ce fut le renouvellement du taoïsme et surtout l’implantation et la
diffusion en Chine du bouddhisme.
3. 1 Bouddhisme
Le bouddhisme pénétra discrètement en Chine à partir de l’Inde et de l’Asie Centrale et se diffusa entre le Ier et le VIe siècle.
Des difficultés de langue ont d’abord gêné les Chinois dans leur effort pour saisir les subtilités philosophiques du système
indien, et les déformations de la doctrine qu’elles suscitèrent conduisirent à la formulation d’un bouddhisme chinois original.
Les pèlerins chinois revenant d’Inde et le grand traducteur d’Asie centrale, Kumarajiva, contribuèrent largement à cette
diffusion.
Les enseignements du bouddhisme étaient fondamentalement religieux et mystiques, offrant une méthode d’ascèse pour la délivrance des souffrances de la vie et l’accès, au terme de multiples réincarnations, à un état parfait et
indescriptible d’extinction du désir, le nirvana.
Le développement du bouddhisme en Chine fut déterminé par la prédilection des Chinois pour le syncrétisme, réconciliation de croyances religieuses contraires.
Le bouddhisme indien était divisé en sectes : certaines soutenaient que les éléments
fondamentaux de l’existence étaient réels (réalisme) et d’autres qu’ils étaient irréels ou vides (idéalisme).
Aucune de ces positions extrêmes ne pouvait satisfaire les philosophes bouddhistes chinois de la secte Tiantai, qui formulèrent la doctrine de la
« triple vérité parfaitement harmonieuse » pour expliquer la nature de l’existence.
Selon cette doctrine, bien que les choses soient fondamentalement vides, elles ont une existence réelle temporaire.
La métaphysique syncrétiste des écoles du Tiantai
fut la plus grande contribution doctrinale au bouddhisme ; mais c’est l’école du Chan (Méditation) qui suscita l’intérêt le plus large et le plus durable en Chine, enseignant une méthode directe et intuitive pour pénétrer la vraie nature de l’univers.
3. 2 Période syncrétiste
La réunification de la Chine sous la dynastie Sui (589-618) et la dynastie Tang (618-907) marqua le début de plusieurs siècles de syncrétisme religieux et philosophique impliquant le taoïsme, le bouddhisme et le confucianisme renaissant.
Le
bouddhisme domina d’abord, mais, seul parmi ces trois écoles, le confucianisme offrait une philosophie politique et sociale adaptée aux besoins d’un empire centralisé.
En conséquence, il fut rétabli comme fondement de la formation des futurs
fonctionnaires, et la classe officielle cultivée se tourna de plus en plus exclusivement vers le confucianisme.
Ceci mena à la proscription de l’Église bouddhiste en 845.
Le néoconfucianisme se développa à partir de l’étude renouvelée des classiques, qu’exigeaient les examens du service public impérial.
Il tenta d’affermir l’éthique confucianiste en lui donnant une base métaphysique et cosmologique.
Ce faisant, il
répondait à une exigence philosophique typique du bouddhisme, qui avait introduit en Chine le goût de la métaphysique.
Le néoconfucianisme enseignait qu’un principe préside à toutes les choses de l’univers et affirmait que sa connaissance unit
l’homme à l’univers et le guide dans ses relations personnelles, sociales et politiques.
À l’opposé, le bouddhisme enseignait que toutes les choses de l’univers sont vides, et que les affaires du monde doivent être méprisées.
Le taoïsme enfin ne tenait
pas l’univers pour vide, mais il cherchait un accomplissement individuel plutôt que social.
4 TEMPS MODERNES
Le néoconfucianisme trouva son expression dans trois écoles : l’école du Principe (rationalisme), l’école de l’Esprit (idéalisme) et l’école des Connaissances pratiques (empirisme).
4. 1 École du Principe
La spéculation métaphysique du XIe siècle fut synthétisée, au XII e siècle, par le grand philosophe néoconfucianiste Zhu Xi, qui élabora les doctrines de l’école du Principe.
Au XIV e siècle, ces doctrines furent adoptées pour les examens de.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Philosophie chinoise
- L'oisiveté est la mère de la philosophie (Hobbes)
- Philosophie marc aurele
- M Vergeade Philosophie : Explication du texte janv.21 Les idées et les âges (1927)P 102 -Manuel Delagrave -P 427-
- À propos de l'histoire de la philosophie (I).