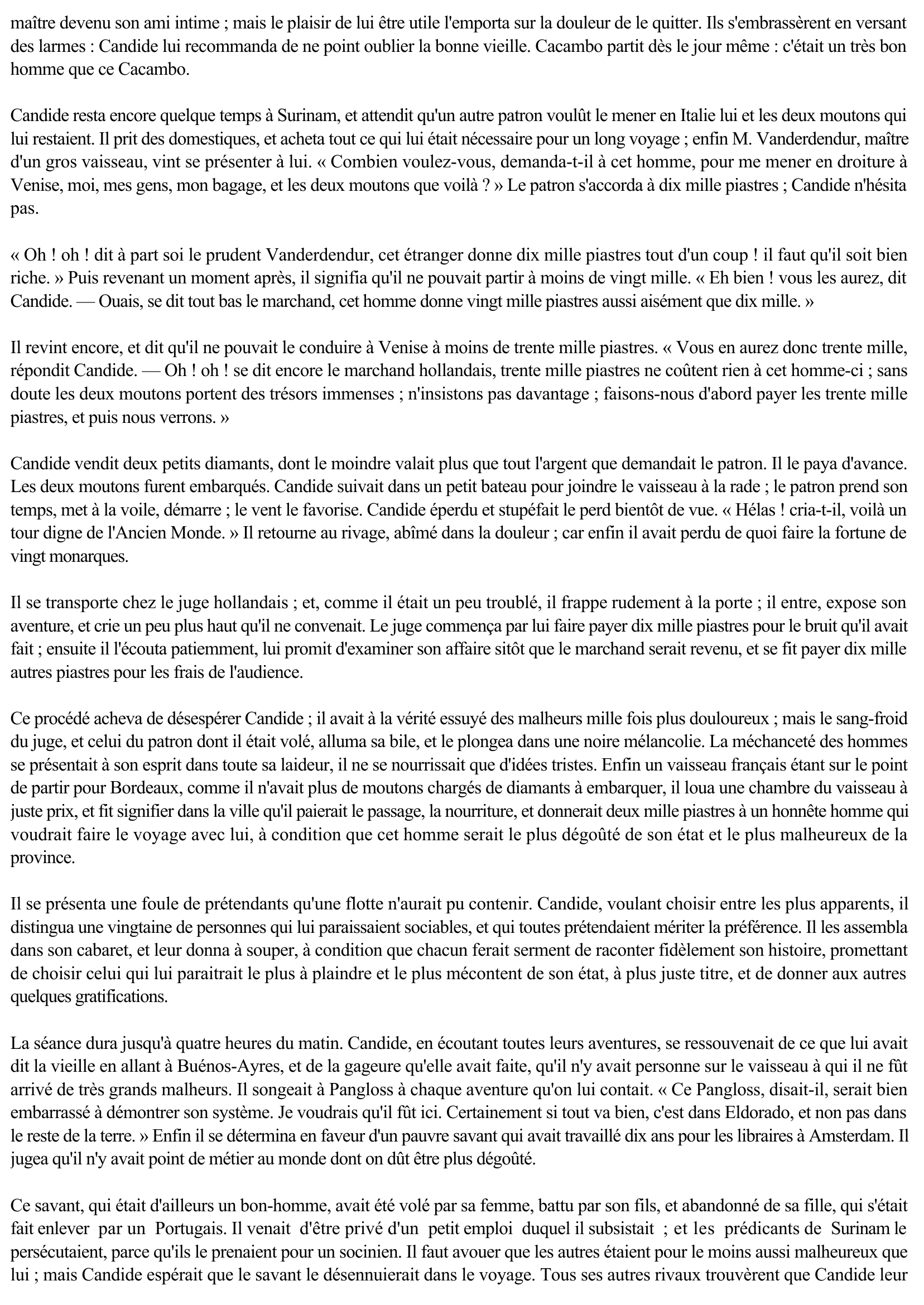Candide, Voltaire - Chapitre 19
Publié le 11/09/2006

Extrait du document


«
maître devenu son ami intime ; mais le plaisir de lui être utile l'emporta sur la douleur de le quitter.
Ils s'embrassèrent en versantdes larmes : Candide lui recommanda de ne point oublier la bonne vieille.
Cacambo partit dès le jour même : c'était un très bonhomme que ce Cacambo.
Candide resta encore quelque temps à Surinam, et attendit qu'un autre patron voulût le mener en Italie lui et les deux moutons quilui restaient.
Il prit des domestiques, et acheta tout ce qui lui était nécessaire pour un long voyage ; enfin M.
Vanderdendur, maîtred'un gros vaisseau, vint se présenter à lui.
« Combien voulez-vous, demanda-t-il à cet homme, pour me mener en droiture àVenise, moi, mes gens, mon bagage, et les deux moutons que voilà ? » Le patron s'accorda à dix mille piastres ; Candide n'hésitapas.
« Oh ! oh ! dit à part soi le prudent Vanderdendur, cet étranger donne dix mille piastres tout d'un coup ! il faut qu'il soit bienriche.
» Puis revenant un moment après, il signifia qu'il ne pouvait partir à moins de vingt mille.
« Eh bien ! vous les aurez, ditCandide.
— Ouais, se dit tout bas le marchand, cet homme donne vingt mille piastres aussi aisément que dix mille.
»
Il revint encore, et dit qu'il ne pouvait le conduire à Venise à moins de trente mille piastres.
« Vous en aurez donc trente mille,répondit Candide.
— Oh ! oh ! se dit encore le marchand hollandais, trente mille piastres ne coûtent rien à cet homme-ci ; sansdoute les deux moutons portent des trésors immenses ; n'insistons pas davantage ; faisons-nous d'abord payer les trente millepiastres, et puis nous verrons.
»
Candide vendit deux petits diamants, dont le moindre valait plus que tout l'argent que demandait le patron.
Il le paya d'avance.Les deux moutons furent embarqués.
Candide suivait dans un petit bateau pour joindre le vaisseau à la rade ; le patron prend sontemps, met à la voile, démarre ; le vent le favorise.
Candide éperdu et stupéfait le perd bientôt de vue.
« Hélas ! cria-t-il, voilà untour digne de l'Ancien Monde.
» Il retourne au rivage, abîmé dans la douleur ; car enfin il avait perdu de quoi faire la fortune devingt monarques.
Il se transporte chez le juge hollandais ; et, comme il était un peu troublé, il frappe rudement à la porte ; il entre, expose sonaventure, et crie un peu plus haut qu'il ne convenait.
Le juge commença par lui faire payer dix mille piastres pour le bruit qu'il avaitfait ; ensuite il l'écouta patiemment, lui promit d'examiner son affaire sitôt que le marchand serait revenu, et se fit payer dix milleautres piastres pour les frais de l'audience.
Ce procédé acheva de désespérer Candide ; il avait à la vérité essuyé des malheurs mille fois plus douloureux ; mais le sang-froiddu juge, et celui du patron dont il était volé, alluma sa bile, et le plongea dans une noire mélancolie.
La méchanceté des hommesse présentait à son esprit dans toute sa laideur, il ne se nourrissait que d'idées tristes.
Enfin un vaisseau français étant sur le pointde partir pour Bordeaux, comme il n'avait plus de moutons chargés de diamants à embarquer, il loua une chambre du vaisseau àjuste prix, et fit signifier dans la ville qu'il paierait le passage, la nourriture, et donnerait deux mille piastres à un honnête homme quivoudrait faire le voyage avec lui, à condition que cet homme serait le plus dégoûté de son état et le plus malheureux de laprovince.
Il se présenta une foule de prétendants qu'une flotte n'aurait pu contenir.
Candide, voulant choisir entre les plus apparents, ildistingua une vingtaine de personnes qui lui paraissaient sociables, et qui toutes prétendaient mériter la préférence.
Il les assembladans son cabaret, et leur donna à souper, à condition que chacun ferait serment de raconter fidèlement son histoire, promettantde choisir celui qui lui paraitrait le plus à plaindre et le plus mécontent de son état, à plus juste titre, et de donner aux autresquelques gratifications.
La séance dura jusqu'à quatre heures du matin.
Candide, en écoutant toutes leurs aventures, se ressouvenait de ce que lui avaitdit la vieille en allant à Buénos-Ayres, et de la gageure qu'elle avait faite, qu'il n'y avait personne sur le vaisseau à qui il ne fûtarrivé de très grands malheurs.
Il songeait à Pangloss à chaque aventure qu'on lui contait.
« Ce Pangloss, disait-il, serait bienembarrassé à démontrer son système.
Je voudrais qu'il fût ici.
Certainement si tout va bien, c'est dans Eldorado, et non pas dansle reste de la terre.
» Enfin il se détermina en faveur d'un pauvre savant qui avait travaillé dix ans pour les libraires à Amsterdam.
Iljugea qu'il n'y avait point de métier au monde dont on dût être plus dégoûté.
Ce savant, qui était d'ailleurs un bon-homme, avait été volé par sa femme, battu par son fils, et abandonné de sa fille, qui s'étaitfait enlever par un Portugais.
Il venait d'être privé d'un petit emploi duquel il subsistait ; et les prédicants de Surinam lepersécutaient, parce qu'ils le prenaient pour un socinien.
Il faut avouer que les autres étaient pour le moins aussi malheureux quelui ; mais Candide espérait que le savant le désennuierait dans le voyage.
Tous ses autres rivaux trouvèrent que Candide leur.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Chapitre 19 de Candide de Voltaire : De quel manière Voltaire dénonce-t-il l’esclavage ?
- Candide chapitre 16 de voltaire
- Chapitre 19 de Candide de Voltaire (commentaire)
- Lecture analytique : Chapitre 6 de Candide, Voltaire
- Commentaire chapitre 3 de Candide de Voltaire