Candide, un « conte autre »
Publié le 22/02/2012
Extrait du document
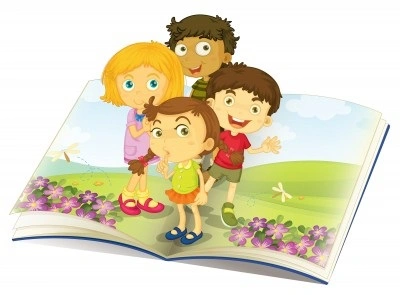
Dans l'article « Conte » du Supplément de l'Encyclopédie (1776), Marmontel distinguera deux sortes de contes : ceux dont « l'intérêt » est « dans le noeud et le dénouement d'une action comique » et qui sont donc susceptibles d'une certaine étendue ; et ceux que termine « un trait », qui doit être « un grain de sel, piquant et fin », et où il faut donc « aller au but le plus vite qu'il est possible ». Théorisation tardive et typologie étroite pour une forme et une pratique aussi libres, mais dont la rigueur excessive souligne justement, sous l'aspect dynamique, la singularité de Candide, comme un pseudo-conte, ou un conte autre. Les deux parcours semblent ici suivis, et subvertis. Une histoire complexe, d'abord, labyrinthique même avec ses errances, ses décrochements, ses retours, et cette quête d'un but et d'un sens, mais sans autre « intérêt » dramatique que la tension même de son désordre et de son immobilité. Puis dans le renouvellement gracieux d'un incipit, l'annonce d'une autre histoire, d'un conte bref qui sortirait enfin l'autre de l'impasse ; mais le discours ainsi dramatisé en « Conclusion » se refuse aussitôt tout essor, tout élan vers un « trait », pour dire seulement la lente et difficile élaboration d'un vague « mot de la fin », nouveau mais à peine, ambigu, déceptif : résolution provocante, en somme, et qui renverrait la lecture aux pouvoirs de la raison critique et à la responsabilité d'un sens.
André Magnan, Voltaire, Candide ou l'Optimisme
Liens utiles
- Nègre de Surinam - de Candide ou l’optimiste, un conte philosophique écrit par Voltaire en 1759
- Incipit de Candide, Voltaire Le texte que nous allons étudier se trouve au début du conte philosophique Candide de Voltaire.
- CANDIDE OU L’OPTIMISME Voltaire. Conte - résumé de l'oeuvre
- PANGLOSS. Personnage de Candide (1759), conte de Voltaire
- La place de l'ELDORADO dans le conte de candide































