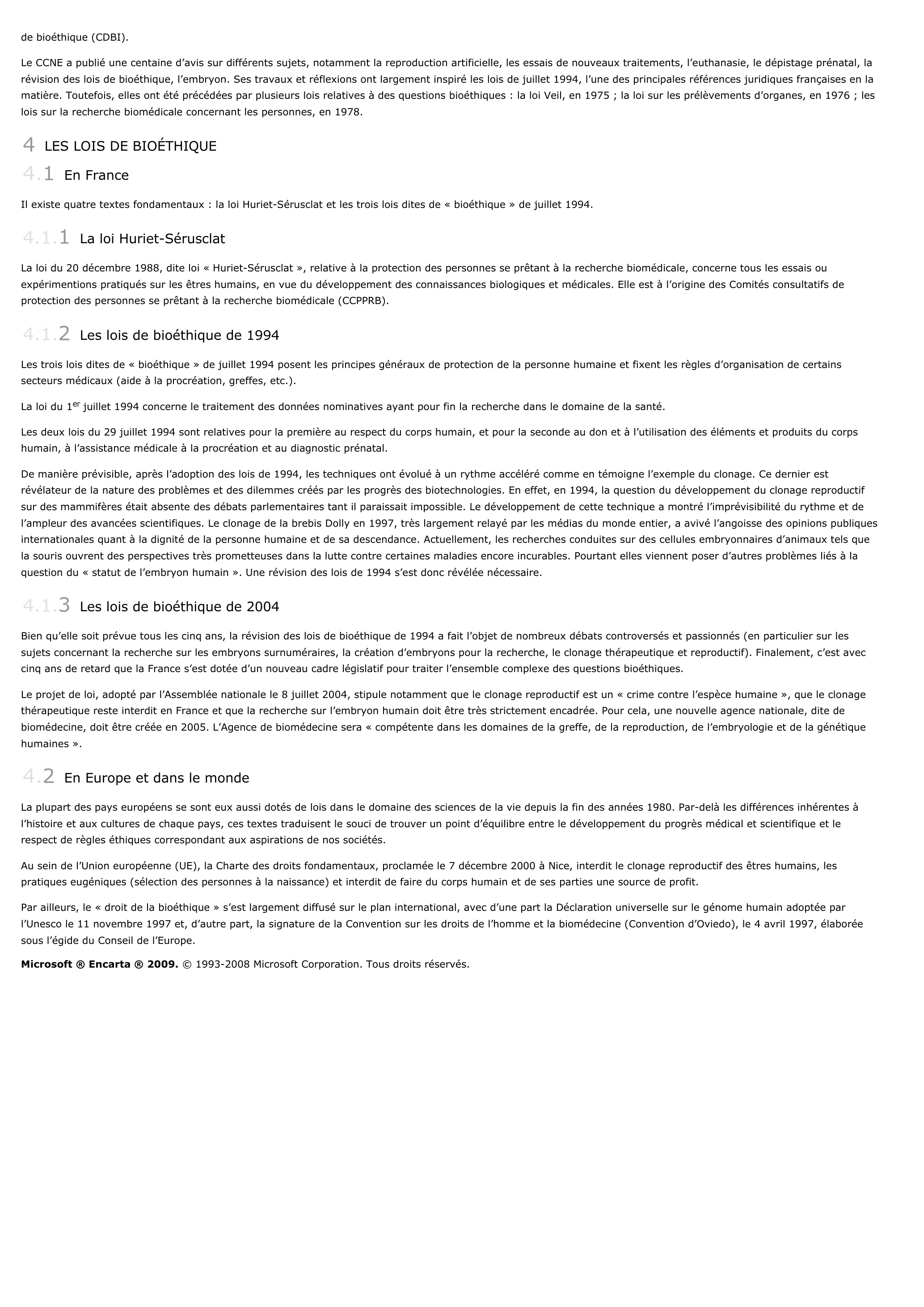bioéthique - Mécedine.
Publié le 23/04/2013
Extrait du document
«
de bioéthique (CDBI).
Le CCNE a publié une centaine d’avis sur différents sujets, notamment la reproduction artificielle, les essais de nouveaux traitements, l’euthanasie, le dépistage prénatal, larévision des lois de bioéthique, l’embryon.
Ses travaux et réflexions ont largement inspiré les lois de juillet 1994, l’une des principales références juridiques françaises en lamatière.
Toutefois, elles ont été précédées par plusieurs lois relatives à des questions bioéthiques : la loi Veil, en 1975 ; la loi sur les prélèvements d’organes, en 1976 ; leslois sur la recherche biomédicale concernant les personnes, en 1978.
4 LES LOIS DE BIOÉTHIQUE
4.1 En France
Il existe quatre textes fondamentaux : la loi Huriet-Sérusclat et les trois lois dites de « bioéthique » de juillet 1994.
4.1. 1 La loi Huriet-Sérusclat
La loi du 20 décembre 1988, dite loi « Huriet-Sérusclat », relative à la protection des personnes se prêtant à la recherche biomédicale, concerne tous les essais ouexpérimentions pratiqués sur les êtres humains, en vue du développement des connaissances biologiques et médicales.
Elle est à l’origine des Comités consultatifs deprotection des personnes se prêtant à la recherche biomédicale (CCPPRB).
4.1. 2 Les lois de bioéthique de 1994
Les trois lois dites de « bioéthique » de juillet 1994 posent les principes généraux de protection de la personne humaine et fixent les règles d’organisation de certainssecteurs médicaux (aide à la procréation, greffes, etc.).
La loi du 1 er juillet 1994 concerne le traitement des données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé.
Les deux lois du 29 juillet 1994 sont relatives pour la première au respect du corps humain, et pour la seconde au don et à l’utilisation des éléments et produits du corpshumain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal.
De manière prévisible, après l’adoption des lois de 1994, les techniques ont évolué à un rythme accéléré comme en témoigne l’exemple du clonage.
Ce dernier estrévélateur de la nature des problèmes et des dilemmes créés par les progrès des biotechnologies.
En effet, en 1994, la question du développement du clonage reproductifsur des mammifères était absente des débats parlementaires tant il paraissait impossible.
Le développement de cette technique a montré l’imprévisibilité du rythme et del’ampleur des avancées scientifiques.
Le clonage de la brebis Dolly en 1997, très largement relayé par les médias du monde entier, a avivé l’angoisse des opinions publiquesinternationales quant à la dignité de la personne humaine et de sa descendance.
Actuellement, les recherches conduites sur des cellules embryonnaires d’animaux tels quela souris ouvrent des perspectives très prometteuses dans la lutte contre certaines maladies encore incurables.
Pourtant elles viennent poser d’autres problèmes liés à laquestion du « statut de l’embryon humain ».
Une révision des lois de 1994 s’est donc révélée nécessaire.
4.1. 3 Les lois de bioéthique de 2004
Bien qu’elle soit prévue tous les cinq ans, la révision des lois de bioéthique de 1994 a fait l’objet de nombreux débats controversés et passionnés (en particulier sur lessujets concernant la recherche sur les embryons surnuméraires, la création d’embryons pour la recherche, le clonage thérapeutique et reproductif).
Finalement, c’est aveccinq ans de retard que la France s’est dotée d’un nouveau cadre législatif pour traiter l’ensemble complexe des questions bioéthiques.
Le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale le 8 juillet 2004, stipule notamment que le clonage reproductif est un « crime contre l’espèce humaine », que le clonagethérapeutique reste interdit en France et que la recherche sur l’embryon humain doit être très strictement encadrée.
Pour cela, une nouvelle agence nationale, dite debiomédecine, doit être créée en 2005.
L’Agence de biomédecine sera « compétente dans les domaines de la greffe, de la reproduction, de l’embryologie et de la génétiquehumaines ».
4.2 En Europe et dans le monde
La plupart des pays européens se sont eux aussi dotés de lois dans le domaine des sciences de la vie depuis la fin des années 1980.
Par-delà les différences inhérentes àl’histoire et aux cultures de chaque pays, ces textes traduisent le souci de trouver un point d’équilibre entre le développement du progrès médical et scientifique et lerespect de règles éthiques correspondant aux aspirations de nos sociétés.
Au sein de l’Union européenne (UE), la Charte des droits fondamentaux, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice, interdit le clonage reproductif des êtres humains, lespratiques eugéniques (sélection des personnes à la naissance) et interdit de faire du corps humain et de ses parties une source de profit.
Par ailleurs, le « droit de la bioéthique » s’est largement diffusé sur le plan international, avec d’une part la Déclaration universelle sur le génome humain adoptée parl’Unesco le 11 novembre 1997 et, d’autre part, la signature de la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine (Convention d’Oviedo), le 4 avril 1997, élaboréesous l’égide du Conseil de l’Europe.
Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation.
Tous droits réservés..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Grand oral du bac : La bioéthique
- radiothérapie - Mécedine.
- psychotropes - Mécedine.
- myopie - Mécedine.
- mélancolie (psychiatrie) - Mécedine.