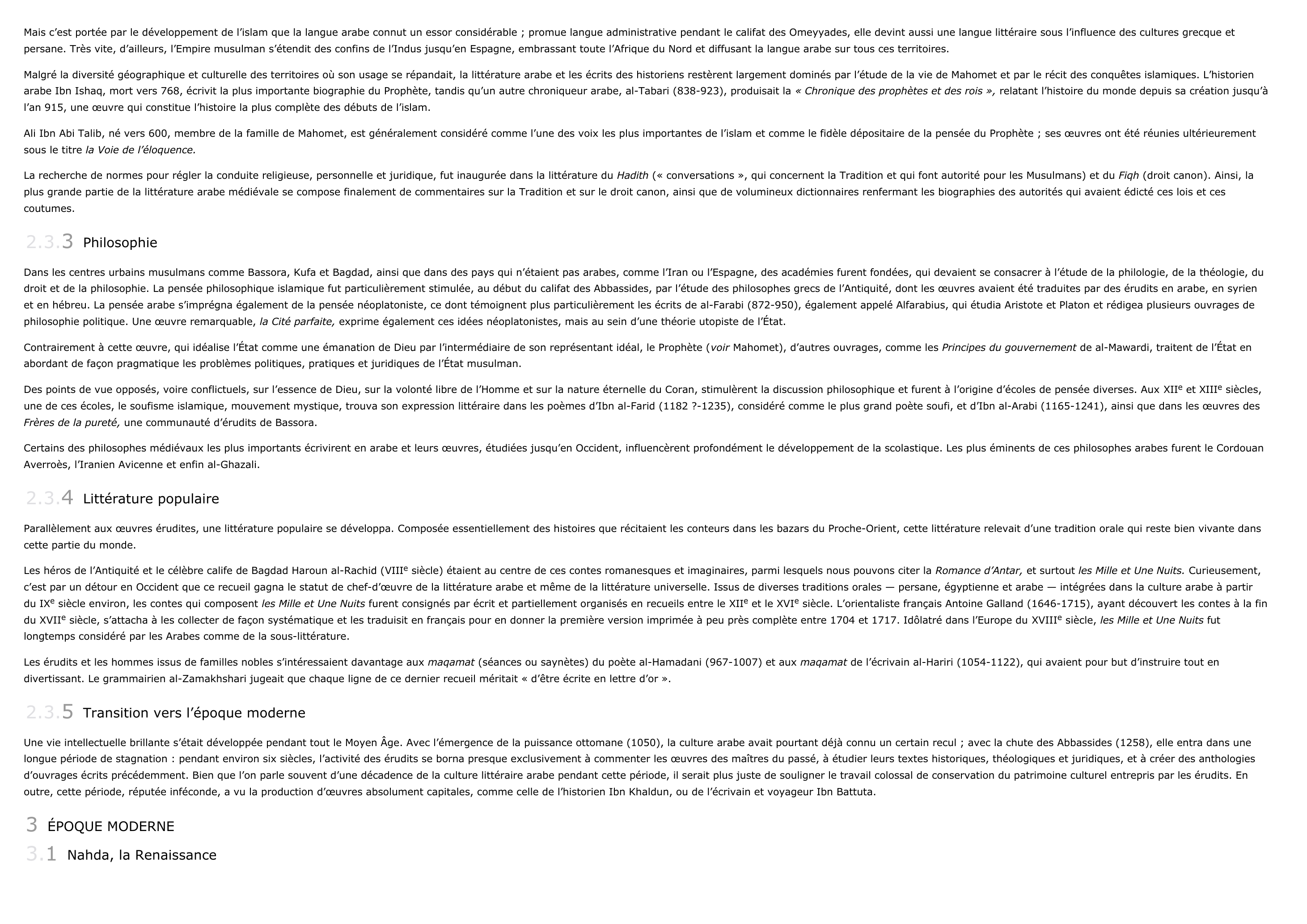arabe, littérature.
Publié le 06/05/2013
Extrait du document
«
Mais c’est portée par le développement de l’islam que la langue arabe connut un essor considérable ; promue langue administrative pendant le califat des Omeyyades, elle devint aussi une langue littéraire sous l’influence des cultures grecque et
persane.
Très vite, d’ailleurs, l’Empire musulman s’étendit des confins de l’Indus jusqu’en Espagne, embrassant toute l’Afrique du Nord et diffusant la langue arabe sur tous ces territoires.
Malgré la diversité géographique et culturelle des territoires où son usage se répandait, la littérature arabe et les écrits des historiens restèrent largement dominés par l’étude de la vie de Mahomet et par le récit des conquêtes islamiques.
L’historien
arabe Ibn Ishaq, mort vers 768, écrivit la plus importante biographie du Prophète, tandis qu’un autre chroniqueur arabe, al-Tabari (838-923), produisait la « Chronique des prophètes et des rois », relatant l’histoire du monde depuis sa création jusqu’à
l’an 915, une œuvre qui constitue l’histoire la plus complète des débuts de l’islam.
Ali Ibn Abi Talib, né vers 600, membre de la famille de Mahomet, est généralement considéré comme l’une des voix les plus importantes de l’islam et comme le fidèle dépositaire de la pensée du Prophète ; ses œuvres ont été réunies ultérieurement
sous le titre la Voie de l’éloquence.
La recherche de normes pour régler la conduite religieuse, personnelle et juridique, fut inaugurée dans la littérature du Hadith (« conversations », qui concernent la Tradition et qui font autorité pour les Musulmans) et du Fiqh (droit canon).
Ainsi, la
plus grande partie de la littérature arabe médiévale se compose finalement de commentaires sur la Tradition et sur le droit canon, ainsi que de volumineux dictionnaires renfermant les biographies des autorités qui avaient édicté ces lois et ces
coutumes.
2.3. 3 Philosophie
Dans les centres urbains musulmans comme Bassora, Kufa et Bagdad, ainsi que dans des pays qui n’étaient pas arabes, comme l’Iran ou l’Espagne, des académies furent fondées, qui devaient se consacrer à l’étude de la philologie, de la théologie, du
droit et de la philosophie.
La pensée philosophique islamique fut particulièrement stimulée, au début du califat des Abbassides, par l’étude des philosophes grecs de l’Antiquité, dont les œuvres avaient été traduites par des érudits en arabe, en syrien
et en hébreu.
La pensée arabe s’imprégna également de la pensée néoplatoniste, ce dont témoignent plus particulièrement les écrits de al-Farabi (872-950), également appelé Alfarabius, qui étudia Aristote et Platon et rédigea plusieurs ouvrages de
philosophie politique.
Une œuvre remarquable, la Cité parfaite, exprime également ces idées néoplatonistes, mais au sein d’une théorie utopiste de l’État.
Contrairement à cette œuvre, qui idéalise l’État comme une émanation de Dieu par l’intermédiaire de son représentant idéal, le Prophète ( voir Mahomet), d’autres ouvrages, comme les Principes du gouvernement de al-Mawardi, traitent de l’État en
abordant de façon pragmatique les problèmes politiques, pratiques et juridiques de l’État musulman.
Des points de vue opposés, voire conflictuels, sur l’essence de Dieu, sur la volonté libre de l’Homme et sur la nature éternelle du Coran, stimulèrent la discussion philosophique et furent à l’origine d’écoles de pensée diverses.
Aux XII e et XIII e siècles,
une de ces écoles, le soufisme islamique, mouvement mystique, trouva son expression littéraire dans les poèmes d’Ibn al-Farid (1182 ?-1235), considéré comme le plus grand poète soufi, et d’Ibn al-Arabi (1165-1241), ainsi que dans les œuvres des
Frères de la pureté, une communauté d’érudits de Bassora.
Certains des philosophes médiévaux les plus importants écrivirent en arabe et leurs œuvres, étudiées jusqu’en Occident, influencèrent profondément le développement de la scolastique.
Les plus éminents de ces philosophes arabes furent le Cordouan
Averroès, l’Iranien Avicenne et enfin al-Ghazali.
2.3. 4 Littérature populaire
Parallèlement aux œuvres érudites, une littérature populaire se développa.
Composée essentiellement des histoires que récitaient les conteurs dans les bazars du Proche-Orient, cette littérature relevait d’une tradition orale qui reste bien vivante dans
cette partie du monde.
Les héros de l’Antiquité et le célèbre calife de Bagdad Haroun al-Rachid ( VIII e siècle) étaient au centre de ces contes romanesques et imaginaires, parmi lesquels nous pouvons citer la Romance d’Antar, et surtout les Mille et Une Nuits. Curieusement,
c’est par un détour en Occident que ce recueil gagna le statut de chef-d’œuvre de la littérature arabe et même de la littérature universelle.
Issus de diverses traditions orales — persane, égyptienne et arabe — intégrées dans la culture arabe à partir
du IXe siècle environ, les contes qui composent les Mille et Une Nuits furent consignés par écrit et partiellement organisés en recueils entre le XII e et le XVI e siècle.
L’orientaliste français Antoine Galland (1646-1715), ayant découvert les contes à la fin
du XVII e siècle, s’attacha à les collecter de façon systématique et les traduisit en français pour en donner la première version imprimée à peu près complète entre 1704 et 1717.
Idôlatré dans l’Europe du XVIII e siècle, les Mille et Une Nuits fut
longtemps considéré par les Arabes comme de la sous-littérature.
Les érudits et les hommes issus de familles nobles s’intéressaient davantage aux maqamat (séances ou saynètes) du poète al-Hamadani (967-1007) et aux maqamat de l’écrivain al-Hariri (1054-1122), qui avaient pour but d’instruire tout en
divertissant.
Le grammairien al-Zamakhshari jugeait que chaque ligne de ce dernier recueil méritait « d’être écrite en lettre d’or ».
2.3. 5 Transition vers l’époque moderne
Une vie intellectuelle brillante s’était développée pendant tout le Moyen Âge.
Avec l’émergence de la puissance ottomane (1050), la culture arabe avait pourtant déjà connu un certain recul ; avec la chute des Abbassides (1258), elle entra dans une
longue période de stagnation : pendant environ six siècles, l’activité des érudits se borna presque exclusivement à commenter les œuvres des maîtres du passé, à étudier leurs textes historiques, théologiques et juridiques, et à créer des anthologies
d’ouvrages écrits précédemment.
Bien que l’on parle souvent d’une décadence de la culture littéraire arabe pendant cette période, il serait plus juste de souligner le travail colossal de conservation du patrimoine culturel entrepris par les érudits.
En
outre, cette période, réputée inféconde, a vu la production d’œuvres absolument capitales, comme celle de l’historien Ibn Khaldun, ou de l’écrivain et voyageur Ibn Battuta.
3 ÉPOQUE MODERNE
3. 1 Nahda, la Renaissance.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La littérature du Moyen-Orient au XXe siècle par Alan Chatham de Bolivar Le roman est un genre littéraire relativement récent dans la littérature arabe plus marquée par le conte ou la poésie, qui induisent une rupture par rapport aux formes classiques.
- LITTÉRATURES ARABE ET MUSULMANE (Exposé – Art & Littérature – Collège/Lycée)
- L'émergence de la littérature arabe moderne
- La littérature arabe
- Madame Bovary et la littérature sentimentale